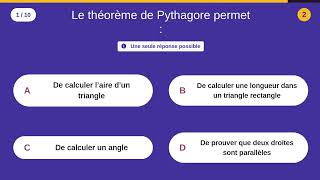VIE
Publié le 02/04/2015

Extrait du document
vant, la vie est animation de la matière. Les stoiciens étendaient le vitalisme au cosmos : un souffle (pneuma) anime le monde. Dans ce rôle explicatif, la vie est souvent remplacée par des concepts analogues, mais construits au sein de théories plus déterminées : âme, forme organisatrice, principe vital, élan vital. Postuler une entité pour expliquer un type de phénomène a quelque chose de tautologique. Ceci se voit parfaitement dans la définition que Barthez (XVIIIe siècle) donne de son principe vital : «Cause qui produit tous les phénomènes de la vie dans le corps humain«. A première vue, le gain explicatif est nul. Le vitalisme toutefois n'est pas quelque chose de totalement trivial. Il pose de façon absolue la spécificité du vivant (Canguilhem : il «traduit une exigence permanente de la vie dans le vivant«). C'est grâce à cette position qu'on parvint d'abord à décrire de façon fine cette solidarité des parties qui font du vivant un organisme ; bien entendu, cela a pour contrepartie l'admission de la finalité dans l'explication (par ex. pour rendre compte de la croissance ou d'une régulation globale). Comme l'a montré Canguilhem, le vitalisme a valeur de méthode (c'est le courant vitaliste qui a construit le concept de réflexe). Toutefois, le mécanisme aussi est une méthode ; quand Epicure et Lucrèce s'efforcent de décrire les vivants à partir de la conjonction des atomes, quand Descartes tente d'assimiler la bête à une machine (La Meltrie au XVIIIe siècle fera de même pour l'homme), au-delà des insuffisances de leurs théories, ce qu'il faut comprendre, c'est l'exigence rationnelle de construire la biologie sur les bases de la physique (1). La contre partie métaphysique du mécanisme est le matérialisme. A l'inverse, «le vitalisme a besoin pour survivre que subsiste en biologie, sinon de véritables paradoxes, du moins du mystère« (J. Monod, le Hasard et la Nécessité, p. 168).
L'histoire de la biologie montre que cette discipline progresse d'une part en recourant à des phénomènes de moins en moins immédiats (2) (on passe de la figure externe des vivants à la cellule par ex.), d'autre part en construisant des théories localisées (circulation du sang, hormones, hérédité, par ex.). Toutes ces théories reposent en dernier lieu sur des bases physico-chimiques, et de façon plus générale, tout ce que nous nommons vivant dépend dans sa constitution du carbone et de l'oxygène (3). Pouvons-nous pour autant réduire la biologie à la physico-chimie ? Le problème se pose d'abord au niveau des
concepts. Il y a des concepts spécifiquement biologiques (par ex. : nerf, vitose, virus, hormone sexuelle mâle). On peut souvent les réduire à leurs composants chimiques (par ex. pour la testostérone dernière citée). C'est d'ailleurs à cela que travaille la biologie. Mais il y a aussi des lois ou des mécanismes spécifiquement biologiques (ex. : lois de Mendel sur l'hérédité). Peut-on les déduire des lois physico-chimiques ? La question est plus confuse. De manière générale, la loi de production d'un phénomène vivant (ex. : un code génétique) s'exprime en termes physico-chimiques, mais n'est pas une loi physico-chimique (les réactions correspondant au code génétique ne constituent pas une séquence physico-chimique nécessaire). Ce n'est pas par la déduction qu'on s'efforce de relier des phénomènes physiques et vivants, mais par une évolution, (voir Darwin). C'est une question empirique. Là encore se posent des questions de finalité (qu'on s'efforce de résoudre par des modèles cybernétiques). Le réductionnisme en est probablement conduit à la situation paradoxale d'affirmer que la biologie n'ajoute ontologiquement rien aux entités postulées par la physique, sans que pourtant celle-ci se déduise de celle-là.
1 . Cf. Cari G. Hempel, Eléments dEpistémologie : le mécanisme est une maxime heuristique (t. fr. Colin, p. 165).
2 . Cf. Fr. Jacob, La Logique du Vivant.
3 . Bien entendu, ceci conditionne les possibilités de vie sur d'autres planètes ; supposez que quelqu'un dise KIl peut y avoir ailleurs une forme de vie qui ne repose pas sur ces bases«, alors on ne sait pas ce qu'il entend par «vie«.
Liens utiles
- THÈME 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant Thème 1A : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique Chapitre 1 : Les divisions cellulaires, transmission du programme génétique chez les eucaryotes
- « L’art de la vie se rapproche de l’art de la lutte : il faut se tenir prêt sans broncher à répondre aux coups qui fondent sur nous, même s’ils sont imprévus » Marc Aurèle
- La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont il faut faire l'expérience. Kierkegaard
- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)
- exposé sur citoyenneté active et vie politique