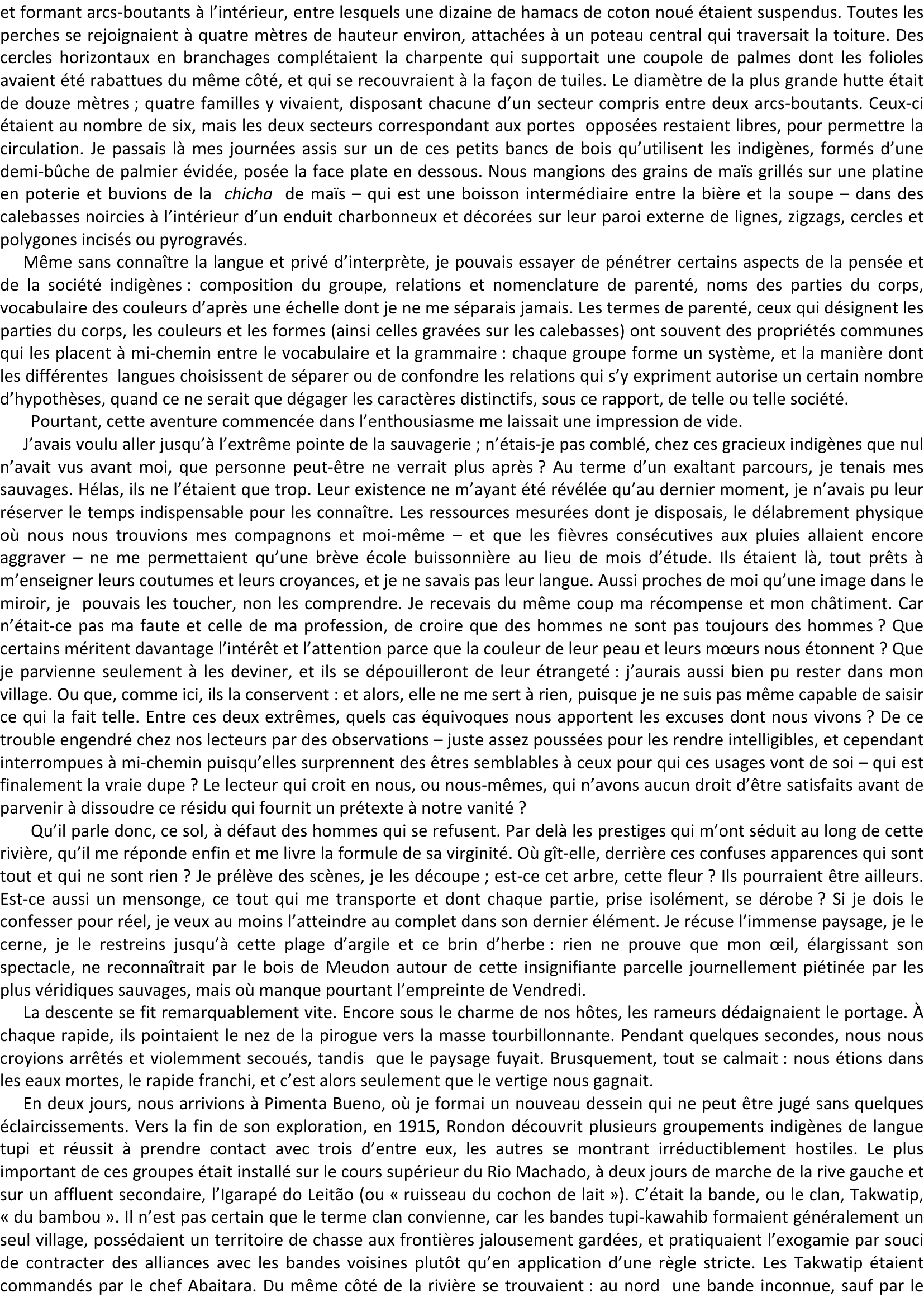XXXI ROBINSON Pendant quatre jours, nous avons remonté la rivière ; les rapides étaient si nombreux qu'il fallut décharger, porter et echarger jusqu'à cinq fois dans la même journée.
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
«
et
formant arcs-boutants àl’intérieur, entrelesquels unedizaine dehamacs decoton nouéétaient suspendus.
Toutesles
perches serejoignaient àquatre mètres dehauteur environ, attachées àun poteau centralquitraversait latoiture.
Des
cercles horizontaux enbranchages complétaient lacharpente quisupportait unecoupole depalmes dontlesfolioles
avaient étérabattues dumême côté,etqui serecouvraient àla façon detuiles.
Lediamètre delaplus grande hutteétait
de douze mètres ; quatrefamilles yvivaient, disposant chacuned’unsecteur compris entredeuxarcs-boutants.
Ceux-ci
étaient aunombre desix, mais lesdeux secteurs correspondant auxportes opposées restaientlibres,pourpermettre la
circulation.
Jepassais làmes journées assissurundeces petits bancs debois qu’utilisent lesindigènes, formésd’une
demi-bûche depalmier évidée,poséelaface plate endessous.
Nousmangions desgrains demaïs grillés surune platine
en poterie etbuvions dela chicha de
maïs –qui estune boisson intermédiaire entrelabière etlasoupe –dans des
calebasses noirciesàl’intérieur d’unenduit charbonneux etdécorées surleur paroi externe delignes, zigzags, cercleset
polygones incisésoupyrogravés.
Même sansconnaître lalangue etprivé d’interprète, jepouvais essayerdepénétrer certainsaspectsdelapensée et
de lasociété indigènes : composition dugroupe, relations etnomenclature deparenté, nomsdesparties ducorps,
vocabulaire descouleurs d’aprèsuneéchelle dontjene me séparais jamais.Lestermes deparenté, ceuxquidésignent les
parties ducorps, lescouleurs etles formes (ainsicelles gravées surlescalebasses) ontsouvent despropriétés communes
qui lesplacent àmi-chemin entrelevocabulaire etlagrammaire : chaquegroupeformeunsystème, etlamanière dont
les différentes langueschoisissent deséparer oudeconfondre lesrelations quis’yexpriment autoriseuncertain nombre
d’hypothèses, quandcene serait quedégager lescaractères distinctifs,souscerapport, detelle outelle société.
Pourtant, cetteaventure commencée dansl’enthousiasme melaissait uneimpression devide.
J’avais vouluallerjusqu’à l’extrême pointedelasauvagerie ; n’étais-jepascomblé, chezcesgracieux indigènes quenul
n’avait vusavant moi,quepersonne peut-être neverrait plusaprès ? Auterme d’unexaltant parcours, jetenais mes
sauvages.
Hélas,ilsne l’étaient quetrop.
Leurexistence nem’ayant étérévélée qu’audernier moment, jen’avais puleur
réserver letemps indispensable pourlesconnaître.
Lesressources mesuréesdontjedisposais, ledélabrement physique
où nous nous trouvions mescompagnons etmoi-même –et que lesfièvres consécutives auxpluies allaient encore
aggraver –ne me permettaient qu’unebrèveécolebuissonnière aulieu demois d’étude.
Ilsétaient là,tout prêts à
m’enseigner leurscoutumes etleurs croyances, etjene savais pasleur langue.
Aussiproches demoi qu’une imagedansle
miroir, jepouvais lestoucher, nonlescomprendre.
Jerecevais dumême coupmarécompense etmon châtiment.
Car
n’était-ce pasmafaute etcelle dema profession, decroire quedeshommes nesont pastoujours deshommes ? Que
certains méritent davantage l’intérêtetl’attention parcequelacouleur deleur peau etleurs mœurs nousétonnent ? Que
je parvienne seulement àles deviner, etils se dépouilleront deleur étrangeté : j’auraisaussibienpurester dansmon
village.
Ouque, comme ici,ilslaconservent : etalors, elleneme sert àrien, puisque jene suis pasmême capable desaisir
ce qui lafait telle.
Entre cesdeux extrêmes, quelscaséquivoques nousapportent lesexcuses dontnous vivons ? Dece
trouble engendré cheznoslecteurs pardes observations –juste assez poussées pourlesrendre intelligibles, etcependant
interrompues àmi-chemin puisqu’elles surprennent desêtres semblables àceux pour quices usages vontdesoi –qui est
finalement lavraie dupe ? Lelecteur quicroit ennous, ounous-mêmes, quin’avons aucundroitd’être satisfaits avantde
parvenir àdissoudre cerésidu quifournit unprétexte ànotre vanité ?
Qu’il parle donc, cesol, àdéfaut deshommes quiserefusent.
Pardelà lesprestiges quim’ont séduit aulong decette
rivière, qu’ilmeréponde enfinetme livre laformule desavirginité.
Oùgît-elle, derrière cesconfuses apparences quisont
tout etqui nesont rien ? Jeprélève desscènes, jeles découpe ; est-cecetarbre, cettefleur ? Ilspourraient êtreailleurs.
Est-ce aussiunmensonge, cetout quime transporte etdont chaque partie,priseisolément, sedérobe ? Sije dois le
confesser pourréel,jeveux aumoins l’atteindre aucomplet danssondernier élément.
Jerécuse l’immense paysage,jele
cerne, jelerestreins jusqu’àcetteplage d’argile etce brin d’herbe : rienneprouve quemon œil,élargissant son
spectacle, nereconnaîtrait parlebois deMeudon autourdecette insignifiante parcellejournellement piétinéeparles
plus véridiques sauvages,maisoùmanque pourtant l’empreinte deVendredi.
La descente sefitremarquablement vite.Encore souslecharme denos hôtes, lesrameurs dédaignaient leportage.
À
chaque rapide,ilspointaient lenez delapirogue verslamasse tourbillonnante.
Pendantquelques secondes, nousnous
croyions arrêtésetviolemment secoués,tandisquelepaysage fuyait.Brusquement, toutsecalmait : nousétions dans
les eaux mortes, lerapide franchi, etc’est alors seulement quelevertige nousgagnait.
En deux jours, nousarrivions àPimenta Bueno,oùjeformai unnouveau desseinquinepeut êtrejugé sans quelques
éclaircissements.
Verslafin deson exploration, en1915, Rondon découvrit plusieursgroupements indigènesdelangue
tupi etréussit àprendre contactavectroisd’entre eux,lesautres semontrant irréductiblement hostiles.Leplus
important deces groupes étaitinstallé surlecours supérieur duRio Machado, àdeux jours demarche delarive gauche et
sur unaffluent secondaire, l’IgarapédoLeitão (ou« ruisseau ducochon delait »).
C’était labande, ouleclan, Takwatip,
« du bambou ».
Iln’est pascertain queleterme clanconvienne, carlesbandes tupi-kawahib formaientgénéralement un
seul village, possédaient unterritoire dechasse auxfrontières jalousement gardées,etpratiquaient l’exogamieparsouci
de contracter desalliances aveclesbandes voisines plutôtqu’enapplication d’unerèglestricte.
LesTakwatip étaient
commandés parlechef Abaitara.
Dumême côtédelarivière setrouvaient : aunord unebande inconnue, saufparle.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Mille et un jours en prison a Berlin Chapitre XXXI.
- A un demi mille du côté opposé de la rivière qui coule près du Fort, nous rencontrâmes un attelage superbe. Charles R. Daoust, Cent-Vingt Jours de service actif
- Ecriture d'invention, Vous écrirez le journal intime de Robinson Crusoé (2 jours)
- l'oisiveté pèse aux races laborieuses. Ce fut un coup de maître de l'instinct anglais de faire du dimanche une journée si sainte et si ennuyeuse, que l'Anglais en vient, à son insu, à désirer le retour des jours de semaine et de travail. Par-delà le bien et le mal (1886), 189 Nietzsche, Friedrich Wilhelm. Commentez cette citation.
- L'oisiveté pèse aux races laborieuses. Ce fut un coup de maître de l'instinct anglais de faire du dimanche une journée si sainte et si ennuyeuse, que l'Anglais en vient, à son insu, à désirer le retour des jours de semaine et de travail. [ Par-delà le bien et le mal (1886), 189 ] Nietzsche, Friedrich Wilhelm. Commentez cette citation.