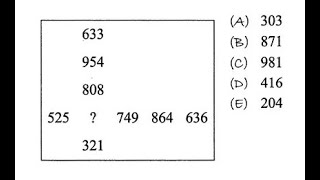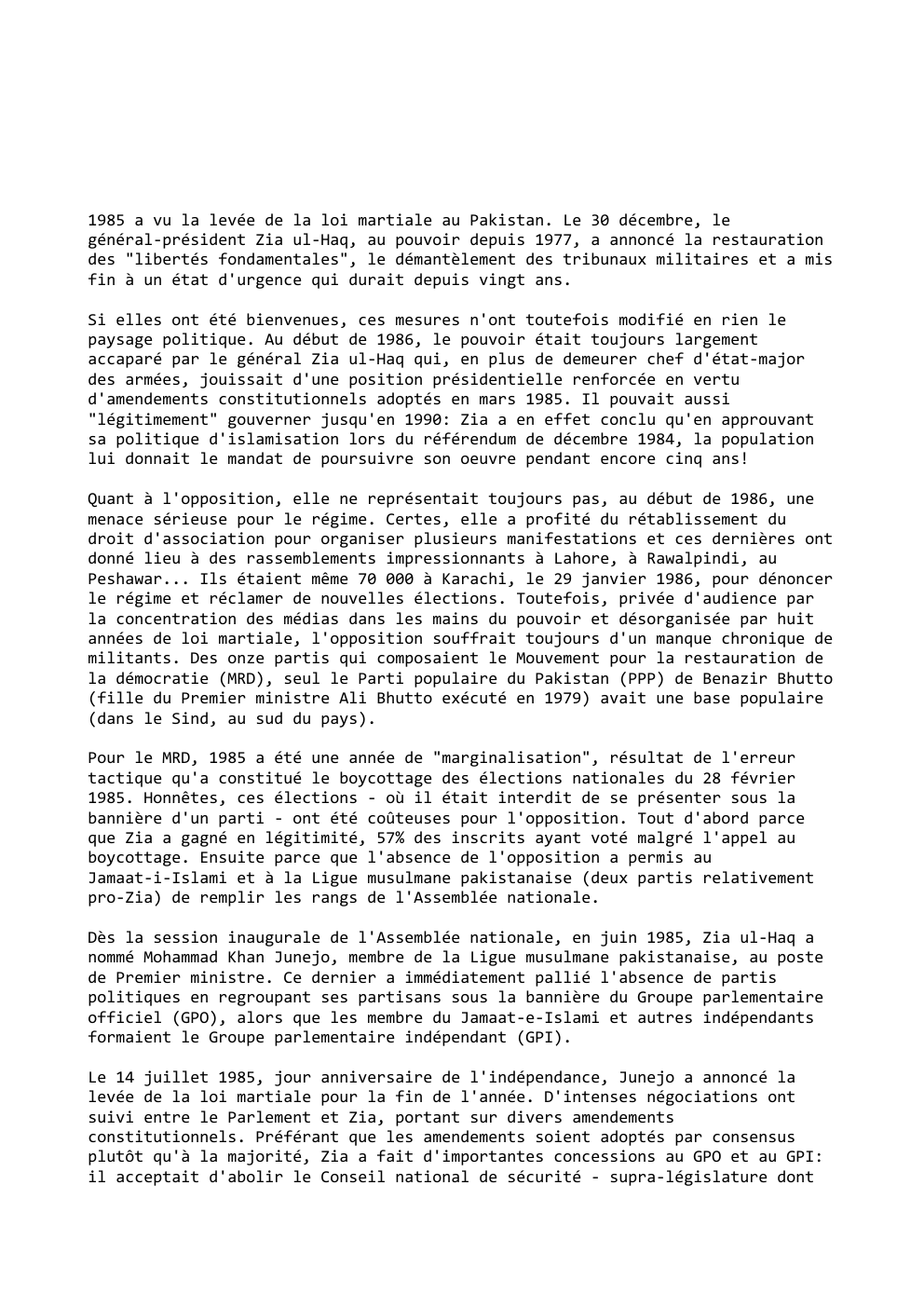1985 a vu la levée de la loi martiale au Pakistan. Le 30 décembre, le général-président Zia ul-Haq, au pouvoir...
Extrait du document
«
1985 a vu la levée de la loi martiale au Pakistan.
Le 30 décembre, le
général-président Zia ul-Haq, au pouvoir depuis 1977, a annoncé la restauration
des "libertés fondamentales", le démantèlement des tribunaux militaires et a mis
fin à un état d'urgence qui durait depuis vingt ans.
Si elles ont été bienvenues, ces mesures n'ont toutefois modifié en rien le
paysage politique.
Au début de 1986, le pouvoir était toujours largement
accaparé par le général Zia ul-Haq qui, en plus de demeurer chef d'état-major
des armées, jouissait d'une position présidentielle renforcée en vertu
d'amendements constitutionnels adoptés en mars 1985.
Il pouvait aussi
"légitimement" gouverner jusqu'en 1990: Zia a en effet conclu qu'en approuvant
sa politique d'islamisation lors du référendum de décembre 1984, la population
lui donnait le mandat de poursuivre son oeuvre pendant encore cinq ans!
Quant à l'opposition, elle ne représentait toujours pas, au début de 1986, une
menace sérieuse pour le régime.
Certes, elle a profité du rétablissement du
droit d'association pour organiser plusieurs manifestations et ces dernières ont
donné lieu à des rassemblements impressionnants à Lahore, à Rawalpindi, au
Peshawar...
Ils étaient même 70 000 à Karachi, le 29 janvier 1986, pour dénoncer
le régime et réclamer de nouvelles élections.
Toutefois, privée d'audience par
la concentration des médias dans les mains du pouvoir et désorganisée par huit
années de loi martiale, l'opposition souffrait toujours d'un manque chronique de
militants.
Des onze partis qui composaient le Mouvement pour la restauration de
la démocratie (MRD), seul le Parti populaire du Pakistan (PPP) de Benazir Bhutto
(fille du Premier ministre Ali Bhutto exécuté en 1979) avait une base populaire
(dans le Sind, au sud du pays).
Pour le MRD, 1985 a été une année de "marginalisation", résultat de l'erreur
tactique qu'a constitué le boycottage des élections nationales du 28 février
1985.
Honnêtes, ces élections - où il était interdit de se présenter sous la
bannière d'un parti - ont été coûteuses pour l'opposition.
Tout d'abord parce
que Zia a gagné en légitimité, 57% des inscrits ayant voté malgré l'appel au
boycottage.
Ensuite parce que l'absence de l'opposition a permis au
Jamaat-i-Islami et à la Ligue musulmane pakistanaise (deux partis relativement
pro-Zia) de remplir les rangs de l'Assemblée nationale.
Dès la session inaugurale de l'Assemblée nationale, en juin 1985, Zia ul-Haq a
nommé Mohammad Khan Junejo, membre de la Ligue musulmane pakistanaise, au poste
de Premier ministre.
Ce dernier a immédiatement pallié l'absence de partis
politiques en regroupant ses partisans sous la bannière du Groupe parlementaire
officiel (GPO), alors que les membre du Jamaat-e-Islami et autres indépendants
formaient le Groupe parlementaire indépendant (GPI).
Le 14 juillet 1985, jour anniversaire de l'indépendance, Junejo a annoncé la
levée de la loi martiale pour la fin de l'année.
D'intenses négociations ont
suivi entre le Parlement et Zia, portant sur divers amendements
constitutionnels.
Préférant que les amendements soient adoptés par consensus
plutôt qu'à la majorité, Zia a fait d'importantes concessions au GPO et au GPI:
il acceptait d'abolir le Conseil national de sécurité - supra-législature dont
la mise sur pied était prévue dans les amendements constitutionnels de mars - et
consentait d'importantes limitations aux pouvoirs du président.
En contrepartie,
l'Assemblée validait tous les gestes commis durant la loi martiale, préparant le
terrain pour la levée de cette dernière.
En s'affirmant devant le président, l'Assemblée a démontré qu'elle jouissait
d'une certaine indépendance et qu'elle pouvait constituer une alternative
valable aux partis traditionnels du MRD.
Cela a évidemment fait le jeu de Zia
ul-Haq qui voulait marginaliser l'opposition, en particulier le PPP dont le
retour au pouvoir pourrait signifier la fin de la suprématie des Pendjabis dans
le gouvernement: constituant 55% de la population, ils occupent 80% des postes
dans l'armée et sont fortement majoritaires à tous les échelons de
l'administration publique.
L'opposition, pour sa part, a contribué à sa marginalisation en refusant de
s'enregistrer officiellement en conformité avec la loi sur les partis
politiques.
La majorité des partis formant le MRD préfèrent de loin le prestige
que leur confère le statut d'opposition extra-parlementaire à une participation
à l'ordre nouveau qui les réduirait à l'insignifiance, en raison de la faiblesse
de leurs appuis électoraux.
D'autant plus que pour être conformes à la loi, les
partis doivent accepter de procéder à des élections internes (le PPP n'en a pas
tenu depuis 1969), publier leur comptes et sont tenus d'adhérer à une clause
antidéfection (un député qui changerait de parti en cours de législature
perdrait automatiquement son siège).
Il va sans dire que le Premier ministre a
déjà fait enregistrer sa Ligue musulmane pakistanaise, composée de la plupart
des parlementaires...
Le parlementaire est donc devenu la nouvelle base de légitimité de Zia, alors
que l'islamisation s'est vue reléguée au second plan.
Cette dernière a longtemps
servi à Zia comme cri de ralliement contre le PPP de Bhutto, trop associé à
l'Occident.
La mise en veilleuse de l'islamisation lui a cependant coûté le
soutien des islamistes, qui constituaient sa seule base de pouvoir, en dehors
des militaires.
Même ralenti, le....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓