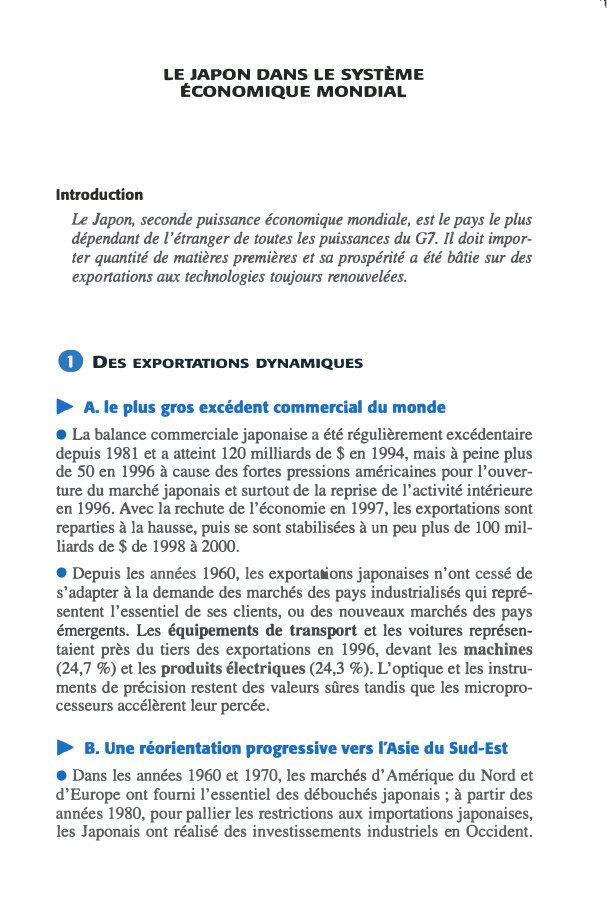7 LE JAPON DANS LE SYSTÈME �CONOMIQUE MONDIAL Introduction Le Japon, seconde puissance économique mondiale, est le pays le plus...
Extrait du document
«
7
LE JAPON DANS LE SYSTÈME
�CONOMIQUE MONDIAL
Introduction
Le Japon, seconde puissance économique mondiale, est le pays le plus
dépendant de l'étranger de toutes les puissances du G7.
Il doit impor
ter quantité de matières premières et sa prospérité a été bâtie sur des
exportations aux technologies toujours renouvelées.
0
►
DES EXPORTATIONS DYNAMIQUES
A.
le plus gros excédent commercial du monde
• La balance commerciale japonaise a été régulièrement excédentaire
depuis 1981 et a atteint 120 milliards de$ en 1994, mais à peine plus
de 50 en 1996 à cause des fortes pressions américaines pour l'ouver
ture du marché japonais et surtout de la reprise de l'activité intérieure
en 1996.
Avec la rechute de l'économie en 1997, les exportations sont
reparties à la hausse, puis se sont stabilisées à un peu plus de 100 mil
liards de$ de 1998 à 2000.
• Depuis les années 1960, les exportations japonaises n'ont cessé de
s'adapter à la demande des marchés des pays industrialisés qui repré
sentent l'essentiel de ses clients, ou des nouveaux marchés des pays
émergents.
Les équipements de transport et les voitures représen
taient près du tiers des exportations en 1996, devant les machines
(24,7 %) et les produits électriques (24,3 %).
L'optique et les instru
ments de précision restent des valeurs sûres tandis que les micropro
cesseurs accélèrent leur percée.
►
B.
Une réorientation progressive vers l'Asie du Sud-Est
• Dans les années 1960 et 1970, les marchés d'Amérique du Nord et
d'Europe ont fourni l'essentiel des débouchés japonais; à partir des
années 1980, pour pallier les restrictions aux importations japonaises,
les Japonais ont réalisé des investissements industriels en Occident.
• Depuis 1990, avec le développement de l'Asie du Sud-Est, les
investissements japonais se sont réorientés vers cette partie du
monde, au détriment de l'Europe, tout en restant très importants aux
États-Unis.
Le Japon profite d'une main-d'œuvre bon marché et a
délocalisé soit des biens d'équipement ou des constructions automo
biles (Thai1ande, Malaisie), soit des biens de consommation comme
le textile ou les jouets (Chine, Indonésie).
e
►
DES IMPORTATIONS EN FORTE CROISSANCE
A.
Un marché longtemps fermé aux exportateurs étrangers
• Les excédents du commerce extérieur nippon doivent beaucoup
aux difficultés qu'ont les exportateurs étrangers à pénétrer le marché
japonais : les normes, notamment, y sont très strictes.
• Ces difficultés ont créé de nombreuses frictions avec l'Union euro
péenne et les États-Unis qui ont pris des mesures de rétorsion ; les
importations d'automobiles japonaises ont été contingentées dans
plusieurs pays européens et aux États-Unis.
Usant de leur force, les
Etats-Unis ont essayé d'imposer une ouverture forcée du marché
japonais pour des produits stratégiques comme l'automobile, les
microprocesseurs ou les ordinateurs, ou de simples produits agricoles.
►
B.
1:essor des importations
• Le Japon a une balance commerciale régulièrement déficitaire
avec les fournisseurs de produits bruts (voir carte, p.
143): les pays
du Golfe et l'Indonésie (hydrocarbures), l'Australie (minerais), le Brésil
ou la Nouvelle-Zélande (produits agricoles).
• Le Japon a une balance relativement équilibrée avec plusieurs
pays européens, dont la Suisse et l'Italie qui lui vendent des produits
de luxe (montres, haute couture, vins, parfums).
• Le plus gros excédent commercial japonais repose sur les États
Unis qui lui achètent des produits de consommation ou d'équipement
de toute nature mais ne réussissent guère à lui vendre leurs produc
tions en dehors de l'aéronautique, de l'informatique et des produits
alimentaires ; les États-Unis ont notamment réussi à forcer le marché
japonais du riz.
0
►
UN REDÉPLOIEMENT EN AslE
A.
Les délocalisations s'accélèrent
• Les grandes entreprises industrielles japonaises sont désormais à la
recherche d'une main-d'œuvre moins coûteuse pour leurs fabrica
tions les moins complexes ou pour des activités de montage à partir
de pièces fabriquées au Japon.
Leurs investissements industriels à
l'étranger ont représenté en 1995 près de 50 milliards de $.
• Les délocalisations représentent maintenant près de 9 % de la pro
duction industrielle des sociétés japonaises (contre 25 % pour les
sociétés américaines).
• Les plus grandes sociétés japonaises, comme Toyota dans l'automo
bile, ont désormais une stratégie de marché global; il s'agit de pro
duire au meilleur coût et de pouvoir transférer les productions d'un État
à l'autre en fonction de l'évolution des marchés locaux, du prix et de la
compétence de la main-d'œuvre, des fluctuations monétaires.
►
B.
Les conséquences des délocalisations pour le Japon
• Les délocalisations amènent des suppressions d'emploi.
Des
dizaines de milliers d'emplois textiles, dans les petites entreprises
sous-traitantes, ont été supprimés pour être transférés en Chine.
• Si les délocalisations s'accroissent, les Japonais veillent cependant
à garder au Japon les productions les plus sophistiquées qui corres
pondent aux emplois les plus qualifiés.
Conclusion
L'interdépendance entre les diverses économies des pays industrialisés et....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓