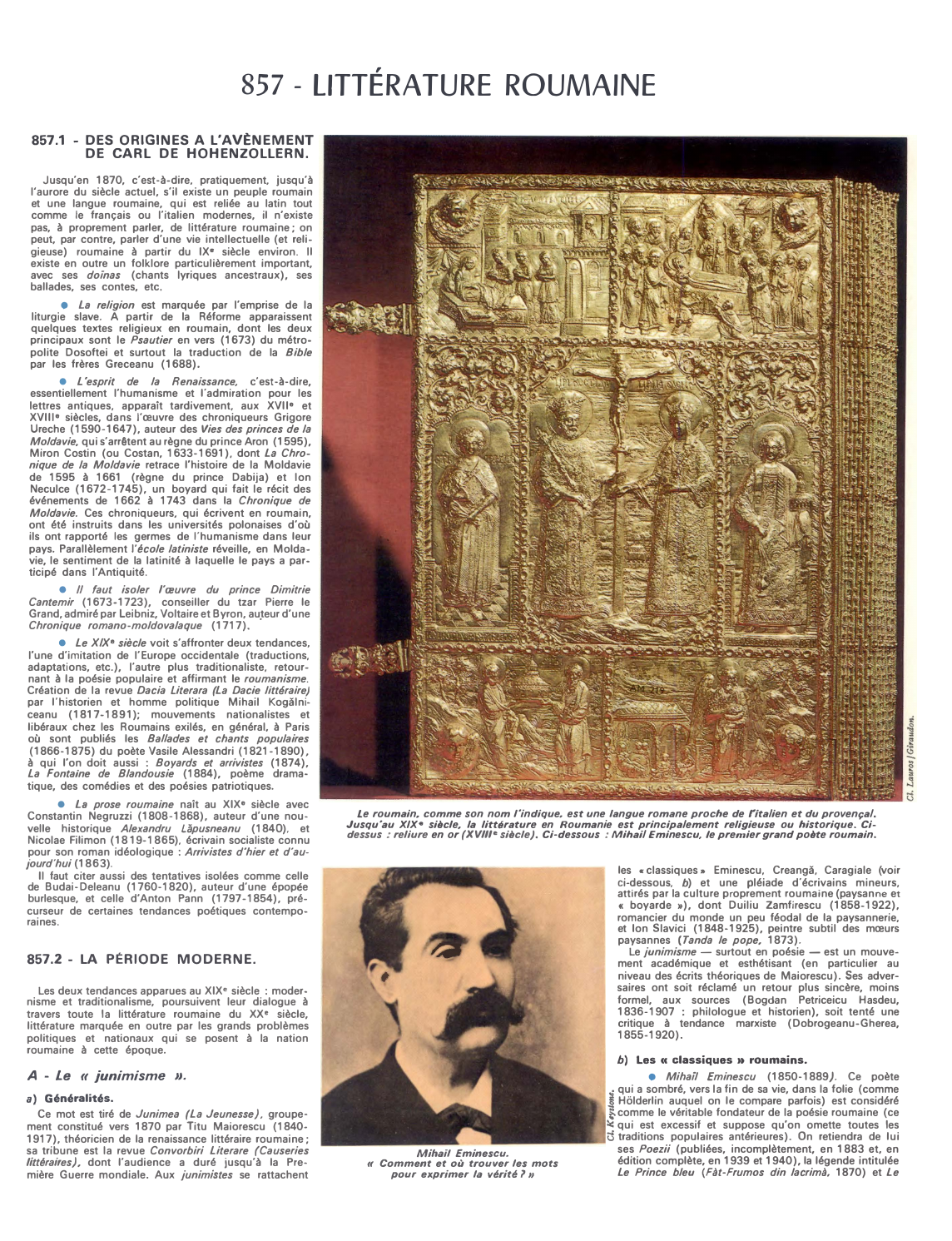857 - LITTÉRATURE ROUMAINE 857.1 - DES ORIGINES A L'AV�NEMENT DE CARL DE HOHENZOLLERN. Jusqu'en 1870, c'est-à-dire. pratiquement, jusqu'à l'aurore...
Extrait du document
«
857 - LITTÉRATURE ROUMAINE
857.1 - DES ORIGINES A L'AV�NEMENT
DE CARL DE HOHENZOLLERN.
Jusqu'en 1870, c'est-à-dire.
pratiquement, jusqu'à
l'aurore du siècle actuel, s'il existe un peuple roumain
et une langue roumaine, qui est reliée au latin tout
comme le français ou l'italien modernes, il n'existe
pas, à proprement parler, de littérature roumaine; on
peut, par contre, parler d'une vie intellectuelle (et reli
gieuse) roumaine à partir du IX• siècle environ.
Il
existe en outre un folklore particulièrement important,
avec ses doinas (chants lyriques ancestraux), ses
ballades, ses contes, etc.
• la religion est marquée par l'emprise de la
liturgie slave.
A partir de la Réforme apparaissent
quelques textes religieux en roumain, dont les deux
principaux sont le Psautier en vers (1673) du métro
polite Dosoftei et surtout la traduction de la Bible
par les frères Greceanu (1688).
• l'esprit de la Renaissance, c'est-à-dire,
essentiellement l'humanisme et l'admiration pour les
lettres antiques, apparaît tardivement, aux XVII• et
XVIII• siècles, dans l'œuvre des chroniqueurs Grigore
Ureche (1590-1647), auteur des Vies des princes de la
Moldavie.
qui s'arrêtent au règne du prince Aron (1595),
Miron Costin (ou Costan, 1633-1691), dont la Chro
nique de la Moldavie retrace l'histoire de la Moldavie
de 1595 à 1661 (règne du prince Dabija) et Ion
Neculce (1672-1745), un boyard qui fait le récit des
événements de 1662 à 1743 dans la Chronique de
Moldavie.
Ces chroniqueurs.
qui écrivent en roumain,
ont été instruits dans les universités polonaises d'où
ils ont rapporté les germes de l'humanisme dans leur
pays.
Parallèlement l'école latiniste réveille, en Molda
vie, le sentiment de la latinité à laquelle le pays a par
ticipé dans !'Antiquité.
• Il faut isoler /'œuvre du prince Dimitrie
Cantemir (1673-1723), conseiller du tzar Pierre le
Grand, admiré par Leibniz, Voltaire et Byron, auJeur d'une
Chronique romano-moldovalaque (1717).
• le XIX• siècle voit s'affronter deux tendances,
l'une d'imitation de l'Europe occidentale (traductions,
adaptations, etc.), l'autre plus traditionaliste, retour
nant à la poésie populaire et affirmant le roumanisme.
Création de la revue Dacia Literara (la Dacie littéraire)
par l'historien et homme politique Mihail Kogalni
ceanu (1817-1891); mouvements nationalistes et
libéraux chez les Roumains exilés, en général, à Paris
où sont publiés les Ballades et chants populaires
(1866-1875) du poète Vasile Alessandri (1821-1890),
à qui l'on doit aussi : Boyards et arrivistes (1874),
la Fontaine de Blandousie (1884), poème drama
tique, des comédies et des poésies patriotiques.
• la prose roumaine naît au XIX• siècle avec
Constantin Negruzzi (1808-1868), auteur d'une nou
velle historique Alexandru Lapusneanu (1840).
et
Nicolae Filimon (18 19-1865).
écrivain socialiste connu
pour son roman idéologique : Arrivistes d'hier et d'au
jourd'hui (1863).
Il faut citer aussi des tentatives isolées comme celle
de Budai-Deleanu (1760-1820), auteur d'une épopée
burlesque, et celle d'Anton Pann (1797-1854), pré
curseur de certaines tendances poétiques contempo
raines.
Le roumain, comme son nom l'indique, est une langue romane proche de ritalien et du provençal.
Jusqu'au XIX• siècle, la littérature en Roumanie est principalement religieuse ou historique.
Ci
dessus : reliure en or (XVIII• siècle).
Ci-dessous : Mihail Eminescu, le premier grand poète roumain.
les «classiques,.
Eminescu, Creanga, Caragiale (voir
ci-dessous.
b) et une pléiade d'écrivains mineurs,
attirés par la culture proprement roumaine (paysanne et
« boyarde »), dont Duiliu Zamfirescu (1858-1922),
romancier du monde un peu féodal de la paysannerie,
et Ion Slavici (1848-1925), peintre subtil des mœurs
paysannes (Tanda le pope, 1873).
Le junimisme - surtout en poésie - est un mouve
ment académique et esthétisant (en particulier au
niveau des écrits théoriques de Maiorescu).
Ses adver
saires ont soit réclamé un retour plus sincère, moins
formel, aux sources ( Bogdan Petriceicu Hasdeu,
1836-1907 : philologue et historien), soit tenté une
critique à tendance marxiste (Dobrogeanu-Gherea,
1855-1920).
857.2 - LA PÉRIODE MODERNE.
Les deux tendances apparues au XIX• siècle : moder
nisme et traditionalisme, poursuivent leur dialogue à
travers toute la littérature roumaine du XX• siècle,
littérature marquée en outre par les grands problèmes
politiques et nationaux qui se posent à la nation
roumaine à cette époque.
A
-
Le
«
b) Les« classiques» roumains.
junimisme "·
a) Généralités.
Ce mot est tiré de Junimea ( la Jeunesse).
groupe
ment constitué vers 1870 par Titu Maiorescu (18401917), théoricien de la renaissance littéraire roumaine;
sa tribune est la revue Convorbiri literare (Causeries
littéraires), dont l'audience a duré jusqu'à la Pre
mière Guerre mondiale.
Aux junimistes se rattachent
Mihail Eminescu.
« Comment et où trouver les mots
pour exprimer la vérité 7 ,,
• Mihail Eminescu (1850-1889).
Ce poète
qui a sombré, vers la fin de sa vie, dans la folie (comme
�
o Hôlderlin auquel on le compare parfois) est considéré
îcomme le véritable fondateur de la poésie roumaine (ce
::-: qui est excessif et suppose qu'on omette toutes les
d traditions populaires antérieures).
On retiendra de lui
ses Poezii (publiées, incomplètement, en 1883 et, en
édition complète, en 1939 et 1940), la légende intitulée
le Prince bleu (Fàt-Frumos din lacrimà, 1870) et le
B - La littérature roumaine
du junimisme à 1940.
a) Avant la Première Guerre mondiale.
• Tendance folklorique et rustique représentée
par les poètes Alexandru Vlahuta (1858-1919),
Gheorghe Co!?buc (1866-1918) et l'historien Nicolae
Iorga (ou Jorga, 1871-1940) animateur de la revue
Le Semeur (Samanatorul) qui correspond à cette ten
dance; on la retrouve chez le romancier et critique
Constantin Stere (1865-1936), alliée aux doctrines
du progrès politique (par la démocratie).
• Tendance moderniste, inspirée par le symbo
lisme français.
Elle est défendue par les poètes de la
revue Le Littérateur (Literatorul), dirigée par Alexandru
Macedonski, et de La Vie nouvelle (Viata Noua): Den
susianu (1873-1938), Anghel (1872-1914), Petica
(1877 -1904).
• En fait.
modernisme et traditionalisme coexis
tent chez Barbu $tefanescu Delavrancea (1858-19 1 9,
Calistrat Hogas (1847-1917), etc.
b) Entre les deux guerres.
• Les courants intellectuels d'Europe occidentale
ont définitivement droit de cité.
Le plus grand dyna
s,: miteur de la poésie mondiale est un Roumain exilé :
ù Tristan Tzara, l'incarnation de Dada (voir 846.2, D).
De treize ans son ainé, Urmuz (1883-1923), injus
Ion Creanga (1837-1889).
tement méconnu hors de sa patrie, est un " sur
Ses récits «terriens» et goguenards font
réaliste " avant la lettre.
La• critique et la philosophie
du paysan roumain (Le père Nikifor le Rou
roumaines d'inspiration moderniste sont représentées
blard) la vraie valeur humaine, par contraste
par E.
Lovinescu (1881-1943), Paul Zarifopol (1875avec la civilisation urbaine.
1934), Perpessicius (qui a édité Eminescu; né en
1891 ), etc.; ils ont pour adversaire Nicolae Iorga, déjà
Pauvre Denis (Sàrmanul Dionis, 1872), récit en
cité.
Noms des principaux philosophes roumains :
prose où sont concentrés les principaux thèmes poé Lucian Blaga (1895 -1961 ), dont Iorga avait écrit,
tiques d'Eminescu : la circulation entre le réel et l'ima lors de la publication de son....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓