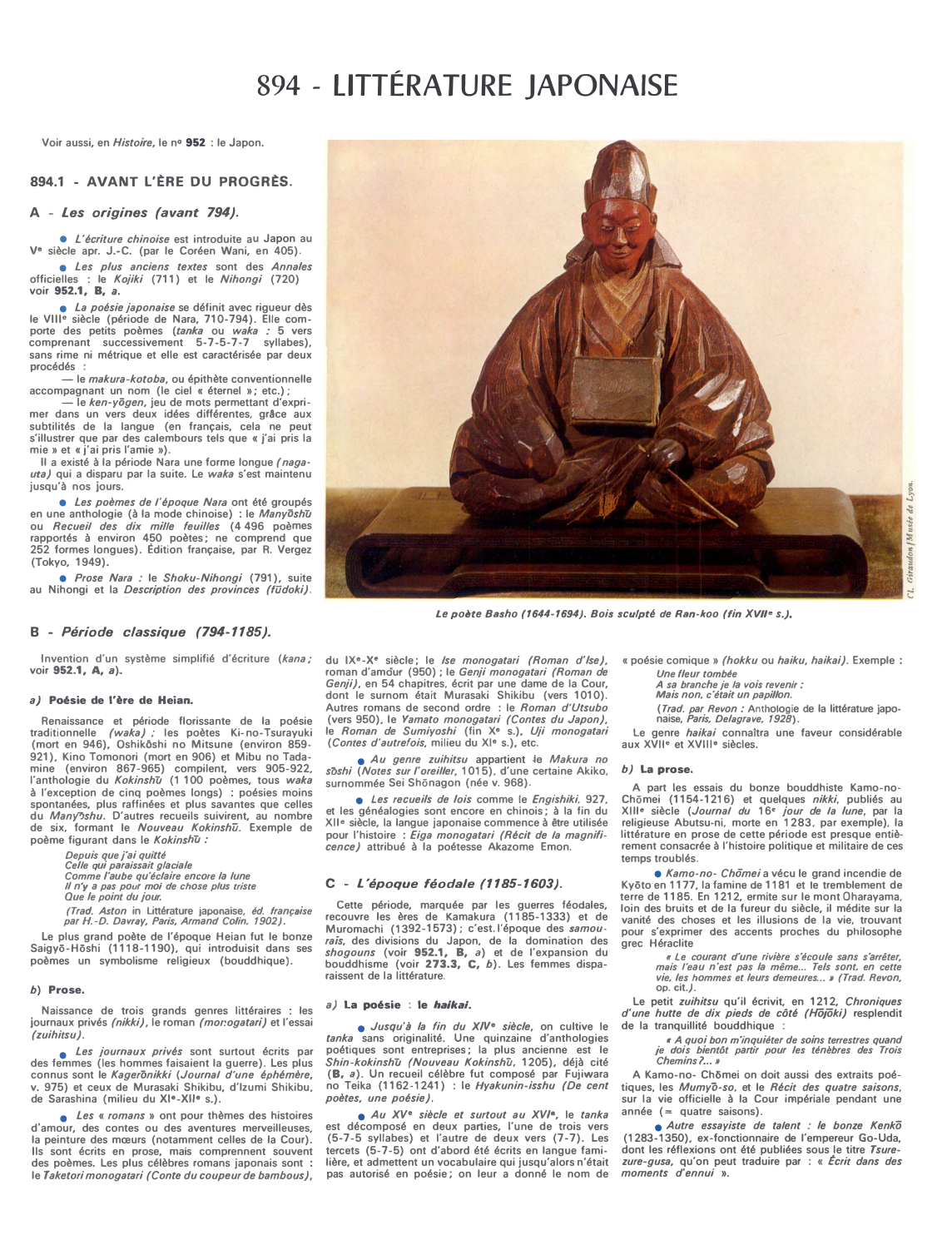894 - LITTÉRATURE JAPONAISE Voir aussi, en Histoire, le n° 952 : le Japon. 894.1 - AVANT L'ÈRE DU PROGRÈS....
Extrait du document
«
894 - LITTÉRATURE JAPONAISE
Voir aussi, en Histoire, le n° 952 : le Japon.
894.1 - AVANT L'ÈRE DU PROGRÈS.
A - Les origines (avant 794).
• l'écriture chinoise est introduite au Japon au
ve siècle apr.
J.-C.
(par le Coréen Wani, en 405).
• les plus anciens textes sont des Annales
officielles : le Kojiki (711) et le Nihongi (720)
voir 952.1, B, a.
• la poésie japonaise se définit avec rigueur dès
le VIII e siècle (période de Nara, 710-794).
Elle com
porte des petits poèmes (tanka ou waka : 5 vers
comprenant successivement 5-7-5-7-7 syllabes),
sans rime ni métrique et elle est caractérisée par deux
procédés :
- le makura-kotoba, ou épithète conventionnelle
accompagnant un nom (le ciel « éternel »; etc.);
- le ken-yôgen, jeu de mots permettant d'expri
mer dans un vers deux idées différentes, grâce aux
subtilités de la langue (en français, cela ne peut
s'illustrer que par des calembours tels que « j'ai pris la
mie» et« j'ai pris l'amie»).
Il a existé à la période Nara une forme longue (naga
uta) qui a disparu par la suite.
Le waka s'est maintenu
jusqu'à nos jours.
• les poèmes de l'époque Nara ont été groupés
en une anthologie (à la mode chinoise) : le Manyôshü
ou Recueil des dix mille feuilles (4 496 poèmes
rapportés à environ 450 poètes; ne comprend que
252 formes longues).
Édition française, par R.
Vergez
(Tokyo, 1949).
• Prose Nara : le Shoku-Nihongi (791).
suite
au Nihongi et la Description des provinces (füdoki).
Le poète Basho (1644-1694).
Bois sculpté de Ran-koo (fin XV/les.).
B - Période classique (794-1185).
Invention d'un système simplifié d'écriture (kana;
voir 952.1, A, a).
a) Poésie de l'ère de Heian.
Renaissance et période florissante de la poésie
traditionnelle (waka); les poètes Ki- no-Tsurayuki
(mort en 946), Oshikôshi no Mitsune (environ 859921).
Kino Tomonori (mort en 906) et Mibu no Tada
mine (environ 867-965) compilent.
vers 905-922.
l'anthologie du Kokinshü (1 100 poèmes, tous waka
à l'exception de cinq poèmes longs) : poésies moins
spontanées.
plus raffinées et plus savantes que celles
du Man'/7)shu.
D'autres recueils suivirent, au nombre
de six, formant le Nouveau Kokinshü.
Exemple de
poème figurant dans le Kokinshü :
Depuis que fai quitté
Celle qui paraissait glaciale
Comme /'aube qu'éclaire encore la lune
Il n'y a pas pour moi de chose plus triste
Que le point du jour.
(Trad.
Aston in Littérature japonaise, éd.
française
par H.-D.
Davray, Paris, Armand Colin.
1902).
Le plus grand poète de l'époque Heian fut le bonze
Saigyo-Hoshi (1118-1190).
qui introduisit dans ses
poèmes un symbolisme religieux (bouddhique).
du IX•-x e siècle; le Ise monogatari (Roman d'lse), « poésie comique» (hokku ou haiku, haikai).
Exemple :
roman d'amôur (950); le Genji monogatari (Roman de
Une fleur tombée
Genji).
en 54 chapitres, écrit par une dame de la Cour,
A sa branche je la vois revenir :
non.
c'était un papillon.
Mais
dont le surnom était Murasaki Shikibu (vers 1010).
Autres romans de second ordre : le Roman d'Utsubo
(Trad.
par Revon : Anthologie de la littérature japo
naise, Paris, Delagrave, 1928).
(vers 950).
le Yamato monogatari (Contes du Japon).
le Roman de Sumiyoshi (fin X• s.).
Uji monogatari
Le genre haikai connaîtra une faveur considérable
(Contes d'autrefois.
milieu du XI• s.).
etc.
aux XVJJe et XVIII• siècles.
• Au genre zuihitsu appartient fo Makura no
sôshi (Notes sur /'oreiller, 1015), d'une certaine Akiko, b) La prose.
surnommée Sei Shonagon (née v.
968).
A part les essais du bonze bouddhiste Kamo-no
• les recueils de lois comme le Engishiki.
927,
et les généalogies sont encore en chinois; à la fin du
XII e siècle, la langue japonaise commence à être utilisée
pour l'histoire : Eiga monogatari (Récit de la magnifi
cence) attribué à la poétesse Akazome Emon.
C - L'époque féodale (1185-1603).
Cette période, marquée par les guerres féodales,
recouvre les ères de Kamakura (1185-1333) et de
Muromachi (1392-1573); c'est.
l'époque des samou
raïs.
des divisions du Japon, de la domination des
shogouns (voir 952.1, B, a) et de l'expansion du
bouddhisme (voir 273.3, C, b).
Les femmes dispa
raissent de la littérature.
b) Prose.
Naissance de trois grands genres littéraires : les
journaux privés (nikki), le roman (mor.ogatari) et l'essai
(zuihitsu).
• les journaux privés sont surtout écrits par
des femmes (les hommes faisaient la guerre).
Les plus
connus sont le Kageronikki (Journal d'une éphémère,
v.
975) et ceux de Murasaki Shikibu, d'lzumi Shikibu,
de Sarashina (milieu du Xl•-XII• s.).
• les « romans » ont pour thèmes des histoires
d'amour, des contes ou des aventures merveilleuses.
la peinture des mœurs (notamment celles de la Cour).
Ils sont écrits en prose, mais comprennent souvent
des poèmes.
Les plus célèbres romans japonais sont :
le Taketori monogatari (Conte du coupeur de bambous).
a) La poésie : le haikal.
• Jusqu'à la fin du XN• siècle, on cultive le
tanka sans originalité.
Une quinzaine d'anthologies
poétiques sont entreprises; la plus ancienne est le
Shin-kokinshü (Nouveau Kokinshü.
1205), déjà cité
(8, a).
Un recueil célèbre fut composé par Fujiwara
no Teika (1162-1241) : le Hyakunin-isshu (De cent
poètes, une poésie).
• Au XV 8 siècle et surtout au XVI•, le tanka
est décomposé en deux parties, l'une de trois vers
(5-7-5 syllabes) et l'autre de deux vers (7-7).
Les
tercets (5-7-5) ont d'abord été écrits en langue fami
lière, et admettent un vocabulaire qui jusqu'alors n'était
pas autorisé en poésie; on leur a donné le nom de
Chomei (1154-1216) et quelques nikki, publiés au
XJll e siècle (Journal du 16• jour de la lune, par la
religieuse Abutsu-ni, morte en 1 283, par exemple), la
littérature en prose de cette période est presque entiè
rement consacrée à l'histoire politique et militaire de ces
temps troublés.
• Kamo-no- ChiJmei a vécu le grand incendie de
Kyoto en 1177.
la famine de 1181 et le tremblement de
terre de 1185.
En 1212, ermite sur le mont Oharayama,
loin des bruits et de la fureur du siècle, il médite sur la
vanité des choses et les illusions de la vie, trouvant
pour s'exprimer des accents proches du philosophe
grec Héraclite
11 Le courant d'une rivière s'écoule sans s'arrêter,
mais l'eau n'est pas la même...
Tels sont, en cette
vie.
les hommes et leurs demeures...
11 (Trad.
Revon,
op.
cit.).
Le petit zuihitsu qu'il écrivit, en 1212, Chroniques
d'une hutte de dix pieds de côté (Hojoki) resplendit
de la tranquillité bouddhique :
,r A quoi bon m'inquiéter de soins terrestres quand
je dois bientôt partir pour les ténèbres des Trois
Chemins?...
11
A Kamo-no- Chômei on doit aussi des extraits poé
tiques, les Mumyo-so, et le Récit des quatre saisons,
sur la vie officielle à la Cour impériale pendant une
année ( = quatre saisons).
• Autre essayiste de talent : le bonze Kenko
(1283-1350).
ex-fonctionnaire de l'empereur Go-Uda,
dont les réflexions ont été publiées sous le titre Tsure
zure-gusa, qu'on peut traduire par : « tcrit dans des
moments d'ennui ».
• Quant à l'histoire, genre majeur, en voici les
principaux titres.
Titre
Hagen monogatari
(Récit de l'ère
Hagen)
Hsiji monogatari
(Récit de l'ère
Hsiji)
Auteur
et date
Attribué à
Hamuro
Tokinaga
(XII• s.)
id.
b) La prose : pour ou contre le chinois.
Commentaire
1
Récit des guerres (civiles)
de succession en 1157.
Récit des guerres civiles
de 1159.
Guerre entre les Gen (clan
Gempei-seisuiki
1 •• moitié
Minamoto, voir 952.1,
(Grandeur BI Dtfca- du XIII• s.
dsnce des Gen et Auteur inconnu.
B, a) et les Hei (clan
Taira) entre 1161 et 1185,
des Hei)
Heiks monogatari
(Geste de la famille
des Hei)
Azuma-kagami
(Miroir de l'Est)
Taikeiki
(La Grande Paix)
Jinna-shatoki
(Succession des
divins empereurs).
id.
En chinois;
XIII• s.
Attribué au
bonze Kojima
(mort en 1374);
mélange de chinois et de japonais, de prose et
de vers.
Kitabatake
Chikapusa
(1293-1354);
compilé entre
1239 et 1245.
·
j
vue du côté des Mina
moto.
Idem, mais on a ici l'opi
nion des Taira.
f.,
.....
.:i
Î
Chronique shogounale
pour la période 11801266.
Chronique pour la période
1192 (Yoritomo Mina
moto, shogoun)-1368.
Plus spécialement orienté
vers les guerres de la
période dite « des Cours
du Sud et du Nord •• qui
ont débuté en 1366.
Histoire du Japon depuis
ses origines légendaires,
tendant à souligner la
légitimité de la dynastie
du Sud.
Les principaux ouvrages historiques
entre le XII• et le XIV• siècle.
c) Le no.
Le no est le nom du drame lyrique (opéra) japonais.
Il existe différentes théories sur l'origine du no (origine
sacrée : le no dériverait de danses religieuses auxquelles
se seraient ajoutés chant et musique; origine chinoise
le no imitation des divertissements dramatiques en
honneur chez les Chinois).
Les caractères du no
sont les suivants :
• Pièce à deux (ou trois) personnages soutenus
par un chœur (une dizaine de choreutes) qui com
mente !"action, accompagné par un petit orchestre
(fl0te traversière, tambour, tambourin).
Comparer
avec la tragédie grecque (voir 872.2, A).
• Le thème est d'inspiration religieuse; il est
développé d'une façon poétique (utilisation presque
systématique du makura-kotoba et du ken-yogen;
voir ci-dessus, A).
Langue érudite hermétique.
• La dramaturgie est rituelle et symbolique.
Il
n'y a pas de femmes en scène et les acteurs sont mas
qués.
Importance de la danse.
Un spectacle comprend l'exécution de plusieurs
drames (un no ne dure pas plus d'une heure).
Entre
chaque no on intercale une courte farce ou kyogen.
Le répertoire des nô - qui sont aujourd'hui encore
représentés - comporte quelque 250 drames.
D - Diffusion et vulgarisation
de la littérature (1603-1868).
Pendant la période dite de Yedo (1603-1868),
sous les shogouns de la famille Tokugawa, le Japon
connait la paix, la prospérité, et se ferme totalement
aux étrangers (sauf aux Chinois).
Le développement
de l'imprimerie, à la fin du XVIe siècle, permet la diffu
sion de la culture, qui n'est plus l'apanage des grands
féodaux (et des bonzes).
On assiste donc à la naissance
et au développement d'une littérature populaire, déca
dente selon les tenants du classicisme, riche et vivante
pour les partisans du progrès.
a) La poésie : triomphe du haikai.
• Le tanka était devenu un genre fossile.
Les
poètes de l'ère Yedo montrèrent qu'ils pouvaient décrire
autre chose que la chute des feuilles en automne : la
J
:il:
...:.
;j
Masque de nl).
faim ou la colère par exemple.
Il est illustré par Kamo
.no Mabuchi (1697-1769), Je bonze Ryôkan (17571831), Okuma Kotomichi (1798-1868), Tachibana
Akemi (1812-1868).
• Mais la genre par excellence.
c'est le haikai
(voir ci-dessus, C, a), dont le plus grand maitre fut
Matsuo Bashêi (1643-1694), un doux bouddhiste
voyageur,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓