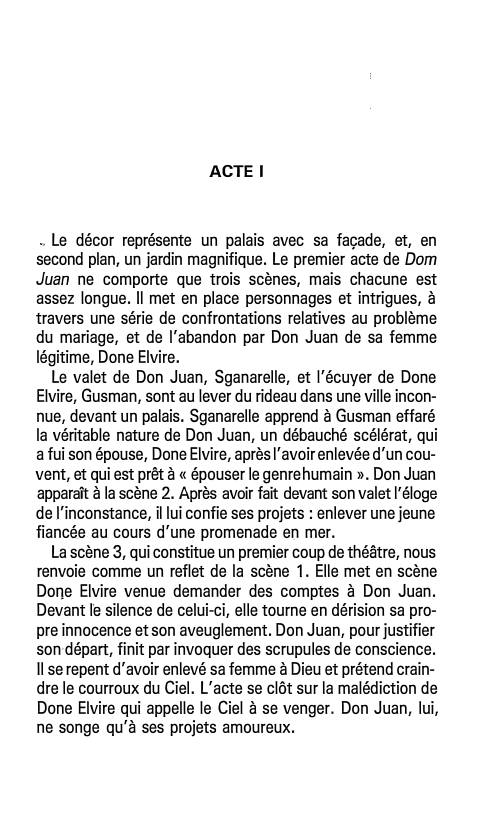ACTEI Le décor représente un palais avec sa façade, et, en second plan, un jardin magnifique. Le premier acte de...
Extrait du document
«
ACTEI
Le décor représente un palais avec sa façade, et, en
second plan, un jardin magnifique.
Le premier acte de Dom
Juan ne comporte que trois scènes, mais chacune est
assez longue.
Il met en place personnages et intrigues, à
travers une série de confrontations relatives au problème
du mariage, et de l'abandon par Don Juan de sa femme
légitime, Done Elvire.
Le valet de Don Juan, Sganarelle, et l'écuyer de Done
Elvire, Gusman, sont au lever du rideau dans une ville incon
nue, devant un palais.
Sganarelle apprend à Gusman effaré
la véritable nature de Don Juan, un débauché scélérat, qui
a fui son épouse, Done Elvire, après l'avoir enlevée d'un cou
vent, et qui est prêt à« épouser le genre humain ».
Don Juan
apparaît à la scène 2.
Après avoir fait devant son valet l'éloge
de l'inconstance, il lui confie ses projets : enlever une jeune
fiancée au cours d'une promenade en mer.
La scène 3, qui constitue un premier coup de théâtre, nous
renvoie comme un reflet de la scène 1.
Elle met en scène
Done Elvire venue demander des comptes à Don Juan.
Devant le silence de celui-ci, elle tourne en dérision sa pro
pre innocence et son aveuglement.
Don Juan, pour justifier
son départ, finit par invoquer des scrupules de conscience.
Il se repent d'avoir enlevé sa femme à Dieu et prétend crain
dre le courroux du Ciel.
L'acte se clôt sur la malédiction de
Done Elvire qui appelle le Ciel à se venger.
Don Juan, lui,
ne songe qu'à ses projets amoureux.
ACTE 1, SCÈNE 1
(SGANARELLE, GUSMAN)
l;J:J.ilh'III
Sganarelle s'entretient avec Gusman.
La pièce s'ouvre sur
un éloge burlesque du tabac.
Après cet intermède, Sgana
relle reprend le fil d'une conversation commencée précédem
ment.
Done Elvire, follement éprise de son époux, s'est mise
« en campagne» à sa recherche, surprise de son départ pré
cipité.
Sganarelle laisse entendre à Gusman qu'il doute de
l'efficacité de cette démarche, et devant les questions de
plus en plus pressantes de son interlocuteur, il dévoile à demi
mots le véritable caractère de son maître.
Gusman, ébranlé,
mais pas encore convaincu, évoque alors la toute récente
passion de Don Juan pour sa maîtresse: n'a-t-il pas, à force
de soupirs, de larmes, de lettres, de serments répétés, arra
ché Elvire à« l'obstacle sacré d'un couvent» ? Comment
après cela pourrait-il manquer à ses engagements ? Sgana
relle se livre alors, dans une longue tirade, à un portrait en
pied de son maître.
Certes la trahison de Done Elvire n'est pas encore con
sommée et Don Juan ne lui a encore rien dévoilé, mais celui
ci est « le plus grand scélérat que la terre ait porté».
Le
mariage, pour lui, n'est qu'un piège « pour attraper les bel
les» de toute condition, dont les noms sont déjà si nom
breux que l'énumération en durerait jusqu'au soir.
Devant
la réaction atterrée et muette de Gusman, Sganarelle achève
le portrait en annonçant que le Ciel châtiera un jour ce terri
ble maître qu'il sert en dépit de sa répugnance.
Survient alors
Don Juan, et Sganarelle avertit Gusman qu'il le désavouera
s'il révèle un mot de l'entretien.
Un éloge codé du tabac
La pièce commence par un hors-d'œuvre : un éloge codé du tabac,
nouvelle drogue à la mode, introduite en Europe par les Espagnols et
les Portugais au XVI• siècle, déconseillée par les dévots.
Il est à la fois
l'occasion d'un jeu de scène, d'un jeu parodique, et d'une allégorie
cachée du libertinage.
Un jeu de scène : Sganarelle répond sans doute à une offre obli
geante de Gusman ; la pièce commence ainsi sous le signe de
l'échange, ici du tabaç, plus tard des femmes.
Un jeu parodique : Molière reprend ici la tradition de l'éloge burles
que, qui remonte à !'Antiquité, et que Molière avait dû pratiquer dans
ses études au Collège Louis-le-grand : l'éloge du miroir, d'Apulée
(Il• siècle ap.
J.-Cl,l'éloge de la folie, d'Érasme (XVI' siècle), relèvent
entre autres exemples, de cette tradition.
Allégorie du libertinage : si l'on remplace le mot tabac par le mot
plaisir, on a la définition du libertinage.
En effet, l'éloge du tabac par
Sganarelle ressemble singulièrement à celui de l'inconstance par Don
Juan (cf.
l,2).
Tout comme Sganarelle «est ravi d'en donner [du tabac]
à droite et à gauche»,de même, Don Juan s'avère incapable de refu
ser son cœur «à tout ce [qu'il voit] d'aimable».
Chez l'un comme chez
l'autre,le plaisir réside plus dans la quête perpétuelle que dans l'objet
même.
On peut donc considérer que le plaisir du tabac est à Sgana
relle ce que le plaisir des sens est à Don Juan.
Une scène d'exposition
Avec son habileté coutumière, Molière nous donne l'état de l'intri
gue au lever du rideau et le portrait du personnage principal avant que
celui-ci n'apparaisse.
Mais au contraire de Tartuffe,qui n'apparaît qu'à
l'acte Ill, Don Juan apparaît dès la scène 2 de l'acte 1.
L'intrigue : Don Juan, flanqué de son valet, a fui dans une autre
ville son épouse légitime, à qui il avait fait une cour ·ardente avant de
l'enlever.
S'esquisse ici une sorte de roman précieux•,avec homma
ges multiples, lettres passionnées, serments, et enlèvement d'un
couvent.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓