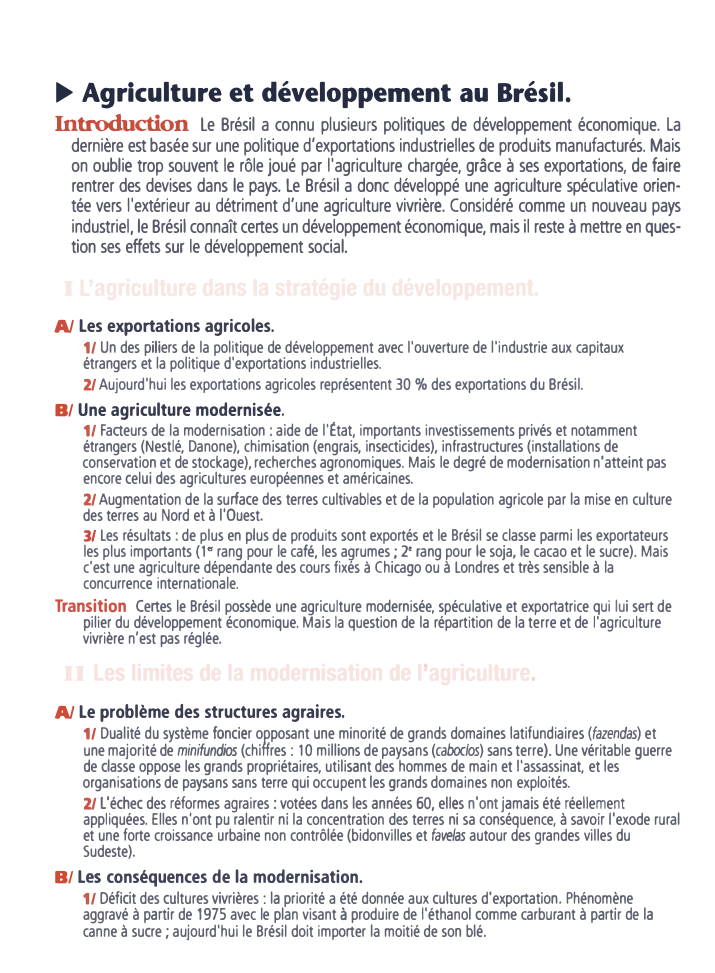► Agriculture et développement au Brésil. Introduction Le Brésil a connu plusieurs politiques de développement économique. La dernière est basée...
Extrait du document
«
► Agriculture et développement au Brésil.
Introduction Le Brésil a connu plusieurs politiques de développement économique.
La
dernière est basée sur une politique d'exportations industrielles de produits manufacturés.
Mais
on oublie trop souvent le rôle joué par l'agriculture chargée, grâce à ses exportations, de faire
rentrer des devises dans le pays.
Le Brésil a donc développé une agriculture spéculative orien
tée vers l'extérieur au détriment d'une agriculture vivrière.
Considéré comme un nouveau pays
industriel, le Brésil connaît certes un développement économique, mais il reste à mettre en ques
tion ses effets sur le développement social.
I L'agriculture dans la stratégie du développement.
A/ Les exportations agricoles.
1/ Un des piliers de la politique de développement avec l'ouverture de l'industrie aux capitaux
étrangers et la politique d'exportations industrielles.
2/ Aujourd'hui les exportations agricoles représentent 30 % des exportations du Brésil.
B/ Une agriculture modernisée.
1/ Facteurs de la modernisation : aide de l'ftat, importants investissements privés et notamment
étrangers (Nestlé, Danone), chimisation (engrais, insecticides), infrastructures (installations de
conservation et de stockage), recherches agronomiques.
Mais le degré de modernisation n'atteint pas
encore celui des agricultures européennes et américaines.
2/ Augmentation de la surface des terres cultivables et de la population agricole par la mise en culture
des terres au Nord et à l'Ouest.
3/ Les résultats : de plus en plus de produits sont exportés et le Brésil se classe parmi les exportateurs
les plus importants (1" rang pour le café, les a�rumes; 2' rang pour le soja, le cacao et le sucre).
Mais
c'est une agriculture dépendante des cours fixes à Chicago ou à Londres et très sensible à la
concurrence internationale.
Transition Certes le Brésil possède une agriculture modernisée, spéculative et exportatrice qui lui sert de
pilier du développement économique.
Mais la question de la répartition de la terre et de l'agriculture
vivrière n'est pas réglée.
II Les limites de la modernisation de l'agriculture.
A/ Le problème des structures agraires.
1/ Dualité du système foncier opposant une minorité de grands domaines latifundiaires (fazendas) et
une majorité de minifundios (chiffres : 10 millions de paysans (caboc/os) sans terre).
Une véritable guerre
de classe oppose les grands propriétaires, utilisant des hommes de main et l'assassinat, et les
organisations de paysans sans terre qui occupent les grands domaines non exploités.
2/ L'échec des réformes agraires: votées dans les années 60, elles n'ont jamais été réellement
appliquées.
Elles n'ont pu ralentir ni la concentration des terres ni sa conséquence, à savoir l'exode rural
et une forte croissance urbaine non contrôlée (bidonvilles et favelas autour des grandes villes du
Sudeste).
B/ Les conséquences de la modernisation.
1/ Déficit des cultures vivrières: la priorité a été donnée aux cultures d'exportation.
Phénomène
aggravé à partir de 1975 avec le plan visant à produire de l'éthanol comme carburant à partir de la
canne à sucre; aujourd'hui le Brésil doit importer la moitié de son blé.
2/ �puisement des sols et pollution: l'utilisation massive d'engrais a appauvri les sols et diminué la
productivité ; elle a également provoqué des phénomènes de pollution.
Transition La dualité de l'agriculture brésilienne se traduit dans l'espace.
Cette dualité contribue à
aggraver les déséquilibres régionaux.
L'opposition entre un centre dynamique et des périphéries
inégalement développées caractérise aujourd'hui l'agriculture brésilienne.
111
Les déséquilibres régionaux aggravés.
A/ Un centre : le Sudeste.
1/ Le Sudeste est déjà la 1" région industrielle et la l" région financière, avec 38 % de la production
agricole, c'est la 1" région agricole.
2/ Une agriculture de plus en plus diversifiée, intégrée au complexe agro-alimentaire.
B/ Les périphéries.
1/ Les �tats du Sud : seconde région agricole (soja, céréales et élevage bovin).
Dans cette région, outre
une agriculture de grandes exploitations modernes, s'est développée une agriculture petite et moyenne
mécanisée.
2/ Le Nordeste: l'agriculture de plantation y domine, mais la région est restée à l'écart du
développement tant industriel qu'agricole.
L'exode rural vers les villes du Sudeste y est massif.
3/ L'Amazonie: espace pionnier.
Sa mise en valeur y a été brutale.
• La réforme agraire a échoué à y installer des petits paysans, au contraire, les grands propriétaires et les grandes
sociétés capitalistes (dont beaucoup d'étrangères) y ont investi pour y constituer de grands domaines d'élevage
extensif ou de plantations de soja.
• Les opérations de colonisation de terres et la construction des grandes routes transamazoniennes ont fait reculer la
forêt et posé la question des Indiens et des seringueiros (récolteurs de latex).
En conclusion L'agriculture a été et est un des facteurs du développement écono
mique du Brésil.
Mais ce développement basé sur les cultures d'exportation n'a en rien réglé le
problème de la répartition des terres et ne s'est pas traduit par un développement social.
Dans
le domaine agricole comme dans les autres, le Brésil reste le pays des grandes disparités
sociales.
■
Les réutilisables
L'Amazonie : front pionnier
Dans les années 70, l'Amazonie est
apparue pour les militaires au pouvoir
comme pouvant être la solution au pro
blème de la terre.
En effet l'Amazonie
couvre près de la moitié du territoire et la
forêt n'était peuplé que d'une façon très dis
continue de tribus indiennes et de seringue
ras, récolteurs....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓