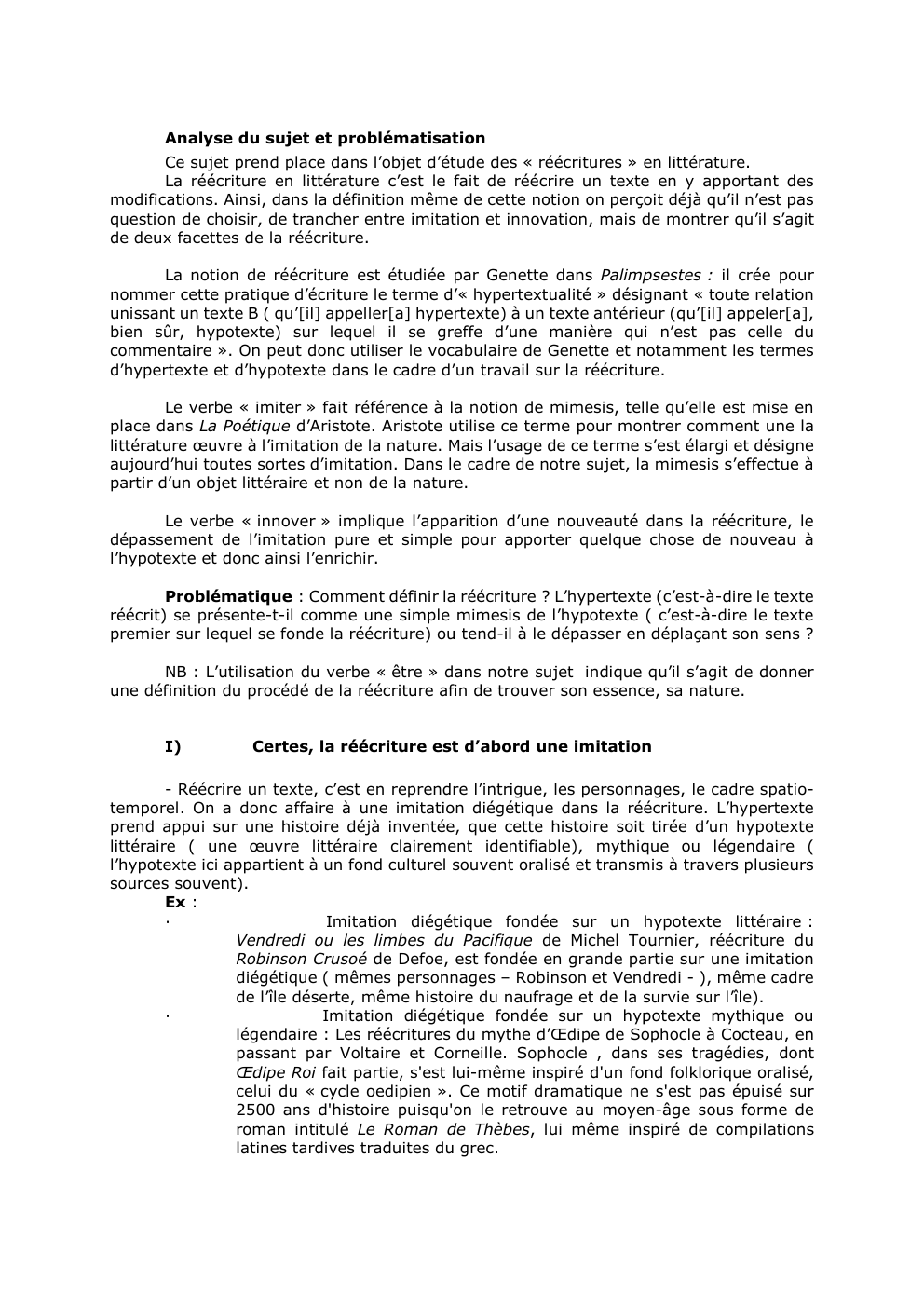Analyse du sujet et problématisation Ce sujet prend place dans l’objet d’étude des « réécritures » en littérature. La réécriture...
Extrait du document
«
Analyse du sujet et problématisation
Ce sujet prend place dans l’objet d’étude des « réécritures » en littérature.
La réécriture en littérature c’est le fait de réécrire un texte en y apportant des
modifications.
Ainsi, dans la définition même de cette notion on perçoit déjà qu’il n’est pas
question de choisir, de trancher entre imitation et innovation, mais de montrer qu’il s’agit
de deux facettes de la réécriture.
La notion de réécriture est étudiée par Genette dans Palimpsestes : il crée pour
nommer cette pratique d’écriture le terme d’« hypertextualité » désignant « toute relation
unissant un texte B ( qu’[il] appeller[a] hypertexte) à un texte antérieur (qu’[il] appeler[a],
bien sûr, hypotexte) sur lequel il se greffe d’une manière qui n’est pas celle du
commentaire ».
On peut donc utiliser le vocabulaire de Genette et notamment les termes
d’hypertexte et d’hypotexte dans le cadre d’un travail sur la réécriture.
Le verbe « imiter » fait référence à la notion de mimesis, telle qu’elle est mise en
place dans La Poétique d’Aristote.
Aristote utilise ce terme pour montrer comment une la
littérature œuvre à l’imitation de la nature.
Mais l’usage de ce terme s’est élargi et désigne
aujourd’hui toutes sortes d’imitation.
Dans le cadre de notre sujet, la mimesis s’effectue à
partir d’un objet littéraire et non de la nature.
Le verbe « innover » implique l’apparition d’une nouveauté dans la réécriture, le
dépassement de l’imitation pure et simple pour apporter quelque chose de nouveau à
l’hypotexte et donc ainsi l’enrichir.
Problématique : Comment définir la réécriture ? L’hypertexte (c’est-à-dire le texte
réécrit) se présente-t-il comme une simple mimesis de l’hypotexte ( c’est-à-dire le texte
premier sur lequel se fonde la réécriture) ou tend-il à le dépasser en déplaçant son sens ?
NB : L’utilisation du verbe « être » dans notre sujet indique qu’il s’agit de donner
une définition du procédé de la réécriture afin de trouver son essence, sa nature.
I)
Certes, la réécriture est d’abord une imitation
- Réécrire un texte, c’est en reprendre l’intrigue, les personnages, le cadre spatiotemporel.
On a donc affaire à une imitation diégétique dans la réécriture.
L’hypertexte
prend appui sur une histoire déjà inventée, que cette histoire soit tirée d’un hypotexte
littéraire ( une œuvre littéraire clairement identifiable), mythique ou légendaire (
l’hypotexte ici appartient à un fond culturel souvent oralisé et transmis à travers plusieurs
sources souvent).
Ex :
·
Imitation diégétique fondée sur un hypotexte littéraire :
Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier, réécriture du
Robinson Crusoé de Defoe, est fondée en grande partie sur une imitation
diégétique ( mêmes personnages – Robinson et Vendredi - ), même cadre
de l’île déserte, même histoire du naufrage et de la survie sur l’île).
·
Imitation diégétique fondée sur un hypotexte mythique ou
légendaire : Les réécritures du mythe d’Œdipe de Sophocle à Cocteau, en
passant par Voltaire et Corneille.
Sophocle , dans ses tragédies, dont
Œdipe Roi fait partie, s'est lui-même inspiré d'un fond folklorique oralisé,
celui du « cycle oedipien ».
Ce motif dramatique ne s'est pas épuisé sur
2500 ans d'histoire puisqu'on le retrouve au moyen-âge sous forme de
roman intitulé Le Roman de Thèbes, lui même inspiré de compilations
latines tardives traduites du grec.
- Réécrire un texte c’est aussi en reprendre la forme, dans un souci d’exactitude et
de précision plus ou moins marqué selon les textes.
Il s’agit donc ici de faire une imitation
formelle.
Ce second type d’imitation est souvent assimilé à la forme du pastiche littéraire
qui est une imitation du style d'un auteur ou d'un artiste.
Ex :
·
Les Fables de La Fontaine se présentent comme une imitation
formelle des Fables d’Esope.
La Fontaine reprend à la fois la forme versifiée
de la Fable mais aussi l’enjeu moral et didactique, intimement liée à cette
forme à travers la « morale ».
·
Proust dans Pastiches et Mélanges, et dans Le Temps Retrouvé
où il pastiche le Journal des Goncourt.
·
Paul Reboux et Charles Müller, dans A la manière de…, recueil
de pastiches de grands écrivains.
II)
Mais la réécriture implique une distance, un décalage vis à vis du
modèle
- La réécriture implique souvent une distance spatio-temporelle vis-à-vis du modèle.
Elle met en place un processus d’actualisation temporelle et/ou spatiale permettant
d’adapter les propos de l’hypotexte à une époque et à une société donnée.
Ex :
·
Dans Ulysse, réécriture de l’Odyssée d’Homère, Joyce réalise
une transposition spatio-temporelle de l’hypotexte :l’histoire se passe au
début du XXe siècle, en Irlande.
·
Michel Tournier, dans Vendredi ou les limbes du Pacifique et
Vendredi ou la vie sauvage opère, d’une part, une translation spatiale de
l’Atlantique au Pacifique et, d’autre part, une translation temporelle d’un
siècle puisqu’il situe son action en 1759 alors que chez Defoe elle a lieu en
1659.
: cette transposition un siècle plus tard est nécessaire pour
permettre à Michel Tournier de caricaturer le puritanisme de son
prédécesseur.
Cette transposition permet au Robinson tourniérien de
comparer sa situation à celle des colons, adeptes de la même morale de
l’accumulation et de mobiliser la référence à Benjamin Franklin.
Ce
nouveau contexte accentue le thésaurisme déjà présent dans Robinson
Crusoé et permet à Michel Tournier d’en dénoncer l’absurdité.
- La réécriture implique une distance stylistique vis à vis du modèle en modifiant
les registres utilisés.
La réécriture peut se présenter comme un travestissement stylistique
burlesque ou héroï-comique : elle devient ainsi une parodie cultivant la distance ironique
avec l’hypotexte.
Ex : Scarron dans Le Virgile Travesti, réécrit de façon parodique l’Eneïde de Virgile.
Il recompose l’histoire d’Enée et des origines de Rome dans un registre différent, en
l’adaptant à la vie et aux mœurs de son temps.
Il choisit l’octosyllabes, plutôt que
l’alexandrin, vers noble que choisissent souvent les traducteurs.
Il fait preuve....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓