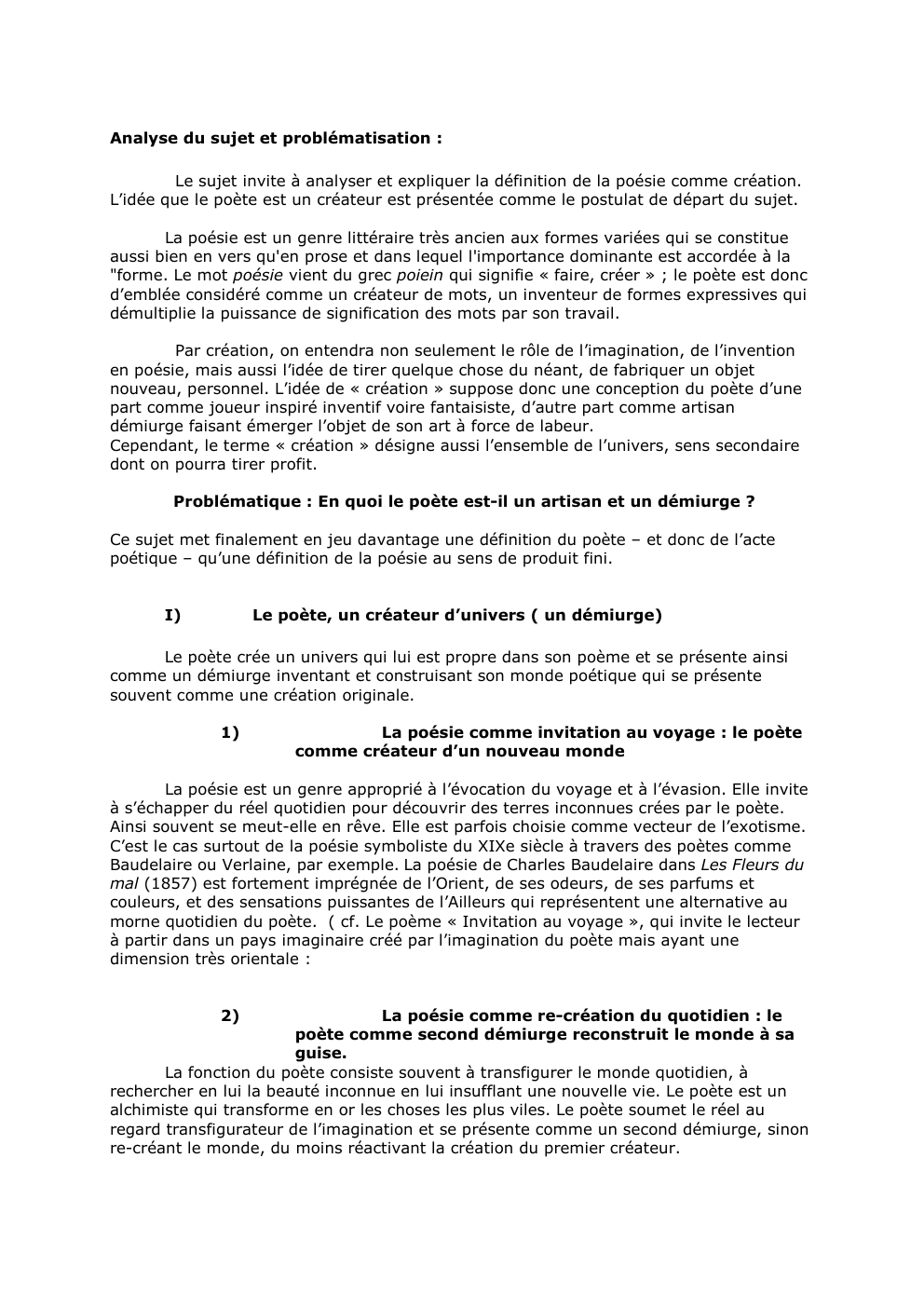Analyse du sujet et problématisation : Le sujet invite à analyser et expliquer la définition de la poésie comme création....
Extrait du document
«
Analyse du sujet et problématisation :
Le sujet invite à analyser et expliquer la définition de la poésie comme création.
L’idée que le poète est un créateur est présentée comme le postulat de départ du sujet.
La poésie est un genre littéraire très ancien aux formes variées qui se constitue
aussi bien en vers qu'en prose et dans lequel l'importance dominante est accordée à la
"forme.
Le mot poésie vient du grec poiein qui signifie « faire, créer » ; le poète est donc
d’emblée considéré comme un créateur de mots, un inventeur de formes expressives qui
démultiplie la puissance de signification des mots par son travail.
Par création, on entendra non seulement le rôle de l’imagination, de l’invention
en poésie, mais aussi l’idée de tirer quelque chose du néant, de fabriquer un objet
nouveau, personnel.
L’idée de « création » suppose donc une conception du poète d’une
part comme joueur inspiré inventif voire fantaisiste, d’autre part comme artisan
démiurge faisant émerger l’objet de son art à force de labeur.
Cependant, le terme « création » désigne aussi l’ensemble de l’univers, sens secondaire
dont on pourra tirer profit.
Problématique : En quoi le poète est-il un artisan et un démiurge ?
Ce sujet met finalement en jeu davantage une définition du poète – et donc de l’acte
poétique – qu’une définition de la poésie au sens de produit fini.
I)
Le poète, un créateur d’univers ( un démiurge)
Le poète crée un univers qui lui est propre dans son poème et se présente ainsi
comme un démiurge inventant et construisant son monde poétique qui se présente
souvent comme une création originale.
1)
La poésie comme invitation au voyage : le poète
comme créateur d’un nouveau monde
La poésie est un genre approprié à l’évocation du voyage et à l’évasion.
Elle invite
à s’échapper du réel quotidien pour découvrir des terres inconnues crées par le poète.
Ainsi souvent se meut-elle en rêve.
Elle est parfois choisie comme vecteur de l’exotisme.
C’est le cas surtout de la poésie symboliste du XIXe siècle à travers des poètes comme
Baudelaire ou Verlaine, par exemple.
La poésie de Charles Baudelaire dans Les Fleurs du
mal (1857) est fortement imprégnée de l’Orient, de ses odeurs, de ses parfums et
couleurs, et des sensations puissantes de l’Ailleurs qui représentent une alternative au
morne quotidien du poète.
( cf.
Le poème « Invitation au voyage », qui invite le lecteur
à partir dans un pays imaginaire créé par l’imagination du poète mais ayant une
dimension très orientale :
2)
La poésie comme re-création du quotidien : le
poète comme second démiurge reconstruit le monde à sa
guise.
La fonction du poète consiste souvent à transfigurer le monde quotidien, à
rechercher en lui la beauté inconnue en lui insufflant une nouvelle vie.
Le poète est un
alchimiste qui transforme en or les choses les plus viles.
Le poète soumet le réel au
regard transfigurateur de l’imagination et se présente comme un second démiurge, sinon
re-créant le monde, du moins réactivant la création du premier créateur.
Cf.
cette phrase de Rilke : « Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l’accusez pas.
Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses.
»
Ex : Jacques Réda, « La bicyclette » : Réda opère dans son poème une transfiguration
d’un objet technique appartenant au domaine du sport ou à l’univers de l’enfance : il
entraîne le lecteur dans l’expérience sensorielle qu’il a connue, lui offre ainsi une image
renouvelée de la bicyclette métamorphosée en oiseau, puis en planète.
L’objet quotidien
est donc devenu presque surnaturel ; il est célébré par le poète qui remplit là son rôle
créateur.
II)
Le poète, un artisan des mots
La poésie, en tant que discipline artistique à visée essentiellement esthétique se
présente comme une fin en soi.
Elle cherche la perfection esthétique : c’est pourquoi le
souci de la forme est constant chez les poètes qui effectuent un travail de longue haleine
à la recherche de cette perfection formelle dans leur création.
1)
Un orfèvre du Verbe
Le poète exploite toutes les ressources de la langue en valorisant aussi les mots
par leur rareté et leur nombre limité : on parle parfois de " poésie-télégramme " où
chaque mot " coûte ", par exemple, dans la forme fixe du sonnet comportant seulement
14 vers.
Le soin accordé au choix des mots passe souvent par la recherche de sens rares
ou de néologisme ( on a donc un travail d’orfèvre sur le sens même des mots et sur leur
combinaison) : c’est dans l’assemblage et dans le choix des mots que réside la création !
Ex : « Soleils Couchants » de Verlaine où le poète opère à une remotivation du
sens du mot « aube » en l’associant au coucher du soleil :
Une aube affaiblie
Verse par les champs
La mélancolie
Des soleils couchants.
Le mot peut aussi être mis en valeur par des figures de style comme l’anaphore,
l’oxymore, le chiasme etc… et bien sûr, la métaphore qui se présente comme la figure de
style par excellence du genre poétique.
NB : La « création » poétique la plus spectaculaire fondée sur l’élément verbal : le
calligramme (où sens mais aussi forme et longueur du mot – et plus précisément des
lettres – sont associés)
2)
Un tailleur de sons....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓