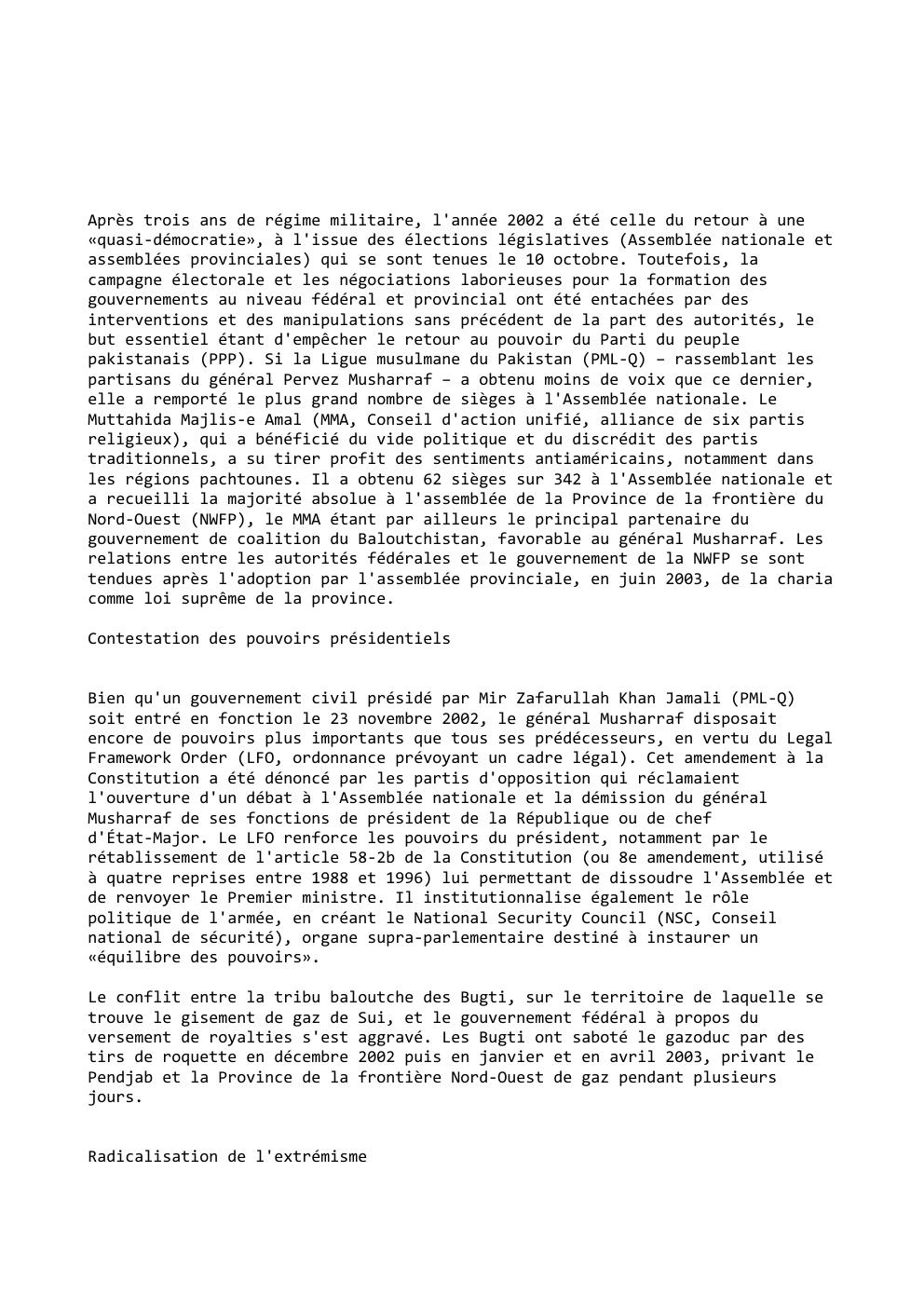Après trois ans de régime militaire, l'année 2002 a été celle du retour à une «quasi-démocratie», à l'issue des élections...
Extrait du document
«
Après trois ans de régime militaire, l'année 2002 a été celle du retour à une
«quasi-démocratie», à l'issue des élections législatives (Assemblée nationale et
assemblées provinciales) qui se sont tenues le 10 octobre.
Toutefois, la
campagne électorale et les négociations laborieuses pour la formation des
gouvernements au niveau fédéral et provincial ont été entachées par des
interventions et des manipulations sans précédent de la part des autorités, le
but essentiel étant d'empêcher le retour au pouvoir du Parti du peuple
pakistanais (PPP).
Si la Ligue musulmane du Pakistan (PML-Q) – rassemblant les
partisans du général Pervez Musharraf – a obtenu moins de voix que ce dernier,
elle a remporté le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale.
Le
Muttahida Majlis-e Amal (MMA, Conseil d'action unifié, alliance de six partis
religieux), qui a bénéficié du vide politique et du discrédit des partis
traditionnels, a su tirer profit des sentiments antiaméricains, notamment dans
les régions pachtounes.
Il a obtenu 62 sièges sur 342 à l'Assemblée nationale et
a recueilli la majorité absolue à l'assemblée de la Province de la frontière du
Nord-Ouest (NWFP), le MMA étant par ailleurs le principal partenaire du
gouvernement de coalition du Baloutchistan, favorable au général Musharraf.
Les
relations entre les autorités fédérales et le gouvernement de la NWFP se sont
tendues après l'adoption par l'assemblée provinciale, en juin 2003, de la charia
comme loi suprême de la province.
Contestation des pouvoirs présidentiels
Bien qu'un gouvernement civil présidé par Mir Zafarullah Khan Jamali (PML-Q)
soit entré en fonction le 23 novembre 2002, le général Musharraf disposait
encore de pouvoirs plus importants que tous ses prédécesseurs, en vertu du Legal
Framework Order (LFO, ordonnance prévoyant un cadre légal).
Cet amendement à la
Constitution a été dénoncé par les partis d'opposition qui réclamaient
l'ouverture d'un débat à l'Assemblée nationale et la démission du général
Musharraf de ses fonctions de président de la République ou de chef
d'État-Major.
Le LFO renforce les pouvoirs du président, notamment par le
rétablissement de l'article 58-2b de la Constitution (ou 8e amendement, utilisé
à quatre reprises entre 1988 et 1996) lui permettant de dissoudre l'Assemblée et
de renvoyer le Premier ministre.
Il institutionnalise également le rôle
politique de l'armée, en créant le National Security Council (NSC, Conseil
national de sécurité), organe supra-parlementaire destiné à instaurer un
«équilibre des pouvoirs».
Le conflit entre la tribu baloutche des Bugti, sur le territoire de laquelle se
trouve le gisement de gaz de Sui, et le gouvernement fédéral à propos du
versement de royalties s'est aggravé.
Les Bugti ont saboté le gazoduc par des
tirs de roquette en décembre 2002 puis en janvier et en avril 2003, privant le
Pendjab et la Province de la frontière Nord-Ouest de gaz pendant plusieurs
jours.
Radicalisation de l'extrémisme
Le soutien inconditionnel du Pakistan aux États-Unis, dans le cadre de la lutte
antiterroriste, a entraîné une radicalisation des groupes extrémistes religieux
et une recrudescence des violences confessionnelles.
Les attaques, visant des
églises, une école, un hôpital chrétiens ainsi que des mosquées chiites et des
dignitaires religieux, ont fait des dizaines de morts.
85 attentats sectaires
ont été recensés en 2002.
Après une accalmie de plusieurs mois, les violences
contre les chiites ont repris en février 2003 et se sont étendues en juin au
Baloutchistan jusque-là épargné.
Les extrémistes religieux, qui avaient perdu leur sanctuaire afghan après la
chute des taliban en novembre 2001, se sont regroupés dans les grandes villes.
Ils se sont alliés à des islamistes radicaux arabes repliés au Pakistan pour
mener des opérations contre les intérêts occidentaux et pour tenter de
déstabiliser le président Musharraf.
Une douzaine de Pakistanais ont notamment
trouvé la mort le 14 juin 2002 à la suite d'un attentat-suicide contre le
consulat américain à Karachi.
La collaboration des autorités pakistanaises avec le FBI (Federal Bureau of
Investigation) a permis, entre autres, l'arrestation à Karachi, en septembre
2002, de Ramzi ben al-Shibh, membre de la cellule de Hambourg du réseau
terroriste Al-Qaeda, ainsi que celle, à Lahore, en février 2003, de Khalid
Sheikh Mohammad, un Pakistanais né au Koweït, adjoint d'Oussama ben Laden et
oncle de Ramzi Yousef, responsable de l'attentat perpétré contre le World Trade
Centre en 1993.
En mars 2003, le Pakistan avait livré aux États-Unis quelque 450
étrangers membres présumés d'Al-Qaeda, en majorité afghans, saoudiens et
yéménites.
Les autorités pakistanaises dénombraient, en août 2002, 58
Pakistanais détenus au camp américain d'internement de Guantànamo (Cuba).
Par
ailleurs, 600 Pakistanais, originaires pour la plupart de la Province de la
frontière....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓