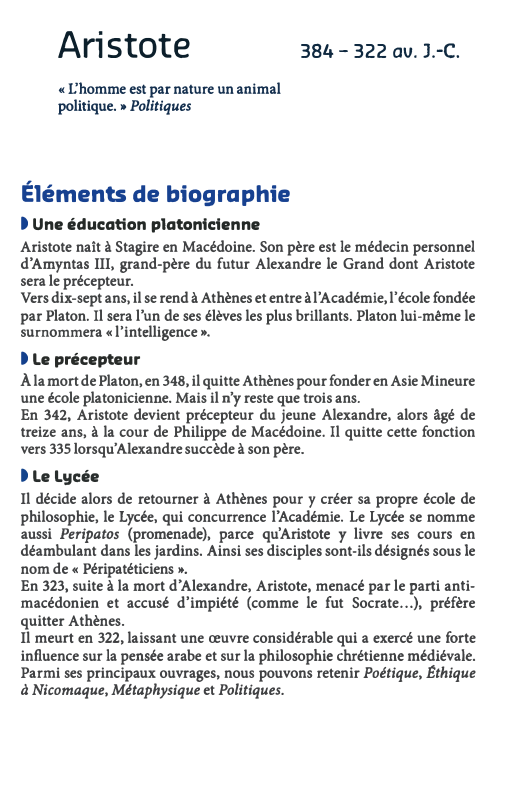Aristote 384 - 322 au. J.-C. « L'homme est par nature un animal politique. ,. Politiques Éléments de biographie t...
Extrait du document
«
Aristote
384 - 322 au.
J.-C.
« L'homme est par nature un animal
politique.
,.
Politiques
Éléments de biographie
t Une éducation platonicienne
Aristote naît à Stagire en Macédoine.
Son père est le médecin personnel
d'Amyntas III, grand-père du futur Alexandre le Grand dont Aristote
sera le précepteur.
Vers dix-sept ans, il se rend à Athènes et entre à l'Académie, l'école fondée
par Platon.
Il sera l'un de ses élèves les plus brillants.
Platon lui-même le
surnommera « l'intelligence ».
t le précepteur
A la mort de Platon, en 348, il quitte Athènes pour fonder en Asie Mineure
une école platonicienne.
Mais il n'y reste que trois ans.
En 342, Aristote devient précepteur du jeune Alexandre, alors âgé de
treize ans, à la cour de Philippe de Macédoine.
Il quitte cette fonction
vers 335 lorsqu'Alexandre succède à son père.
t le lycée
Il décide alors de retourner à Athènes pour y créer sa propre école de
philosophie, le Lycée, qui concurrence l'Académie.
Le Lycée se nomme
aussi Peripatos (promenade), parce qu'Aristote y livre ses cours en
déambulant dans les jardins.
Ainsi ses disciples sont-ils désignés sous le
nom de « Péripatéticiens ».
En 323, suite à la mort d'Alexandre, Aristote, menacé par le parti anti
macédonien et accusé d'impiété (comme le fut Socrate ...), préfère
quitter Athènes.
Il meurt en 322, laissant une œuvre considérable qui a exercé une forte
influence sur la pensée arabe et sur la philosophie chrétienne médiévale.
Parmi ses principaux ouvrages, nous pouvons retenir Poétique, Éthique
à Nicomaque, Métaphysique et Politiques.
Thèses essentielles
Bien que son œuvre ne nous soit parvenue qu'en partie, Aristote est
l'un des pères fondateurs non seulement de la métaphysique et de la
logique mais aussi de la zoologie (il est l'un des premiers à classer
les espèces animales et à recueillir méthodiquement les données de
l'observation).
t l'invention de la logique formelle
Aristote est le premier à déterminer les propriétés du raisonnement
indépendamment de son contenu.
En mettant en évidence le syllogisme
démonstratif, raisonnement qui, à partir de deux prémisses, permet
de conduire à une conclusion nécessaire, Aristote pose les bases d'une
logique formelle, exempte de tout contenu.
La forme du syllogisme est la
suivante:
Tout A est B (prémisse majeure)
C est A (prémisse mineure)
Donc C est B (conclusion)
Hegel saluera sur ce point le mérite d'Aristote : « C'est un mérite immortel
d'Aristote d'avoir[...
] reconnu et déterminé des formes que le penser prend
en nous ,.
(Leçons sur l'histoire de la philosophie).
En montrant quelles
sont les formes de la pensée rationnelle et comment elles peuvent être
perverties, Aristote livre les conditions de la science, les outils nécessaires
à l'établissement de la connaissance.
t 11 ne faut pas négliger l'expérience
Aristote reste attaché à l'expérience : s'il n'y a de science que du général et
du nécessaire, et s'il faut en effet dépasser la sphère de l'opinion, comme
le préconise Platon, il n'en reste pas moins que c'est par l'observation des
faits que l'on peut accéder aux principes premiers qui gouvernent le réel.
Contrairement à Platon qui considère qu'il est nécessaire, pour accéder
à la vérité, de se détacher du sensible, Aristote prône une méthode
empirique.
Il récuse la séparation platonicienne entre le monde sensible
et le monde intelligible.
Si l'on veut expliquer une chose, c'est dans cette
chose même qu'il faut chercher, non dans un au-delà transcendant.
En ce sens, la logique ne doit pas se détacher absolument du réel : elle est
l'outil (l'organon) de la pensée qui doit permettre la saisie des faits eux
mêmes et de leurs causes.
La rigueur de la pensée, sa capacité à tenir une
démonstration fondée sur des prémisses certaines, la préviennent contre
l'erreur.
t La physique
La logique sert la science, et notamment l'étude de la nature.
Dans la
Physique, Aristote s'intéresse à la nature, et nous livre une véritable
cosmologie.
S'il refuse de concevoir le monde des Idées comme séparé
du cosmos, s'éloignant en cela de Platon, il distingue cependant dans
l'univers, conçu comme totalité close organisée, deux régions.
La première
constitue le monde supralunaire, dans lequel les astres connaissent des
mouvements parfaits et éternels parce que circulaires.
La seconde, le
monde sublunaire (sous la Lune), est le lieu de l'imperfection, puisqu'une
diversité de mouvements y règne, et notamment celui de la corruption et
de la génération.
C'est alors au mouvement qui règne dans le monde sublunaire que
s'intéresse Aristote, pour montrer notamment que ce qui caractérise
tout corps naturel, c'est qu'il porte en lui le principe de sa génération et
de sa corruption.
La nature n'est pas l'ensemble des choses, mais elle est
principe de production, cause du développement d'un être inhérente à
cet être même, constitutive de son essence.
t Acte et puissance : principe de tout mouvement
C'est par les concepts de puissance et d'acte qu'Aristote explique tout
changement dans la nature.
Tout être possède en lui des virtualités qui,
tant qu'elles ne sont pas effectives, sont en lui " en puissance », non
encore réalisées.
Le passage de la puissance à l'acte est la réalisation de cette virtualité.
C'est ainsi, par exemple, que l'on peut dire qu'un bourgeon est une fleur
en puissance, et que celle-ci ne sera en acte que lorsque le bourgeon
aura éclos.
t Le uivant : ce qui possède en soi le principe
de son mouvement
Aristote met en évidence le fait que tout vivant possède une âme, qu'il
nomme entéléchie.
Elle constitue le principe de son organisation.
Les
plantes ont une âme végétative, les animaux une âme sensitive, et les
hommes une âme rationnelle.
L'homme n'est donc en acte (n'est vraiment
homme) que lorsqu'il fait usage de sa raison.
L'âme est le principe d'organisation du corps, elle est sa forme, mais
non pas une forme transcendante, comme chez Platon.
Intrinsèquement
liée au corps, elle disparaît avec lui.
Cette vision unitaire de l' homme
constituera pour Thomas d'Aquin, qui tente au XIIie siècle de concilier les
thèses aristotéliciennes avec le christianisme, la principale difficulté.
C'est, surtout, une vision finaliste de la nature et du vivant que propose
Aristote, notamment lorsqu'il écrit que " ce n'est pas parce qu'il a des
mains que l'homme est le plus intelligent des êtres, mais c'est parce qu'il
est le plus intelligent qu'il a des mains ,.
(Des parties des animaux) : la
constitution même du vivant vise une fin.
La nature ne fait rien en vain.
t Les quatre causes
Soucieux de trouver des outils conceptuels aptes à rendre compte du
réel, et à répondre à la question " pourquoi ? ,., Aristote distingue quatre
causes de toute chose.
En effet, connaître, c'est d'abord pouvoir saisir les
causes.
La cause matérielle, d'abord, est une potentialité pure qui doit être
actualisée par la forme pour être quelque chose (par exemple, le marbre
de la statue).
La cause efficiente, ensuite, désigne l'agent qui transforme
(par exemple le sculpteur).
La cause finale, quant à elle, renvoie....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓