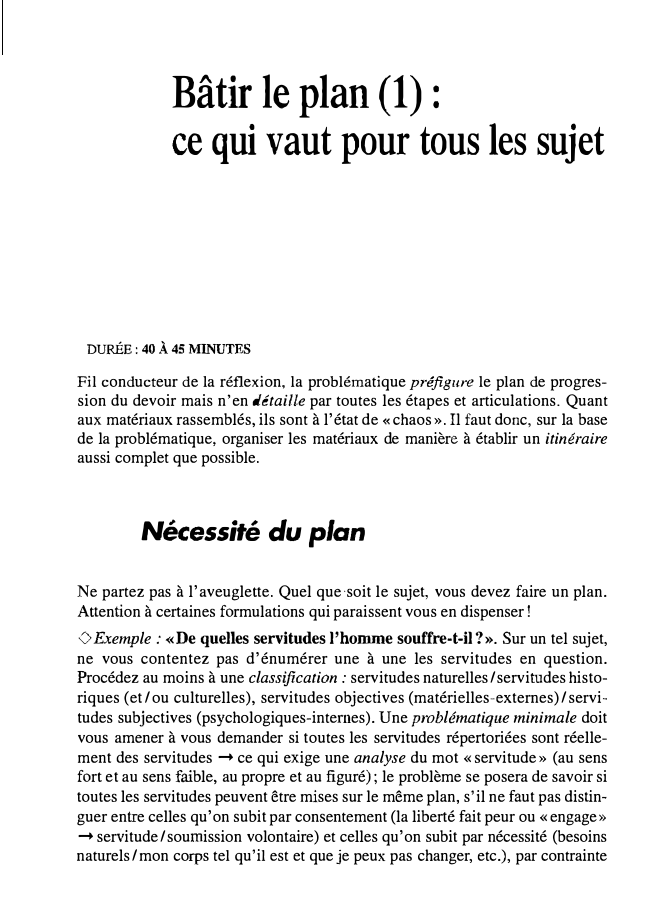Bâtir le plan (1) : ce qui vaut pour tous les sujet DURÉE : 40 À 45 MINUTES Fil conducteur...
Extrait du document
«
Bâtir le plan (1) :
ce qui vaut pour tous les sujet
DURÉE : 40 À 45 MINUTES
Fil conducteur de la réflexion, la problématique préfigure le plan de progres
sion du devoir mais n'en détaille par toutes les étapes et articulations.
Quant
aux matériaux rassemblés, ils sont à l'état de «chaos».
Il faut donc, sur la base
de la problématique, organiser les matériaux de manière à établir un itinéraire
aussi complet que possible.
Nécessité du plan
Ne partez pas à l'aveuglette.
Quel que·soit le sujet, vous devez faire un plan.
Attention à certaines formulations qui paraissent vous en dispenser!
◊Exemple: «De quelles servitudes l'homme souffre-t-il ?».
Sur un tel sujet,
ne vous contentez pas d'énumérer une à une les servitudes en question.
Procédez au moins à une classification: servitudes naturelles/servitudes histo
riques ( et/ou culturelles), servitudes objectives (matérielles-externes)/servi
tudes subjectives (psychologiques-internes).
Une problématique minimale doit
vous amener à vous demander si toutes les servitudes répertoriées sont réelle
ment des servitudes -+ ce qui exige une analyse du mot «servitude» (au sens
fort et au sens faible, au propre et au figuré) ; le problème se posera de savoir si
toutes les servitudes peuvent être mises sur le même plan, s'il ne faut pas distin
guer entre celles qu'on subit par consentement (la liberté fait peur ou«engage»
-+ servitude/soumission volontaire) et celles qu'on subit par nécessité (besoins
naturels/mon corps tel qu'il est et que je peux pas changer, etc.), par contrainte
(l'esclave, le serf, l'oppression politique).
On ne manquera pas de se demander
si toutes ces servitudes, quelles qu'elles soient, ne sont pas dépassables (et
même effectivement dépassées) par l'homme défini comme être libre, comme
conscience-qui-se-choisit.
Une bonne réflexion sur ces problèmes exige une
mise en ordre des idées, des exemples, des connaissances.
Ne pas faire de plan
sur.un tel sujet, c'est prendre le risque d'un devoir-inventaire superficiel et, sur
tout, de tenir un discours contradictoire en croyant éviter les difficultés1.
Le plan ne permet pas seulement d'éviter le hors-sujet.· Il est encore et surtout
la condition impérative d'une réponse convaincante à la question posée :
l'ordre des raisons ajoute au contenu des idées, à la clarté du discours.
Avec la
compréhension du sujet, l'organisation de la réflexion est le second grand cri
tère de correction de la dissertation philosophique.
Le jour de l'épreuve, vous serez peut-être «stressé>>.
Et vous aurez tendance à
passer le plus rapidement possible à la rédaction, dès que vous aurez rassemblé
quelques matériaux.
Attitude compréhensible mais irrationnelle : c'est juste
ment si vous prenez le temps de faire un plan complet de votre dissertation que
vous
la
rédigerez
plus
rapidement
en
fin
d'épreuve .
.
Trois exigences Fondamentales
1.
Le plan doit être spécifique : entendez par là qu'il n'y a pas, en philosophie,
de plan«prêt-à-porter», que celutci doit être«taillé sur mesure», approprié au
sujet que vous traitez.
C'est pourquoi- il doit être élaboré à partir du sujet lui
mêine, donc de l'analyse et de la problématisation du sujet.
Nous verrons que
certains types de sujets impliquent des formes particulières d'organisation de la
dissertation.
Mais, en règle générale, il ne peut pas y avoir de plan type : le sujet
de philosophie pose un problème spécifique; la réflexion doit donc être organi
sée de manière spécifique.
2.
Le plan doit être organique : entendez par là que ses différentes phases doi
vent s'enchaîner de manière à former une progression continue de la
réflexion.
C'est pourquoi on sera particulièrement attentif au problème des
transitions.
Le plan ne doit être ni un schéma artificiellement plaqué sur le
sujet - c'est le risque du plan type ni une succession discontinue de points
1.
Lire, au chapitre suivant, ·un exemple de problématisation sur ce type de sujet : « Quels sont les �
principaux obstacles à la connaissance scientifique?» (p.
131).
c_
passés en revue : organiser, ce n'est pas simplement assembler.
Il faut que le
plan «fonctionne».
Là encore, c'est en partant de la problématique que vous
répondrez à cette exigence.
3.
Le plan doit être critique : entendez par là que la réflexion ne doit être ni
dogmatique - affirmer des thèses sans les démontrer - ni polémique - rejeter
des thèses sans les réfuter.
Le plan de la réflexion sera donc un plan d 'argumentation : argumenter veut dire raisonner sur des idées (des connaissances, des
faits, des théories) en les confirmant par des preuves (arguments pour) et/ ou en
les infirmant au moyen d'objections (arguments contre).
Examiner une question, c'est réfléchir de manière critique sur les différents points de vue possibles, sur les diverses réponses possibles.
Et, la réflexion étant discussion avec
soi-même, le plan de la dissertation reflétera cette structure « disputative » de la
pensée.
Encore et toujours, c'est l'esprit «problématique» qui doit gouverner la
démarche.
On peut penser que certains sujets ne se prêtent pas à un traitement critique,
donc à un plan de la forme «discussion» ou de la forme «argumentation».
Il
n'en est rien.
◊Exemples:
■ « Qu'est-ce qu'une évidence?» : Pour traiter convenablement le sujet, il ne
suffit pas de décrire, d'analyser, ni même de classer, en les comparant, divers
cas d'évidence (évidence sensible/ évidence intellectuelle).
Certes, ce n'est déjà
pas rien.
Mais on ne comprend vraiment la question et on ne la traite philosophiquement que si on la problématise : « Qu'est-ce qu'une évidence?»-+ Estce une manifestation objective de la vérité dans l'esprit? Ou bien est-ce une
impression purement subjective de vérité? Évidence = apparence ou réalité du
vrai? critère ou illusion de vérité? Le sujet invite alors à une réflexion critique
sur la nature et le statut cognitif de l'évidence, donc à un plan-discussion autour
du problème de la vérité.
«Qu'est-ce que?»-+ «Est-ce ...
ou bien est-ce ...
?»
Même le sujet-définition exige d'élaborer un plan d'argumentation.
■ «Où faut-il chercher l'origine de la passion?»: Problématique possible:
Est-ce dans la nature de l'homme qu'il faut chercher l'origine de la passion, ou
bien dans les règles socio-culturelles qui codifient l'existence humaine (tabous
et interdits qui «barrent» l'expression naturelle des tendances et des besoins et
qui feraient ainsi «dégénérer» le désir en passion)? « Où ? -+ Est-ce dans ...
ou
bien est-ce dans ...
? » Le sujet invite à un examen critique des deux thèses, ici
des deux lieux de naissance possibles de la passion.
102
1
Thèse, antithèse, synthèse?
Toht plan de dissertation philosophique est-il alors de la forme thèse-antithèse
sydthèse (plan dit «dialectique»)1 ?
Oui et non; c'est toute la question du plan.
■ Oui, dans la mesure où le mouvement de la réflexion est d'argumentation et
de discussion (d'îdées, de faits, etc.).
Dans cette mesure, tout plan est dialec
tique : la nature même de la démarche philosophique est dialectique.
■ Non, dans la mesure où la structure critique-dialectique interne du raisonne
ment philosophique ne signifie pas que la forme externe de la dissertation doive
invariablement être celle.
du plan thèse-antithèse-synthèse (thèse= 1re partie,
antithèse= 2• partie, synthèse= 3e partie ou conclusion).
En effet:
• D'une part, tous les sujets ne se prêtent pas aisément à la mise e.n œuvre
d'un tel cadre formel: par exemple, les sujets-analyses (« Quel sens donner
à...
? ») ou les sujets-conditions de possibilité ( «À quelles conditions ...
? »).
Même si tout sujet invite, à un moment ou un autre, à une discussion dialec
tique de thèses ou de points de vue contradictoires, tout sujet autorise diverses
façons de conduire la discussion.
De plus, à la thèse et à l'antithèse ne corres
pondent pas forcément le Oui et le Non.
Reportez-vous au chapitre 10, p.
157.
Sur le sujet « Faut-il redouter la mort?», la thèse est Non (il n'y a pas lieu,
sur le plan théorique, de redouter la mort) et l'antithèse est Oui (pour des rai
sons pratiques, éthiques, il vaut mieux tenir la mort pour redoutable).
Même
remarque pour la dissertation rédigée au chapitre 11 : « Peut-on concevoir
une liberté sans loi?».
Or, dans les deux vas, c'est la problématique qui
empêche la dialectique de verser dans le formalisme.
• D'autre part, et à condition que le sujet s'y prête effectivement, le plan thèse
antithèse-synthèse doit plutôt être considéré comme une solution de rechange
que comme la «panacée universelle».
Le candidat qui n'aura pas su élaborer
une problématique plus fine (mi qui maîtrise mal le temps de l'épreuve) dispo
sera avec ce plan d'un moyen commode d'organiser sa réflexion.
Considérez-le
non comme un plan type mais comme un plan «d'urgence».
l.
Si vous adoptez le plan thèse-antithèse-synthèse, un conseil : gardez la synthèse pour la conclusion.
La synthèse de deux points de vue dont chacun a fait l'objet d'une argumentation critique complète
est nécessairement une conclusion et, comme son nom l'indique, la synthèse sera de préférence...
synthétique! Faire de la synthèse une partie entière du développement, c'est prendre le risque de
recommencer le travail.
• Enfin, le plan thèse-antithèse-synthèse peut prendre des formes caricaturales
dans les copies.
La thèse et l'antithèse y sont plutôt affirmées parallèlement
sans démonstration que «dialectisées».
La synthèse n'est alors qu'une tentative
pour concilier, de façon purement verbale - ou incantatoire - des points de vue
parfaitement irréductibles l'un à l'autre.
Du reste, même si l'argumentation est
bien menée, que se passe-t-il, souvent, quand on a solidement établi et la thèse
et l'antithèse? On se trouve devant un problème indécidable: thèse et antithèse
sont plus fortes que la synthèse, philosophiquement plus importantes que le
compromis artificiellement rédigé entre elles à.
la fin du devoir.
Rien ne résume plus cruellement l'impossibilité de la synthèse dans certains cas
que ces graffitis relevés à Berlin avant la chute du Mur : « To do is to be»
(Platon), « To be is to do» (Marx), « Dobedobee» (Frank Sinatra)1• Entre l'idéa
lisme platonicien et le matérialisme de Marx, quelle peut être la synthèse? Avec
humour et désespoir, l'auteur de ces graffiti voulait probablement dire qu'entre
l'Est et l'Ouest, entre les valeurs des deux blocs, la «troisième voie» était
introuvable et qu'en fait de synthèse, on ne pouvait guère trouver mieux qu'un
refrain de crooner ...
porté par un vent > 1
Partir d'un Fait
ou d'une idée non
pour l'admettre
mais pour
· l'interroger.
I - Le passé est-il intéressant?
Éléments d'introduction à I: Mémoire+ conscience du
passé = données de la réalité humaine ➔ pas besoin
d'expliquer l'intérêt porté au passé (fait naturel) :
-cf.
Chaunu : citation p.
96.
Mais cela ne prouve pas l'intérêt du passé.
«Mais...
,
en effet..., or...
,
donc...
»:
le plan est un plan
d'argumentation
et c'est à cette
condition qu'il est
organique.
1.Ambiguïté de la mémoire et de la conscience du passé.
En effet, d'un côté :
Contradictions de la mémoire :
-exemples p.
97 : attention mnésique captée par l'inté
ressant comme par l'inintéressant.
Expressions contradictoires de la conscience com
mune du passé :
-expressions «c'est le passé>> ➔passé= dépassé (voir
p.
97) mais aussi «c'était le bon vieux temps» nostalgie
-+ passé= insurpassable.
D'où: mémoire/conscience du passé ne prouvent pas
suffisamment l'intérêt du passé.
L'élaboration
du plan Fait surgir
des éléments
nouveaux;
c'est en quoi
elle fait progresser
la réflexion
sur le sujet.
Or, d'un autre côté :
Mémoire= conservation du passé, donc le passé n'est
pas le dépassé/l'inactuel :
-présence virtuelle du passé : cf.
image de la mémoire
comme palimpseste chez Baudelaire (couches succes
sives des faits/sentiments du passé «embaumés dans ce
que nous appelons l'oubli»).
Expérience de la réminisèence/anamnèse= retour du
passé dans le présent («temps retrouvé»)
-cf.
psychanalyse/ »travail» autobiographique prous
tien et citation de Péguy (p.
97).
-au plan collectif : notions de «mentalités»/«incons
cient culturel» ➔poids/action du passé dans le présent.
■
■
■
■
1.
Voir la mise au point de la problématique, p.
83-84.
À chaque étape
du plan, faire un
rapide bilan pour
voir où l'on en est.
-Ne jamais perdre
de vue le réel
de l'expérience
et du langage ...
Mais organiser,
c'est-à-dire
distinguer,
« sérier»
les àspects de
ce réel complexe
et multiple.
Exploiter
les connaissances
en fonction
des exigences
du plan.
Le bilan d'une
partie doit être
une transition
entre celle-ci et
· ta suivante
on la marquera
donc nettement.
l'introduction
à une nouvelle
.
partie sera
assurée par
cette transition.
Donc: s'intéresser au passé pour combler lacunes de la
mémoire (y mettre de l'ordre)+ intérêt du passé parce
qu'il est latent et agit souterrainement dans l'actuel.
2.
Le passé est intéressant en soi : le passé = cause
objective de l'intérêt qu'on peut lui porter.
Car:
Présence non seulement virtuelle mais réelle, concrète
de l'hier dans !'aujourd'hui-+ passé éveille l'intérêt
(curiosité d'«enquête») :
- voir p.
97 (expressions comme «À quoi ça servait?»/
intérêt affectif+ culturel/ambiguïté du mot «souvenir»
(objet et idée): «Cette bague est un souvenir de ma mère».
■ Passé= passé de l'humanité témoignant de son pré
sent pour l'humanité future : passé comme ayant-été
présent voulant rester présent/intéresser l'avenir:
- voir p.
96 référence à Riegl («monument intentionnel»
-+ transmission d'un héritage).
■ Éclat des civilisations passés -+ passé témoignant de
ce qu'il y a de grand/beau en l'homme : histoire= réac
tualisation des valeurs :
- référence à Nietzsche et à Comte p.
98 (passé intéres
sant pour fortifier la croyance en l'homme).
Si le passé n'était pas intéressant, curiosité inexpli
cable des hommes pour «les histoires» :
- voir p.
98 citation de Platon et référence à Paul Veyne.
Donc, intérêt en soi du passé :
parce qu'il est co-présent au présent (fragmentaire
-+ intérêt archéologique: passé passé-présent à recom
poser («puzzle»);
parce qu'il a été un présent/présence de l'homme:
c'est pourquoi on s'intéresse aussi aux fragments «non
intentionnels» du passé: passé= présent-passé humain
à faire revivre.
■
■
■
■
D'où : intérêt pour le passé parce que intérêt du passé
lui-même et en lui-même.
Mais : si c'est l'homme qui est intéressant dans le passé,
nous nous intéressons au passé pour y chercher ce qui
intéresse le présent humain.
II - Pour quelles raisons nous y intéressons-nous?
Éléments d'introduction à li:
Histoire = « récit animé, passionnant, des aventures
humaines» (Marrou, voir p.
98).
Or : l'histoire n'est pas seulement récit, « belles his
toires», mais recherche scientifique/théorique, et le
diplomate/ le politique étudient l'histoire.
Pourquoi ?
Pour y trouver quoi?
1.
Le passé explique le présent.
Faire un plan,
organiser
la réflexion,
c'est articuler
des éléments
d'abord disparates
et venus dans
le désordre.
■ Règle historique traditionnelle du «post hoc, ergo
propter hoc» (explication de l'après par l'avant);
-voir Bloch (exemple p.
96).
Psychanalyse : passé «oublié»/enfoui/ refoulé expli
que mieux mon présent que passé conscient-+ travail de
l'analyse travail scientifique d'historien (connaître son
histoire = se comprendre dans sa vérité de sujet) :
- voir plus haut 1.1 : mémoire = lacunes, désordre, illu
sions -+ histoire vérité.
Passé autre ou passé des autres = passé de notre
présent:
-exemple (voir p.
97).
■
■
Même si elle,n'est
pas exhaustive,
l'argumentation
formera un tout
complet.
Donc, s'intéresser au passé:
• non seulement pour le connaître ;
• mais encore pour se connaître/comprendre.
2.
Utilité....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓