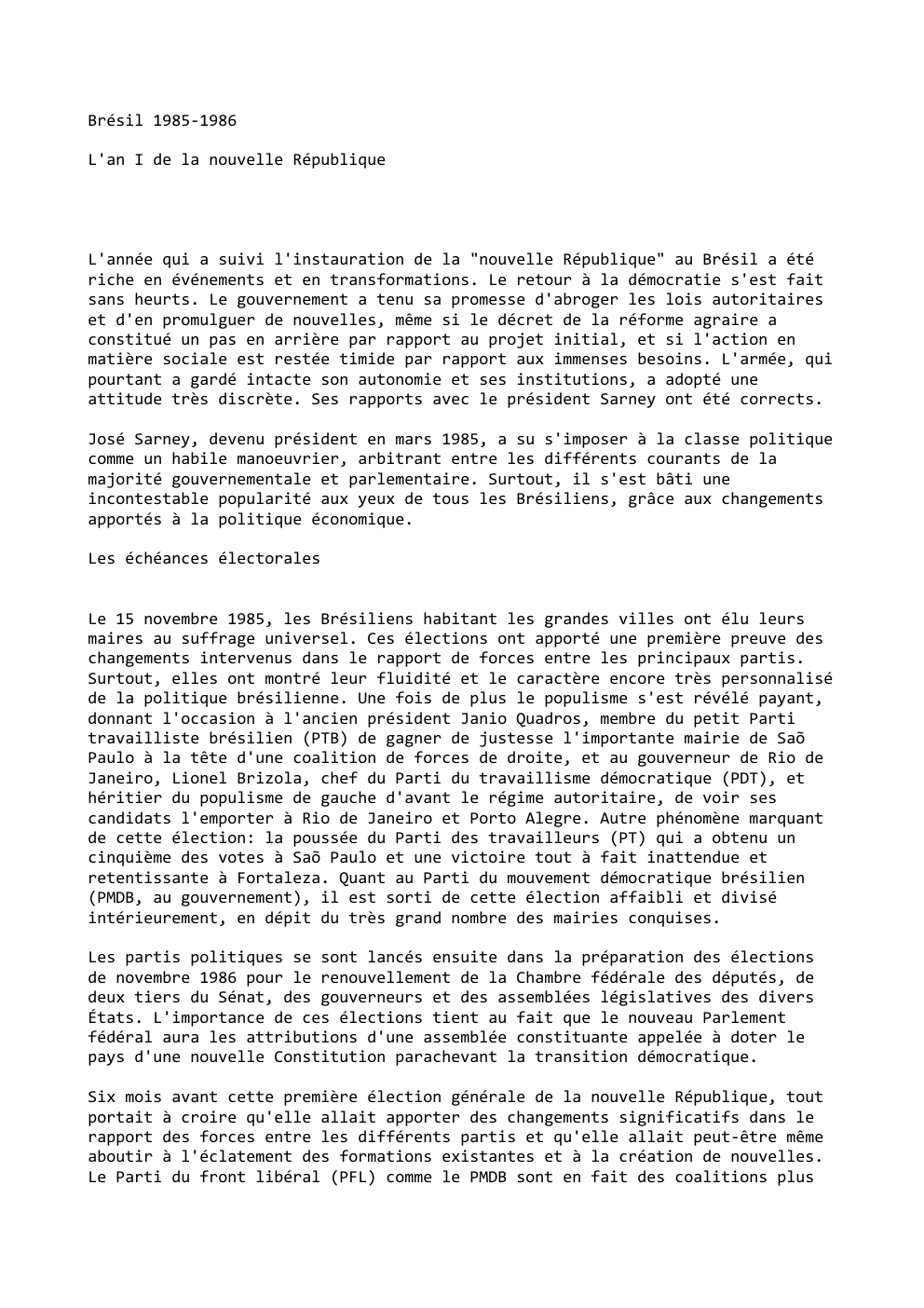Brésil 1985-1986 L'an I de la nouvelle République L'année qui a suivi l'instauration de la "nouvelle République" au Brésil a...
Extrait du document
«
Brésil 1985-1986
L'an I de la nouvelle République
L'année qui a suivi l'instauration de la "nouvelle République" au Brésil a été
riche en événements et en transformations.
Le retour à la démocratie s'est fait
sans heurts.
Le gouvernement a tenu sa promesse d'abroger les lois autoritaires
et d'en promulguer de nouvelles, même si le décret de la réforme agraire a
constitué un pas en arrière par rapport au projet initial, et si l'action en
matière sociale est restée timide par rapport aux immenses besoins.
L'armée, qui
pourtant a gardé intacte son autonomie et ses institutions, a adopté une
attitude très discrète.
Ses rapports avec le président Sarney ont été corrects.
José Sarney, devenu président en mars 1985, a su s'imposer à la classe politique
comme un habile manoeuvrier, arbitrant entre les différents courants de la
majorité gouvernementale et parlementaire.
Surtout, il s'est bâti une
incontestable popularité aux yeux de tous les Brésiliens, grâce aux changements
apportés à la politique économique.
Les échéances électorales
Le 15 novembre 1985, les Brésiliens habitant les grandes villes ont élu leurs
maires au suffrage universel.
Ces élections ont apporté une première preuve des
changements intervenus dans le rapport de forces entre les principaux partis.
Surtout, elles ont montré leur fluidité et le caractère encore très personnalisé
de la politique brésilienne.
Une fois de plus le populisme s'est révélé payant,
donnant l'occasion à l'ancien président Janio Quadros, membre du petit Parti
travailliste brésilien (PTB) de gagner de justesse l'importante mairie de Saõ
Paulo à la tête d'une coalition de forces de droite, et au gouverneur de Rio de
Janeiro, Lionel Brizola, chef du Parti du travaillisme démocratique (PDT), et
héritier du populisme de gauche d'avant le régime autoritaire, de voir ses
candidats l'emporter à Rio de Janeiro et Porto Alegre.
Autre phénomène marquant
de cette élection: la poussée du Parti des travailleurs (PT) qui a obtenu un
cinquième des votes à Saõ Paulo et une victoire tout à fait inattendue et
retentissante à Fortaleza.
Quant au Parti du mouvement démocratique brésilien
(PMDB, au gouvernement), il est sorti de cette élection affaibli et divisé
intérieurement, en dépit du très grand nombre des mairies conquises.
Les partis politiques se sont lancés ensuite dans la préparation des élections
de novembre 1986 pour le renouvellement de la Chambre fédérale des députés, de
deux tiers du Sénat, des gouverneurs et des assemblées législatives des divers
États.
L'importance de ces élections tient au fait que le nouveau Parlement
fédéral aura les attributions d'une assemblée constituante appelée à doter le
pays d'une nouvelle Constitution parachevant la transition démocratique.
Six mois avant cette première élection générale de la nouvelle République, tout
portait à croire qu'elle allait apporter des changements significatifs dans le
rapport des forces entre les différents partis et qu'elle allait peut-être même
aboutir à l'éclatement des formations existantes et à la création de nouvelles.
Le Parti du front libéral (PFL) comme le PMDB sont en fait des coalitions plus
ou moins conjoncturelles de politiciens représentant des courants idéologiques
hétéroclites.
La grande question était de savoir si l'aile centre-gauche du PMDB
réussirait à redonner à son parti une certaine cohésion autour d'un programme
social-démocrate et quelle serait l'évolution du PT qui semblait avoir le vent
en poupe.
Le sort du PMDB est fortement lié à celui du "plan tropical".
Le PFL
avait toutes les raisons d'être satisfait des ministères importants qui lui ont
été attribués par le président Sarney lors de la restructuration du gouvernement
en février 1986.
Mais rien ne prouvait que sa force électorale se verrait
accrue.
La situation était très confuse dans l'État de Saõ Paulo où quatre
candidats se disputaient les faveurs de l'électorat: les représentants du PMDB,
du PT, du PTB et du PDS.
Quant au président Sarney, il pouvait compter sur un solide appui au sein des
principaux partis, à l'exception du PT et du PDT.
Le "plan tropical"
De mars à août 1985, le gouvernement brésilien a essayé en vain de concilier une
politique de rigueur financière conforme aux préceptes du FMI avec le refus
d'accepter la récession et ses conséquences sociales désastreuses.
Un changement de cap décisif dans la politique économique est intervenu en août
1985 avec la nomination de Dilson Funaro au poste clé de ministre des Finances.
L'année 1985 s'est terminée par une croissance très forte (plus de 8% mettant le
Brésil au premier rang mondial), une petite réduction du chômage grâce à la
création de 1,5 million d'emplois, et une amélioration du pouvoir d'achat des
salaires.
La balance des paiements a une fois de plus été très fortement excédentaire
(+12,4 milliards de dollars) au prix d'une compression drastique des
importations, ramenées pratiquement à la moitié des exportations, (25,6
milliards de dollars d'exportations, soit 5% de moins qu'en 1984).
Ce résultat a
été rendu possible par l'essor de la production industrielle remplaçant les
importations et par la baisse des prix du pétrole.
Le Brésil a ainsi réussi à
reconstituer ses réserves en devises et à s'acquitter du service de sa dette
extérieure (laquelle atteint 100 milliards de dollars), moyennant le transfert à
l'étranger de 5% de son PIB, ce qui constitue, à la longue, une saignée
intolérable.
En contrepartie, la dette intérieure a continué sa croissance en boule de neige
du fait de la nécessité de procéder au rachat des devises pour le paiement du
service de la dette extérieure et en raison du coût exorbitant de son recyclage
dans une économie soumise à une inflation de 235% en 1985.
A la fin de 1985, la
dette intérieure atteignait 47% du PIB (contre 24,4% en 1982).
Pour lutter contre l'inflation, le président Sarney....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓