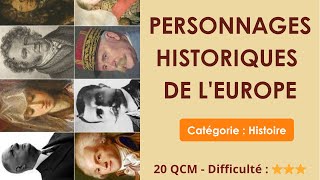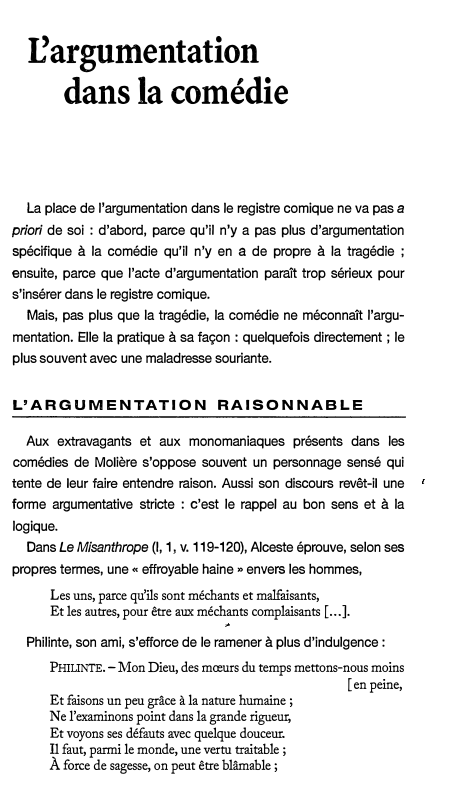Cargumentation dans la comédie La place de l'argumentation dans le registre comique ne va pas a priori de soi :...
Extrait du document
«
Cargumentation
dans la comédie
La place de l'argumentation dans le registre comique ne va pas a
priori de soi : d'abord, parce qu'il n'y a pas plus d'argumentation
spécifique à la comédie qu'il n'y en a de propre à la tragédie ;
ensuite, parce que l'acte d'argumentation paraît trop sérieux pour
s'insérer dans le registre comique.
Mais, pas plus que la tragédie, la comédie ne méconnaît l'argu
mentation.
Elle la pratique à sa façon : quelquefois directement ; le
plus souvent avec une maladresse souriante.
L'ARGUMENTATION RAISONNABLE
Aux extravagants et aux monomaniaques présents dans les
comédies de Molière s'oppose souvent un personnage sensé qui
tente de leur faire entendre raison.
Aussi son discours revêt-il une
forme argumentative stricte : c'est le rappel au bon sens et à la
logique.
Dans Le Misanthrope (1, 1, v.
119-120), Alceste éprouve, selon ses
propres termes, une « effroyable haine » envers les hommes,
Les uns, parce qu'ils sont méchants et malfaisants,
Et les autres, pour être aux méchants complaisants[.•• ].
Philinte, son ami, s'efforce de le ramener à plus d'indulgence :
PHILINTE.
- Mon Dieu, des mœurs du temps mettons-nous moins
[en peine,
Et faisons un peu grâce à la nature humaine ;
Ne l'examinons point dans la grande rigueur,
Et voyons ses défauts avec quelque douceur.
Il faut, parmi le monde, une vertu traitable ;
À force de sagesse, on peut être blâmable ;
La parfaite raison fuit toute extrémité,
Et veut que l'on soit sage avec sobriété.
Cette grande raideur des vertus des vieux âges
Heurte trop notre siècle et les communs usages ;
Elle veut aux mortels trop de perfection :
Il faut fléchir au temps sans obstination ;
Et c'est une folie à nulle autre seconde
De vouloir se mêler de corriger le monde.
J'observe, comme vous, cent choses tous les jours,
Qui pourraient mieux aller, prenant un autre cours ;
Mais quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître,
En courroux, comme vous, on ne me voit point être ;
Je prends tout doucement les hommes comme ils sont,
J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font;
Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville,
Mon flegme est philosophe autant que votre bile.
(Le Misanthrope, I, 1, v.
145-166.)
Le discours de Philinte est structuré de la manière suivante :
- un appel à la modération : « mettons-nous moins en peine » ; « faisons un peu grâce ».
Les verbes ont valeur d'exhortation : le pluriel
se veut généralisant ;
- la justification de cet appel, qui s'appuie sur des impératifs moraux
et sociaux (« Il faut »).
D'où l'emploi de vers maximes (« À force de
sagesse, on peut être blâmable ») qui illustrent la nécessité de la
bienséance et du juste milieu ;
- le témoignage personnel (« J'observe comme vous ...
») ;
- l'accord sur le constat débouche toutefois sur un désaccord quant
à l'attitude à adopter.
Reste à apprécier la valeur dramaturgique de cette argumentation.
La
«
sagesse
»
de Philinte fait, par contraste, mieux ressortir la
«folie» d'Alceste.
L'ARGUMENTATION MALADROITE
Le raisonnement faux est l'un des ressorts traditionnels du
comique.
Plus un personnage cherche à convaincre, plus il se perd
dans sa démonstration.
L'écart entre l'intention et le résultat devient
alors si grand que le rire fuse.
LA COMÉDIE
109
Dans Dom Juan, Sganarelle s'indigne de l'athéisme de son maître.
Il essaie de le convaincre de l'existence de Dieu :
DOM JUAN.
- Je crois que deux et deux sont quatre, Sganarelle, et
que quatre et quatre sont huit.
SGANARELLE.
- La belle croyance et les beaux articles de foi que
voilà ! Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique ? Il
faut avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des hommes,
et que pour avoir bien étudié on est bien moins sage le plus souvent.
Pour moi, Monsieur, je n'ai point étudié comme vous.
Dieu
merci, et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien
appris ; mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les
choses mieux que tous les livres, et je comprends fort bien que ce
monde que nous voyons n'est pas un champignon, qui soit venu
tout seul en une nuit.
Je voudrais bien vous demander qui a fait ces
arbres-là, ces rochers, cette terre, et ce ciel que voilà là-haut, et si
tout cela s'est bâti de lui-même.
Vous voilà vous, par exemple, vous
êtes là : est-ce que vous vous êtes fait tout seul, et n'a-t-il pas fallu
que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire ? Pouvezvous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme est
composée sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans
l'autre : ces nerfs, ces os, ces veines, ces artères, ces ...
ce poumon,
ce cœur, ce foie, et tous ces autres ingrédients qui sont là, et qui ...
Oh ! dame, interrompez-moi donc si vous voulez : je ne saurais disputer sil'on ne m'interrompt ; vous vous taisez exprès et me laissez
parler par belle malice.
DoMJUAN.
- J'attends que ton raisonnement soit fini.
SGANARELLE.
- Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose
d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, que tous les
savants ne sauraient expliquer.
Cela n'est-il pas merveilleux que me
voilà ici, et que j'aie quelque chose dans la tête qui pense cent
choses différentes en un moment, et fait de mon corps tout ce
qu'elle veut ? Je veux frapper des mains, hausser le bras, lever les
yeux au ciel, baisser la tête, remuer les pieds, aller à droit, à gauche,
en avant, en arrière, tourner...
(Il se laisse tomber en tournant.)
DOM JUAN.
- Bon ! voilà ton raisonnement qui a le nez cassé.
(Dom Juan, ll, 1.)
Le raisonnement de Sganarelle se discrédite de lui-même : il
repose sur le paradoxe que moins on a appris plus on sait.
Que le
monde soit une création divine est une idée classique en théologie.
Mais l'énumération à laquelle se livre Sganarelle est en elle-même
comique, par sa longue référence aux différents organes humains.
110
LA
COMÉDIE
Elle l'est d'autant plus que Sganarelle perd le fil de son raisonnement.
Pour preuve de la complexité du corps humain, il finit par
donner la possibilité de faire des gestes élémentaires, qui provoquent sa chute ! Il tombe avec son raisonnement.
L'effet comique
est certain.
LA FAUSSE ARGUMENTATION
De la fausse argumentation naît le comique de l'absurde : l'apparent respect d'une structure logique aboutit à une incohérence intellectuelle.
Le syllogisme, par exemple, est la forme la plus ancienne du raisonnement déductif.
De deux propositions appelées prémisses
découle une troisième, la conclusion.
L'exemple de syllogisme le
plus célèbre est le suivant :
Tous les hommes sont mortels (prémisse majeure)
Or Socrate est un homme (prémisse mineure)
Donc Socrate est mortel (conclusion).
Voici comment, dans Rhinocéros (1958), de Ionesco, le Logicien
déforme le syllogisme :
Le Logicien, au Vieux Monsieur.
- Voici un syllogisme exemplaire.
Le chat a quatre pattes.
Isidore et Fricot ont chacun quatre pattes.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓