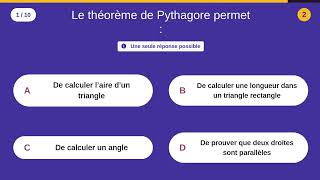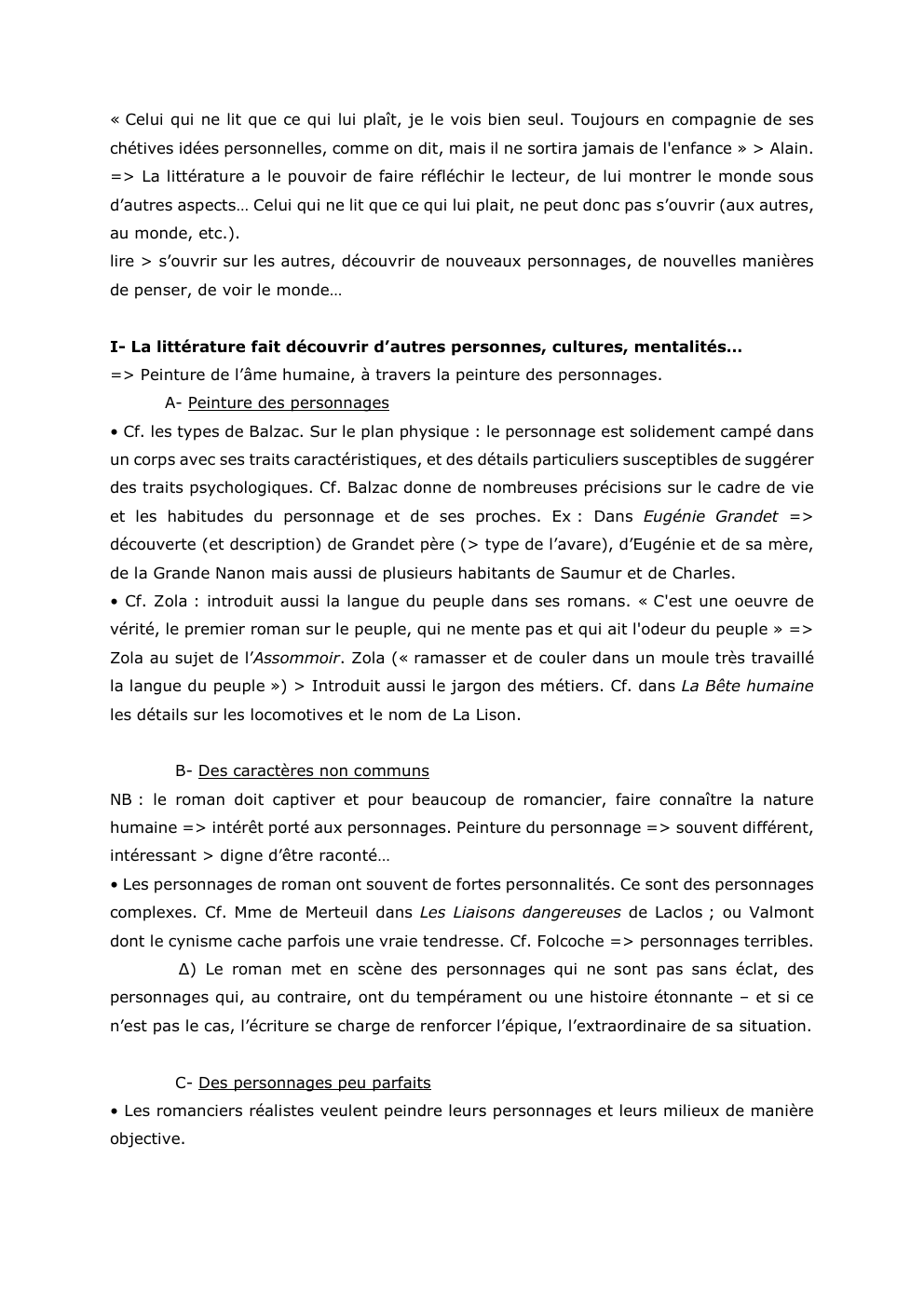« Celui qui ne lit que ce qui lui plaît, je le vois bien seul. Toujours en compagnie de ses...
Extrait du document
«
« Celui qui ne lit que ce qui lui plaît, je le vois bien seul.
Toujours en compagnie de ses
chétives idées personnelles, comme on dit, mais il ne sortira jamais de l'enfance » > Alain.
=> La littérature a le pouvoir de faire réfléchir le lecteur, de lui montrer le monde sous
d’autres aspects… Celui qui ne lit que ce qui lui plait, ne peut donc pas s’ouvrir (aux autres,
au monde, etc.).
lire > s’ouvrir sur les autres, découvrir de nouveaux personnages, de nouvelles manières
de penser, de voir le monde…
I- La littérature fait découvrir d’autres personnes, cultures, mentalités…
=> Peinture de l’âme humaine, à travers la peinture des personnages.
A- Peinture des personnages
• Cf.
les types de Balzac.
Sur le plan physique : le personnage est solidement campé dans
un corps avec ses traits caractéristiques, et des détails particuliers susceptibles de suggérer
des traits psychologiques.
Cf.
Balzac donne de nombreuses précisions sur le cadre de vie
et les habitudes du personnage et de ses proches.
Ex : Dans Eugénie Grandet =>
découverte (et description) de Grandet père (> type de l’avare), d’Eugénie et de sa mère,
de la Grande Nanon mais aussi de plusieurs habitants de Saumur et de Charles.
• Cf.
Zola : introduit aussi la langue du peuple dans ses romans.
« C'est une oeuvre de
vérité, le premier roman sur le peuple, qui ne mente pas et qui ait l'odeur du peuple » =>
Zola au sujet de l’Assommoir.
Zola (« ramasser et de couler dans un moule très travaillé
la langue du peuple ») > Introduit aussi le jargon des métiers.
Cf.
dans La Bête humaine
les détails sur les locomotives et le nom de La Lison.
B- Des caractères non communs
NB : le roman doit captiver et pour beaucoup de romancier, faire connaître la nature
humaine => intérêt porté aux personnages.
Peinture du personnage => souvent différent,
intéressant > digne d’être raconté…
• Les personnages de roman ont souvent de fortes personnalités.
Ce sont des personnages
complexes.
Cf.
Mme de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses de Laclos ; ou Valmont
dont le cynisme cache parfois une vraie tendresse.
Cf.
Folcoche => personnages terribles.
∆) Le roman met en scène des personnages qui ne sont pas sans éclat, des
personnages qui, au contraire, ont du tempérament ou une histoire étonnante – et si ce
n’est pas le cas, l’écriture se charge de renforcer l’épique, l’extraordinaire de sa situation.
C- Des personnages peu parfaits
• Les romanciers réalistes veulent peindre leurs personnages et leurs milieux de manière
objective.
=> Les auteurs montrent et insistent sur les mauvais côtés des personnages ou leurs
aspects communs.
Par exemple, Charles Bovary est une sorte de anti-héros ; il est falot, sans envergure.
Ex
aussi le mari de Folcoche dans Vipère au poing => homme faible, qui ne défend pas ses
enfants, ne les protège pas.
• Pour Zola, « le premier homme qui passe est un héros suffisant ».
Chacun peut être un
héros, même les descendants des Macquart qui sont tous des personnages soit alcooliques
(Jacques dans La Bête humaine), soit à petite vertu (Nana), etc.
• Georges Duroy dans Bel-Ami, apparaît finalement comme quelqu’un de très médiocre,
plein de défauts, aux manières douteuses et qui n’a pas l’éclat d’un Valmont.
Son ascension
sociale est certes réelle mais elle n’est due qu’à des combines (des mariages, un divorce,
l’adultère, l’hypocrisie…).
∆) Véritables travail et talent de l’écrivain qui, finement, peint les consciences, les
contradictions, les conceptions, les idées de ses personnages => lecteur découvre la
pensée d’un père corse (Cf.
la Vendetta de Balzac), d’un Normand un peu avare (Cf.
La
Ficelle de Maupassant), d’une jeune femme qui découvre la vie (La Femme de trente ans,
Une vie, Madame Bovary…).
Grande précision dans la psychologie du personnage.
Cf.
le
portrait de Balzac de la Vieille fille ou de Grandet.
Cf.
les portraits de Julien Sorel (> vu
par Mme de Rênal, le narrateur, Mathilde…).
II- La littérature fait réfléchir
A- Une littérature utile
• Pour Voltaire => littérature doit être efficace, elle doit avoir un rôle dans la société.
Sartre : « Nous ne voulons pas avoir honte d'écrire et nous n'avons pas envie de parler
pour ne rien dire.
(...) nous voulons que l'écrivain embrasse étroitement son époque ».
• Cf.
aussi Hugo qui voulait que le poète soit un mage, un prophète qui guide le peuple.
Engagement politique.
Hugo : Les Châtiments, lutte contre Napoléon III (se moque de lui
« petit, petit, petit », « le singe » et le montre comme un ogre sanguinaire).
Ex :
« Souvenir de la nuit du 4 » => poème très touchant, le lecteur est influencé (talent de
conteur, de poète, images de la vie quotidienne, du désespoir de la vieille femme, de
l’injustice…=> arme rhétorique).
B- Le recours à la littérature pour dénoncer/argumenter
• Au XIXe siècle, le roman voulait être un miroir de la société : dénonciation des injustices
sociales.
Hugo dénonce la misère dans Les Misérables, à travers plusieurs personnages touchants
et vivants.
Ce ne sont pas des types ; ont leurs défauts et leurs qualités => ressemblent
au lecteur.
Cf.
Cosette, Fantine, Valjean…
• Lorsque le narrateur est « je », l’identification est plus forte : Hugo utilise donc cette
technique pour dénoncer la peine de mort dans Le Dernier jour d’un condamné > le
narrateur est celui qui va se faire guillotiner => le lecteur se sent proche de lui, compatit
(et presque se met à sa place) => le lecteur sent donc toute l’atrocité de la peine de mort
– surtout à la fin puisque....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓