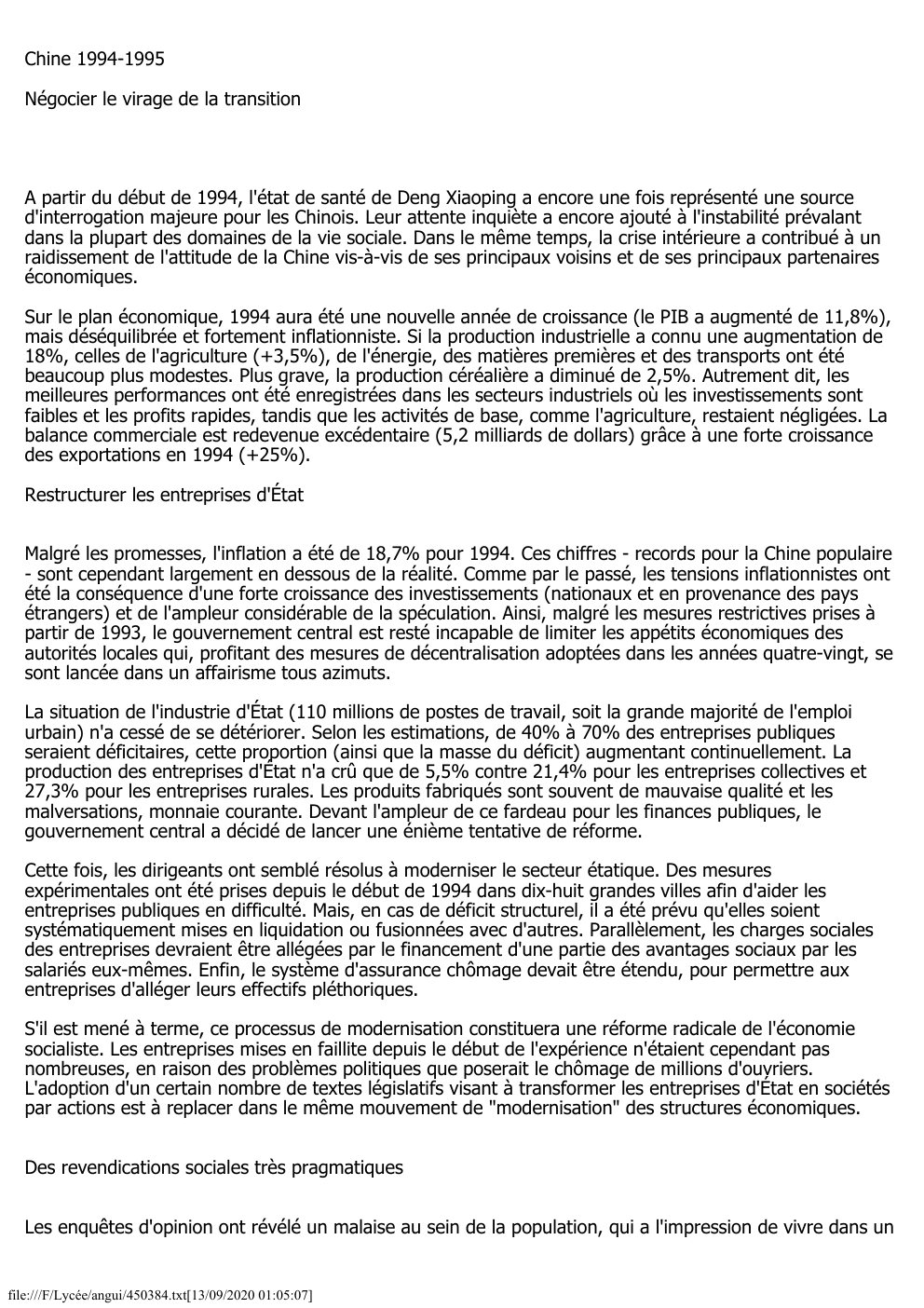Chine 1994-1995 Négocier le virage de la transition A partir du début de 1994, l'état de santé de Deng Xiaoping...
Extrait du document
«
Chine 1994-1995
Négocier le virage de la transition
A partir du début de 1994, l'état de santé de Deng Xiaoping a encore une fois représenté une source
d'interrogation majeure pour les Chinois.
Leur attente inquiète a encore ajouté à l'instabilité prévalant
dans la plupart des domaines de la vie sociale.
Dans le même temps, la crise intérieure a contribué à un
raidissement de l'attitude de la Chine vis-à-vis de ses principaux voisins et de ses principaux partenaires
économiques.
Sur le plan économique, 1994 aura été une nouvelle année de croissance (le PIB a augmenté de 11,8%),
mais déséquilibrée et fortement inflationniste.
Si la production industrielle a connu une augmentation de
18%, celles de l'agriculture (+3,5%), de l'énergie, des matières premières et des transports ont été
beaucoup plus modestes.
Plus grave, la production céréalière a diminué de 2,5%.
Autrement dit, les
meilleures performances ont été enregistrées dans les secteurs industriels où les investissements sont
faibles et les profits rapides, tandis que les activités de base, comme l'agriculture, restaient négligées.
La
balance commerciale est redevenue excédentaire (5,2 milliards de dollars) grâce à une forte croissance
des exportations en 1994 (+25%).
Restructurer les entreprises d'État
Malgré les promesses, l'inflation a été de 18,7% pour 1994.
Ces chiffres - records pour la Chine populaire
- sont cependant largement en dessous de la réalité.
Comme par le passé, les tensions inflationnistes ont
été la conséquence d'une forte croissance des investissements (nationaux et en provenance des pays
étrangers) et de l'ampleur considérable de la spéculation.
Ainsi, malgré les mesures restrictives prises à
partir de 1993, le gouvernement central est resté incapable de limiter les appétits économiques des
autorités locales qui, profitant des mesures de décentralisation adoptées dans les années quatre-vingt, se
sont lancée dans un affairisme tous azimuts.
La situation de l'industrie d'État (110 millions de postes de travail, soit la grande majorité de l'emploi
urbain) n'a cessé de se détériorer.
Selon les estimations, de 40% à 70% des entreprises publiques
seraient déficitaires, cette proportion (ainsi que la masse du déficit) augmentant continuellement.
La
production des entreprises d'État n'a crû que de 5,5% contre 21,4% pour les entreprises collectives et
27,3% pour les entreprises rurales.
Les produits fabriqués sont souvent de mauvaise qualité et les
malversations, monnaie courante.
Devant l'ampleur de ce fardeau pour les finances publiques, le
gouvernement central a décidé de lancer une énième tentative de réforme.
Cette fois, les dirigeants ont semblé résolus à moderniser le secteur étatique.
Des mesures
expérimentales ont été prises depuis le début de 1994 dans dix-huit grandes villes afin d'aider les
entreprises publiques en difficulté.
Mais, en cas de déficit structurel, il a été prévu qu'elles soient
systématiquement mises en liquidation ou fusionnées avec d'autres.
Parallèlement, les charges sociales
des entreprises devraient être allégées par le financement d'une partie des avantages sociaux par les
salariés eux-mêmes.
Enfin, le système d'assurance chômage devait être étendu, pour permettre aux
entreprises d'alléger leurs effectifs pléthoriques.
S'il est mené à terme, ce processus de modernisation constituera une réforme radicale de l'économie
socialiste.
Les entreprises mises en faillite depuis le début de l'expérience n'étaient cependant pas
nombreuses, en raison des problèmes politiques que poserait le chômage de millions d'ouvriers.
L'adoption d'un certain nombre de textes législatifs visant à transformer les entreprises d'État en sociétés
par actions est à replacer dans le même mouvement de "modernisation" des structures économiques.
Des revendications sociales très pragmatiques
Les enquêtes d'opinion ont révélé un malaise au sein de la population, qui a l'impression de vivre dans un
file:///F/Lycée/angui/450384.txt[13/09/2020 01:05:07]
monde de plus en plus instable.
Au premier rang des préoccupations populaires, figure la détérioration
des conditions de vie.
Dans les villes, sous le double coup de l'inflation et de la restructuration de l'emploi
public, les revenus d'une partie importante de la population ont subi une baisse significative.
Selon les
chiffres officiels, 8% des résidents vivraient en dessous du seuil de pauvreté.
Beaucoup d'entreprises
publiques ne peuvent plus payer leurs salariés, et certaines provinces ont dû verser des aides
exceptionnelles à des familles en difficulté "afin qu'elles passent correctement les fêtes du nouvel an
(1995)".
Des milliers de grèves et de manifestations ont éclaté un peu partout en Chine, en particulier
dans les provinces du Nord-Est, afin de protester contre le non-paiement des salaires ou contre des
fermetures d'usine.
Les mouvements ont parfois dégénéré dans la violence: bâtiments officiels incendiés,
responsables molestés, etc.
Très souvent, les autorités ont cédé devant les revendications pour éviter
tout risque de troubles politiques.
Les entreprises à capitaux asiatiques (Hong Kong, Taïwan, Corée du Sud) ont été le théâtre de nombreux
conflits du travail.
Ce sont là principalement les conditions de travail qui ont été critiquées: 14 heures de
labeur quotidien, absence de sécurité et d'hygiène, précarité de l'emploi, mauvais traitements, etc.
Les
autorités locales ne sont, en effet, pas très regardantes sur la façon dont peuvent être éventuellement
malmenés les ouvriers chinois à partir du moment où une partie significative des profits tombe dans leur
escarcelle.
Des syndicats clandestins indépendants ont été créés ici ou là.
De nombreux incidents ont opposé les autorités locales aux paysans.
Dans certains cas, plusieurs milliers
d'entre eux ont pillé les sièges du Parti ou de l'administration et battu des responsables.
Ici, on protestait
contre des taxes et des impôts illégaux décidés par l'administration, diminuant d'autant le revenu paysan,
en très net recul par rapport au revenu urbain.
Ailleurs, on s'est insurgé contre la confiscation de terres
arables par l'armée, sans compensation suffisante.
Enfin, les mouvements de protestation parmi les entrepreneurs privés se sont multipliés.
Des grèves ont
éclaté dans les marchés, des conducteurs de taxis ont manifesté contre des mesures jugées injustes, des
percepteurs ont été agressés par des commerçants ayant le sentiment d'être rackettés.
L'ordre établi n'a cependant jamais été remis en cause.
Les ouvriers exigeaient seulement que l'État
continue de jouer son rôle de "défenseur de la classe ouvrière".
Les paysans réclamaient de bons
despotes, tandis que les entrepreneurs individuels demandaient avant tout qu'on les laisse tranquillement
faire leurs affaires.
Le sentiment d'insécurité qui s'est développé dans la population est aussi lié à l'explosion de la criminalité.
Les actions de bandes de brigands qui pillent ou rançonnent les voyageurs sur les axes routiers ou dans
les trains ont été en recrudescence.
Les migrations vers les villes ont conduit à une multiplication des
actes criminels commis par des paysans sans travail, tandis que le développement des triades de Hong
Kong a défrayé la chronique à de multiples reprises.
Enfin, l'avidité des cadres a continué de grandir et la corruption à faire des ravages.
Face à cette
criminalité, les autorités semblaient impuissantes.
Certes, le début de l'année 1995 a encore été marqué
par l'exécution sans grand discernement de plusieurs centaines de personnes accusées d'être des
assassins, trafiquants de drogue, proxénètes, petits fonctionnaires corrompus, etc., mais, de l'aveu même
des autorités,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓