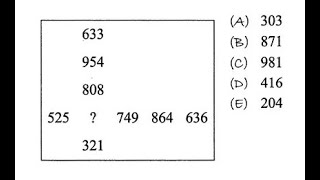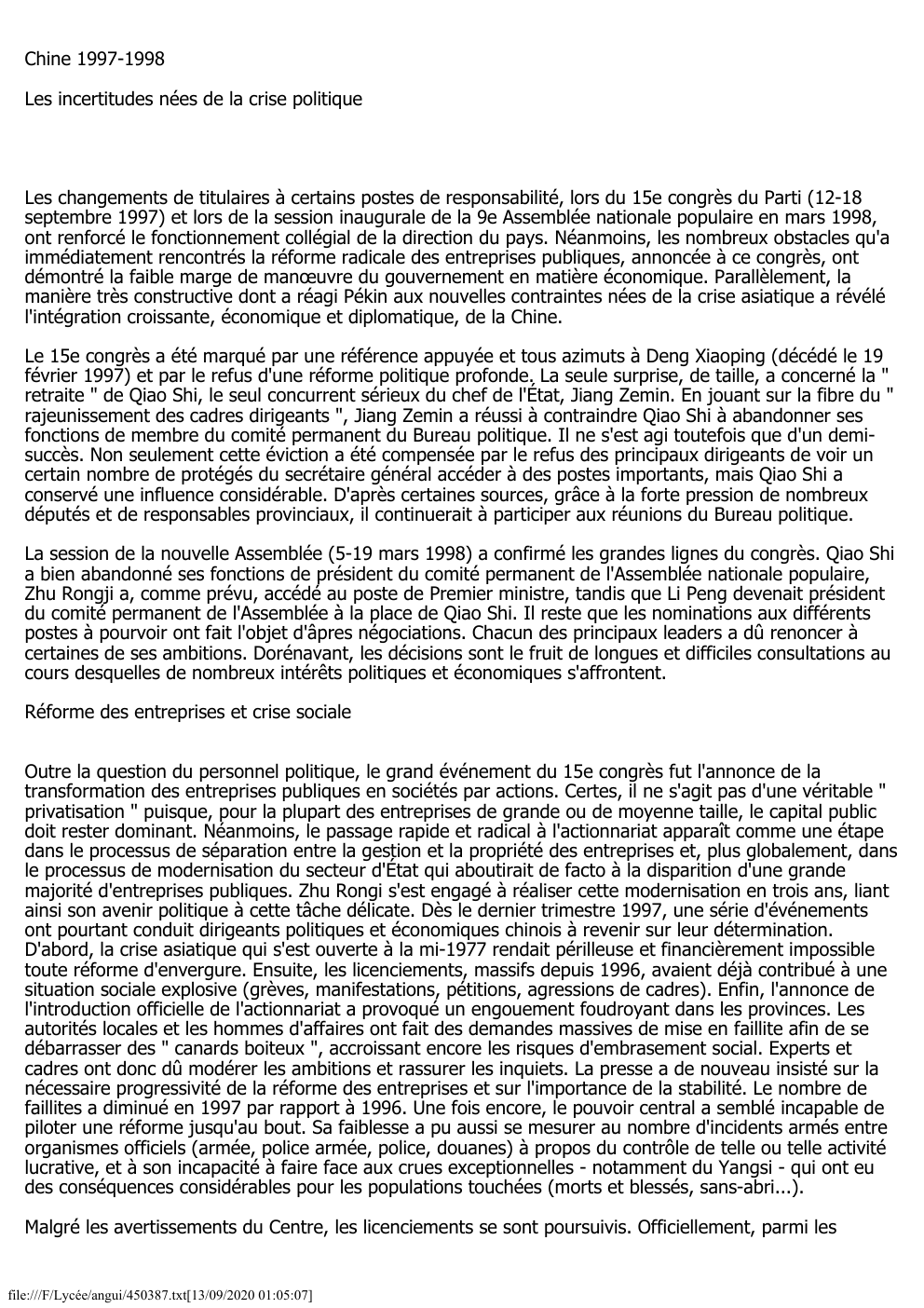Chine 1997-1998 Les incertitudes nées de la crise politique Les changements de titulaires à certains postes de responsabilité, lors du...
Extrait du document
«
Chine 1997-1998
Les incertitudes nées de la crise politique
Les changements de titulaires à certains postes de responsabilité, lors du 15e congrès du Parti (12-18
septembre 1997) et lors de la session inaugurale de la 9e Assemblée nationale populaire en mars 1998,
ont renforcé le fonctionnement collégial de la direction du pays.
Néanmoins, les nombreux obstacles qu'a
immédiatement rencontrés la réforme radicale des entreprises publiques, annoncée à ce congrès, ont
démontré la faible marge de manœuvre du gouvernement en matière économique.
Parallèlement, la
manière très constructive dont a réagi Pékin aux nouvelles contraintes nées de la crise asiatique a révélé
l'intégration croissante, économique et diplomatique, de la Chine.
Le 15e congrès a été marqué par une référence appuyée et tous azimuts à Deng Xiaoping (décédé le 19
février 1997) et par le refus d'une réforme politique profonde.
La seule surprise, de taille, a concerné la "
retraite " de Qiao Shi, le seul concurrent sérieux du chef de l'État, Jiang Zemin.
En jouant sur la fibre du "
rajeunissement des cadres dirigeants ", Jiang Zemin a réussi à contraindre Qiao Shi à abandonner ses
fonctions de membre du comité permanent du Bureau politique.
Il ne s'est agi toutefois que d'un demisuccès.
Non seulement cette éviction a été compensée par le refus des principaux dirigeants de voir un
certain nombre de protégés du secrétaire général accéder à des postes importants, mais Qiao Shi a
conservé une influence considérable.
D'après certaines sources, grâce à la forte pression de nombreux
députés et de responsables provinciaux, il continuerait à participer aux réunions du Bureau politique.
La session de la nouvelle Assemblée (5-19 mars 1998) a confirmé les grandes lignes du congrès.
Qiao Shi
a bien abandonné ses fonctions de président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire,
Zhu Rongji a, comme prévu, accédé au poste de Premier ministre, tandis que Li Peng devenait président
du comité permanent de l'Assemblée à la place de Qiao Shi.
Il reste que les nominations aux différents
postes à pourvoir ont fait l'objet d'âpres négociations.
Chacun des principaux leaders a dû renoncer à
certaines de ses ambitions.
Dorénavant, les décisions sont le fruit de longues et difficiles consultations au
cours desquelles de nombreux intérêts politiques et économiques s'affrontent.
Réforme des entreprises et crise sociale
Outre la question du personnel politique, le grand événement du 15e congrès fut l'annonce de la
transformation des entreprises publiques en sociétés par actions.
Certes, il ne s'agit pas d'une véritable "
privatisation " puisque, pour la plupart des entreprises de grande ou de moyenne taille, le capital public
doit rester dominant.
Néanmoins, le passage rapide et radical à l'actionnariat apparaît comme une étape
dans le processus de séparation entre la gestion et la propriété des entreprises et, plus globalement, dans
le processus de modernisation du secteur d'État qui aboutirait de facto à la disparition d'une grande
majorité d'entreprises publiques.
Zhu Rongi s'est engagé à réaliser cette modernisation en trois ans, liant
ainsi son avenir politique à cette tâche délicate.
Dès le dernier trimestre 1997, une série d'événements
ont pourtant conduit dirigeants politiques et économiques chinois à revenir sur leur détermination.
D'abord, la crise asiatique qui s'est ouverte à la mi-1977 rendait périlleuse et financièrement impossible
toute réforme d'envergure.
Ensuite, les licenciements, massifs depuis 1996, avaient déjà contribué à une
situation sociale explosive (grèves, manifestations, pétitions, agressions de cadres).
Enfin, l'annonce de
l'introduction officielle de l'actionnariat a provoqué un engouement foudroyant dans les provinces.
Les
autorités locales et les hommes d'affaires ont fait des demandes massives de mise en faillite afin de se
débarrasser des " canards boiteux ", accroissant encore les risques d'embrasement social.
Experts et
cadres ont donc dû modérer les ambitions et rassurer les inquiets.
La presse a de nouveau insisté sur la
nécessaire progressivité de la réforme des entreprises et sur l'importance de la stabilité.
Le nombre de
faillites a diminué en 1997 par rapport à 1996.
Une fois encore, le pouvoir central a semblé incapable de
piloter une réforme jusqu'au bout.
Sa faiblesse a pu aussi se mesurer au nombre d'incidents armés entre
organismes officiels (armée, police armée, police, douanes) à propos du contrôle de telle ou telle activité
lucrative, et à son incapacité à faire face aux crues exceptionnelles - notamment du Yangsi - qui ont eu
des conséquences considérables pour les populations touchées (morts et blessés, sans-abri...).
Malgré les avertissements du Centre, les licenciements se sont poursuivis.
Officiellement, parmi les
file:///F/Lycée/angui/450387.txt[13/09/2020 01:05:07]
quelque 12 millions de licenciés en 1997, près de 5 millions n'ont pas retrouvé de travail.
En raison de la
multitude des catégories de personnes sans travail (chômeurs indemnisés, licenciés conservant un maigre
revenu, retraités sans pensions, salariés qui n'ont plus de poste de travail), il est toutefois très difficile
d'avancer des chiffres précis.
Début 1998, des statistiques officielles évaluaient les chômeurs urbains à 8
millions, mais d'autres estimations, fournies par la presse officielle, donnaient 13 millions, voire 15,5
millions de sans-emploi.
Des sources de Hong Kong allaient jusqu'à 30 millions.
Par ailleurs, le nombre de
travailleurs " surnuméraires " s'élevait à 22 millions en ville et à 175 millions dans les campagnes à la fin
de 1997, ce qui semble très en dessous de la vérité.
Quoi qu'il en soit, la politique de " réemploi ",
adoptée en 1996, est devenue une véritable priorité.
Elle a pour objectif de faciliter le redéploiement de la
main-d'œuvre mais, en réalité, seuls des " petits boulots " ou des activités précaires sont proposés.
Le chômage, les retards de paiement de salaire, la corruption et le racket fiscal dont est victime la
population rurale, l'augmentation continuelle de la criminalité ont accru le mécontentement social.
Des
émeutes ont éclaté dans de nombreuses régions rurales et des conflits très violents ont opposé ouvriers
urbains et autorités, notamment dans des villes....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓