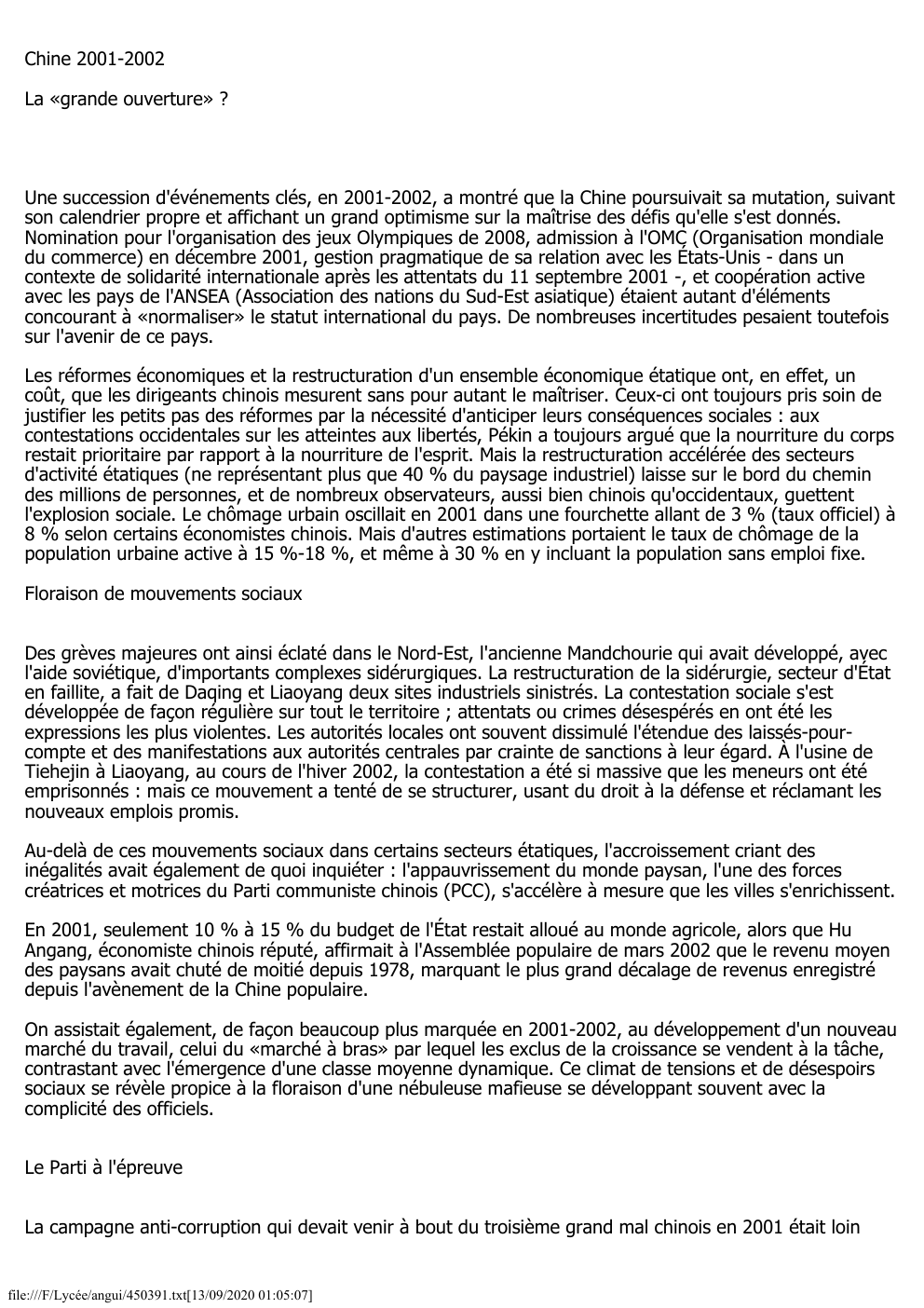Chine 2001-2002 La «grande ouverture» ? Une succession d'événements clés, en 2001-2002, a montré que la Chine poursuivait sa mutation,...
Extrait du document
«
Chine 2001-2002
La «grande ouverture» ?
Une succession d'événements clés, en 2001-2002, a montré que la Chine poursuivait sa mutation, suivant
son calendrier propre et affichant un grand optimisme sur la maîtrise des défis qu'elle s'est donnés.
Nomination pour l'organisation des jeux Olympiques de 2008, admission à l'OMC (Organisation mondiale
du commerce) en décembre 2001, gestion pragmatique de sa relation avec les États-Unis - dans un
contexte de solidarité internationale après les attentats du 11 septembre 2001 -, et coopération active
avec les pays de l'ANSEA (Association des nations du Sud-Est asiatique) étaient autant d'éléments
concourant à «normaliser» le statut international du pays.
De nombreuses incertitudes pesaient toutefois
sur l'avenir de ce pays.
Les réformes économiques et la restructuration d'un ensemble économique étatique ont, en effet, un
coût, que les dirigeants chinois mesurent sans pour autant le maîtriser.
Ceux-ci ont toujours pris soin de
justifier les petits pas des réformes par la nécessité d'anticiper leurs conséquences sociales : aux
contestations occidentales sur les atteintes aux libertés, Pékin a toujours argué que la nourriture du corps
restait prioritaire par rapport à la nourriture de l'esprit.
Mais la restructuration accélérée des secteurs
d'activité étatiques (ne représentant plus que 40 % du paysage industriel) laisse sur le bord du chemin
des millions de personnes, et de nombreux observateurs, aussi bien chinois qu'occidentaux, guettent
l'explosion sociale.
Le chômage urbain oscillait en 2001 dans une fourchette allant de 3 % (taux officiel) à
8 % selon certains économistes chinois.
Mais d'autres estimations portaient le taux de chômage de la
population urbaine active à 15 %-18 %, et même à 30 % en y incluant la population sans emploi fixe.
Floraison de mouvements sociaux
Des grèves majeures ont ainsi éclaté dans le Nord-Est, l'ancienne Mandchourie qui avait développé, avec
l'aide soviétique, d'importants complexes sidérurgiques.
La restructuration de la sidérurgie, secteur d'État
en faillite, a fait de Daqing et Liaoyang deux sites industriels sinistrés.
La contestation sociale s'est
développée de façon régulière sur tout le territoire ; attentats ou crimes désespérés en ont été les
expressions les plus violentes.
Les autorités locales ont souvent dissimulé l'étendue des laissés-pourcompte et des manifestations aux autorités centrales par crainte de sanctions à leur égard.
À l'usine de
Tiehejin à Liaoyang, au cours de l'hiver 2002, la contestation a été si massive que les meneurs ont été
emprisonnés : mais ce mouvement a tenté de se structurer, usant du droit à la défense et réclamant les
nouveaux emplois promis.
Au-delà de ces mouvements sociaux dans certains secteurs étatiques, l'accroissement criant des
inégalités avait également de quoi inquiéter : l'appauvrissement du monde paysan, l'une des forces
créatrices et motrices du Parti communiste chinois (PCC), s'accélère à mesure que les villes s'enrichissent.
En 2001, seulement 10 % à 15 % du budget de l'État restait alloué au monde agricole, alors que Hu
Angang, économiste chinois réputé, affirmait à l'Assemblée populaire de mars 2002 que le revenu moyen
des paysans avait chuté de moitié depuis 1978, marquant le plus grand décalage de revenus enregistré
depuis l'avènement de la Chine populaire.
On assistait également, de façon beaucoup plus marquée en 2001-2002, au développement d'un nouveau
marché du travail, celui du «marché à bras» par lequel les exclus de la croissance se vendent à la tâche,
contrastant avec l'émergence d'une classe moyenne dynamique.
Ce climat de tensions et de désespoirs
sociaux se révèle propice à la floraison d'une nébuleuse mafieuse se développant souvent avec la
complicité des officiels.
Le Parti à l'épreuve
La campagne anti-corruption qui devait venir à bout du troisième grand mal chinois en 2001 était loin
file:///F/Lycée/angui/450391.txt[13/09/2020 01:05:07]
d'avoir atteint ses objectifs.
À Shenyang, le maire et son adjoint ont été condamnés à mort en mars 2002
pour détournement de fonds et liens avec la mafia locale.
Les exécutions capitales - dorénavant par
injection - pour motif de corruption aggravée se sont multipliées, mais il est apparu de plus en plus
transparent que le phénomène n'était pas seulement le fait de quelques individus isolés, mais qu'il avait
un caractère plus systémique.
Si, depuis le début de la campagne, les condamnations avaient touché
symboliquement de hauts cadres, les autorités centrales n'ont pas souhaité aller plus avant dans l'examen
des circuits de cette corruption, restée protégée par la «machine-parti».
Les populations locales ont bien
saisi ces dysfonctionnements et il est devenu de plus en plus difficile pour le Parti de rester crédible
localement.
Le cas des élections de village est en cela révélateur.
Lancée en 1987 et révisée en 1998 (avec garantie
de la confidentialité du vote et mise en place de primaires pour sélectionner les candidats), la Loi sur les
comités de villages visait surtout à améliorer les relations entre les cadres locaux et les villageois, et à
relégitimer le PCC auprès de sa base rurale.
Le scandale électoral intervenu dans le village de Shilaoren
(Shandong) en janvier 2002 a illustré la forte méfiance existant entre la base et les cadres : face aux
candidats imposés par les cadres dirigeants locaux et les confiscations de cartes d'électeur, les villageois
ont, dans une grande majorité, choisi d'apposer sur leur bulletin le nom de leur favori, conduisant
cependant celui-ci en prison.
La grande réforme du Parti, annoncée par le président Jiang Zemin à l'occasion du 80e anniversaire du
PCC en juillet 2001, pourrait creuser encore davantage l'écart avec la base, un danger que le même Hu
Angang a souligné à l'Assemblée populaire de mars 2002.
La Chine compte quelque 600 millions de
paysans dont les revenus sont bloqués depuis le milieu des années 1980 et qui pâtiront les premiers des
contraintes qu'imposeront les règles de l'OMC.
La mutation du Parti annoncée par Jiang Zemin devait
entériner l'adhésion des nouvelles forces entrepreneuriales chinoises, les capitalistes jusque-là bannis.
Justifiant sa décision par la primauté de la loyauté au Parti sur la notion de propriété, Jiang Zemin a
amorcé ainsi la transformation d'un Parti populaire en un «parti des forces sociales montantes», reflétant
certes la réalité chinoise d'une nouvelle classe moyenne fortement mobile, mais «sacrifiant» la base
historique ouvrière et agricole, un mouvement qualifié par nombre d'observateurs de mutation en «parti
élitiste».
L'entrée à l'OMC : levier stratégique régional
La Chine semblait bien en pleine évolution, portée par une volonté féroce d'intégration dans le système
international, dont son accession à l'OMC représente une....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓