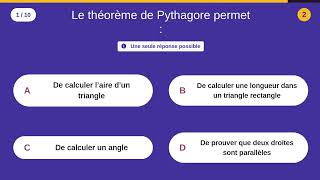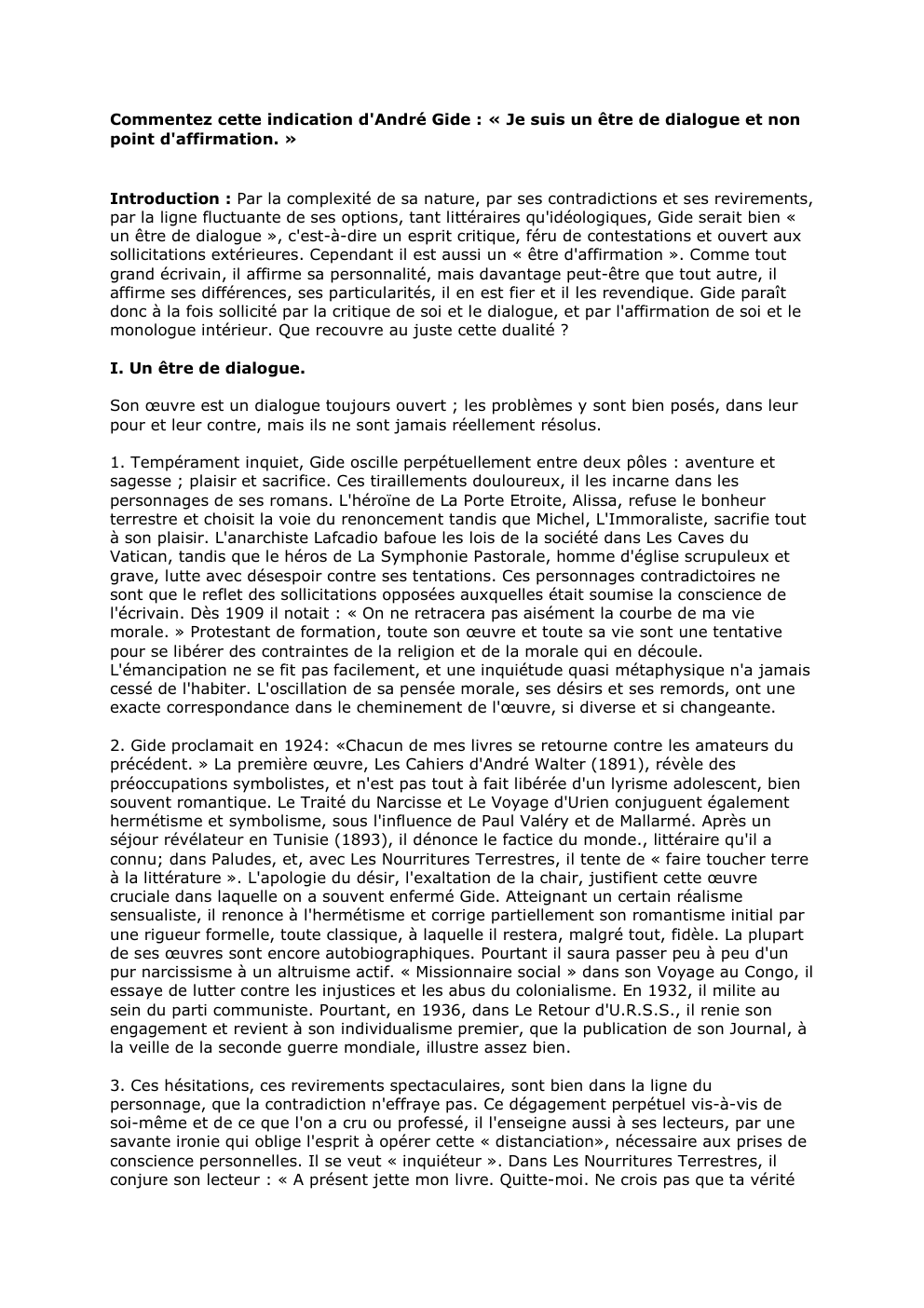Commentez cette indication d'André Gide : « Je suis un être de dialogue et non point d'affirmation. » Introduction :...
Extrait du document
«
Commentez cette indication d'André Gide : « Je suis un être de dialogue et non
point d'affirmation.
»
Introduction : Par la complexité de sa nature, par ses contradictions et ses revirements,
par la ligne fluctuante de ses options, tant littéraires qu'idéologiques, Gide serait bien «
un être de dialogue », c'est-à-dire un esprit critique, féru de contestations et ouvert aux
sollicitations extérieures.
Cependant il est aussi un « être d'affirmation ».
Comme tout
grand écrivain, il affirme sa personnalité, mais davantage peut-être que tout autre, il
affirme ses différences, ses particularités, il en est fier et il les revendique.
Gide paraît
donc à la fois sollicité par la critique de soi et le dialogue, et par l'affirmation de soi et le
monologue intérieur.
Que recouvre au juste cette dualité ?
I.
Un être de dialogue.
Son œuvre est un dialogue toujours ouvert ; les problèmes y sont bien posés, dans leur
pour et leur contre, mais ils ne sont jamais réellement résolus.
1.
Tempérament inquiet, Gide oscille perpétuellement entre deux pôles : aventure et
sagesse ; plaisir et sacrifice.
Ces tiraillements douloureux, il les incarne dans les
personnages de ses romans.
L'héroïne de La Porte Etroite, Alissa, refuse le bonheur
terrestre et choisit la voie du renoncement tandis que Michel, L'Immoraliste, sacrifie tout
à son plaisir.
L'anarchiste Lafcadio bafoue les lois de la société dans Les Caves du
Vatican, tandis que le héros de La Symphonie Pastorale, homme d'église scrupuleux et
grave, lutte avec désespoir contre ses tentations.
Ces personnages contradictoires ne
sont que le reflet des sollicitations opposées auxquelles était soumise la conscience de
l'écrivain.
Dès 1909 il notait : « On ne retracera pas aisément la courbe de ma vie
morale.
» Protestant de formation, toute son œuvre et toute sa vie sont une tentative
pour se libérer des contraintes de la religion et de la morale qui en découle.
L'émancipation ne se fit pas facilement, et une inquiétude quasi métaphysique n'a jamais
cessé de l'habiter.
L'oscillation de sa pensée morale, ses désirs et ses remords, ont une
exacte correspondance dans le cheminement de l'œuvre, si diverse et si changeante.
2.
Gide proclamait en 1924: «Chacun de mes livres se retourne contre les amateurs du
précédent.
» La première œuvre, Les Cahiers d'André Walter (1891), révèle des
préoccupations symbolistes, et n'est pas tout à fait libérée d'un lyrisme adolescent, bien
souvent romantique.
Le Traité du Narcisse et Le Voyage d'Urien conjuguent également
hermétisme et symbolisme, sous l'influence de Paul Valéry et de Mallarmé.
Après un
séjour révélateur en Tunisie (1893), il dénonce le factice du monde., littéraire qu'il a
connu; dans Paludes, et, avec Les Nourritures Terrestres, il tente de « faire toucher terre
à la littérature ».
L'apologie du désir, l'exaltation de la chair, justifient cette œuvre
cruciale dans laquelle on a souvent enfermé Gide.
Atteignant un certain réalisme
sensualiste, il renonce à l'hermétisme et corrige partiellement son romantisme initial par
une rigueur formelle, toute classique, à laquelle il restera, malgré tout, fidèle.
La plupart
de ses œuvres sont encore autobiographiques.
Pourtant il saura passer peu à peu d'un
pur narcissisme à un altruisme actif.
« Missionnaire social » dans son Voyage au Congo, il
essaye de lutter contre les injustices et les abus du colonialisme.
En 1932, il milite au
sein du parti communiste.
Pourtant, en 1936, dans Le Retour d'U.R.S.S., il renie son
engagement et revient à son individualisme premier, que la publication de son Journal, à
la veille de la seconde guerre mondiale, illustre assez bien.
3.
Ces hésitations, ces revirements spectaculaires, sont bien dans la ligne du
personnage, que la contradiction n'effraye pas.
Ce dégagement perpétuel vis-à-vis de
soi-même et de ce que l'on a cru ou professé, il l'enseigne aussi à ses lecteurs, par une
savante ironie qui oblige l'esprit à opérer cette « distanciation», nécessaire aux prises de
conscience personnelles.
Il se veut « inquiéteur ».
Dans Les Nourritures Terrestres, il
conjure son lecteur : « A présent jette mon livre.
Quitte-moi.
Ne crois pas que ta vérité
puisse être trouvée par quelqu'un d'autre.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓