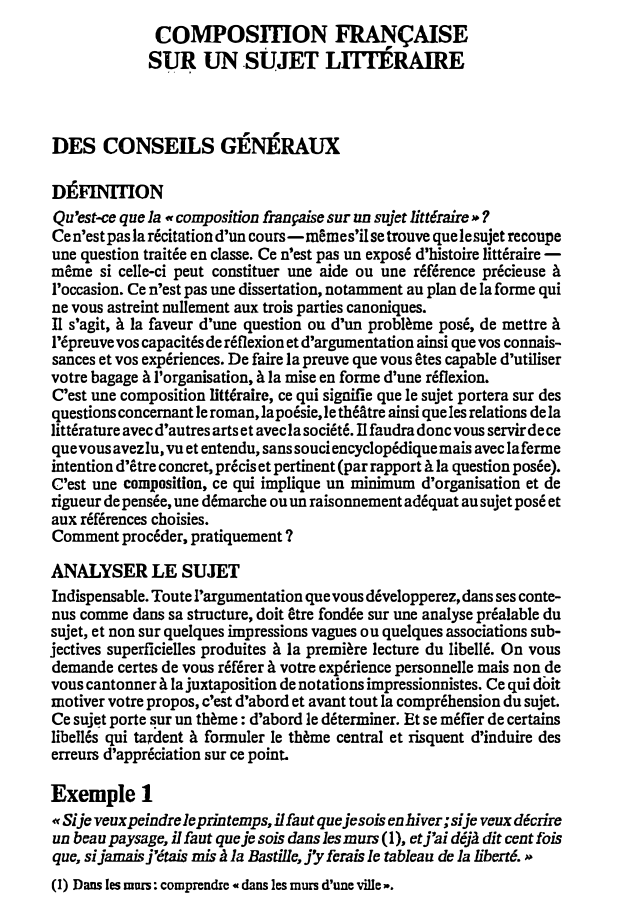COMPOSIDON FRANÇAISE SUR UN SUJET LI'ITÉRAIRE DES CONSEILS GÉNÉRAUX DÉFINITION Qu'est-ce que la « composition française sur nn sujet littéraire»?...
Extrait du document
«
COMPOSIDON FRANÇAISE
SUR UN SUJET LI'ITÉRAIRE
DES CONSEILS GÉNÉRAUX
DÉFINITION
Qu'est-ce que la « composition française sur nn sujet littéraire»?
Ce n'est pas la récitation d'un cours-mêmes'ilse trouve que le sujet recoupe
une question traitée en classe.
Ce n'est pas un exposé d'histoire littéraire même si celle-ci peut constituer une aide ou une référence précieuse à
l'occasion.
Ce n'est pas une dissertation, notamment au plan de la forme qui
ne vous astreint nullement aux trois parties canoniques.
II s'agit, à la faveur d'une question ou d'un problème posé, de mettre à
l'épreuve vos capacités de réflexion et d'argumentation ainsi que vos connais
sances et vos expériences.
De faire la preuve que vous êtes capable d'utiliser
votre bagage à l'organisation, à la mise en forme d'une réflexion.
C'est une composition littéraire, ce qui signifie que le sujet portera sur des
questions concernant le roman,Ia poésie, le théâtre ainsi que les relations de la
littérature avec d'autres arts et avec la société.
Il faudra donc vous servir de ce
que vous avez lu, vu et entendu, sans souci encyclopédique mais avec la ferme
intention d'être concret, précis et pertinent (par rapport à la question posée).
C'est une composition, ce qui implique un minimum d'organisation et de
rigueur de pensée, une démarche ou un raisonnement adéquat au sujet posé et
aux références choisies.
Comment procéder, pratiquement?
ANALYSER LE SUJET
Indispensable.
Toute l'argumentation que vous développerez, dans ses conte
nus comme dans sa structure, doit être fondée sur une analyse préalable du
sujet, et non sur quelques impressions vagues ou quelques associations sub
jectives superficielles produites à la première lecture du libellé.
On vous
demande certes de vous référer à votre expérience personnelle mais non de
vous cantonner à la juxtaposition de notations impressionnistes.
Ce qui doit
motiver votre propos, c'est d'abord et avant tout la compréhension du sujet.
Ce sujet porte �ur un thème : d'abord le déterminer.
Et se méfier de certains
libellés qui tardent à formuler le thème central et risquent d'induire des
erreurs d'appréciation sur ce point.
Exemplet
« Sijeveuxpeindre Jeprintemps, ilfaut queje sois enhiver; sije veux décrire
un beau paysage, il faut queje sois dans les murs (1 ), et j'ai déjà dit cent fois
que, sijamais j'étais mis à Ja Bastille, j'y ferais Je tableau de la liberté.
»
(1) Dans les murs: comprendre 41 dans les murs d'une villei-.
Que pensez-vous de cette opinion de J.-J.
Rousseau sur l'inspiration?.
La question posée centre le sujet sur l'inspiration, terme non utilisé par
Rousseau dans la citation.
II faut donc comprendre la phrase de Rousseau en
fonction de ce thème (et ne pas se lancer, par exemple, dans de grands
développements sur la liberté) et bien voir qu'elle exprime un point de vue
particulier auquel on pourra opposer d'autres points de vue (penser aux
écrivains qui ont besoin, au contraire, du contact direct avec leur sujet).
Exemple2
Montesquieu (1689-1755) confie dans ses Cahiers:
« L'étude a été pour moi le souverain remède contre les dégoûts, n'ayant
jamais eu le chagrin qu'une heure de lecture ne m'ait ôté.
»
Qu'en pensez-vous? Quel rôle assignez-vous vous-même à la lecture dans
votre vie d'adolescent d'aujourd'hui (divertissement, enrichissement intellec
tuel, moral, connaissance de l'homme et de son destin, connaissance des
hommes, appel à l'imaginaire ..•)?
Deux questions se succèdent.
L'une porte sur ce que vous pouvez penser de la
phrase de Montesquieu, l'autre fait appel plus directement à votre expérience.
La seconde recentre d'ailleurs le sujet sur la seule lecture (alors que
Montesquieu évoque également l'étude: mais ceci offre éventuellement la
possibilité de distinguer deux types de lecture, l'une, «désintéressée•• de
divertissement, l'autre d'étude, quitte à ce qu'elles se rejoignent en quelque
aspect).
L'énumération des rôles de la lecture est indicative.
II serait maladroit
d'en faire la base d'un« plan-catalogue•• toujours à éviter.
Exemple3
Léon Schwartzenberg, professeur de médecine, a écrit :
« Un pays dans lequel n'existe plus, le soir, une·chambre dans laquelle un
enfant apprend le grec ou le violon, est unpays perdu.
»
Dites comment vous comprenez cette aff!fDlation, et ce que vous en pensez.
Dans ce qu'on vous demande de faire, une démarche est indiquée: dire
comment vous comprenez la phrase de Schwartzenberg, puis exposer votre
avis.
Ce dernier sera donc fonction de ce que vous avez compris de la citation.
Aucun thème n'est vraiment précisé, c'est à vous de le définir sur la base de la
phrase proposée.
II n'est pas interdit, d'ailleurs, de proposer plusieurs façons
de comprendre cette phrase.
Tirer parti des informations données.
Un profes
seur de médecine, science« utile • s'il en est, vante les mérites du grec (langue
morte: il s'agit évidemment du grec ancien) et du violon (instrument de
musique difficile dont l'étude est souvent désintéressée; par ailleurs la musi
que est un art« inutile•).
Mais il fait plus : il met en relation l'étude du grec et
du violon avec la vie même d'un pays, il fait.dépendre celle-ci de ceux-là.
II
faudra donc maintenir les termes de cette relation pour l'interroger: le grec et
le violon sont des activités inutiles (préciser alors sur quel plan) et nécessaires
il lit, le propre lecteur de soi-même.
L'ouvrage de }'écrivain n'est qu'une
espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur aFm de lui permettre de
discerner cè que, sans ce livre, il n'eût pas vu en soi-même.
»
Au cœur du sujet, cette phrase centrale:« Chaque lecteur est le propre lecteur
de soi-même.
» Dans le sens de cette idée de Proust, on....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓