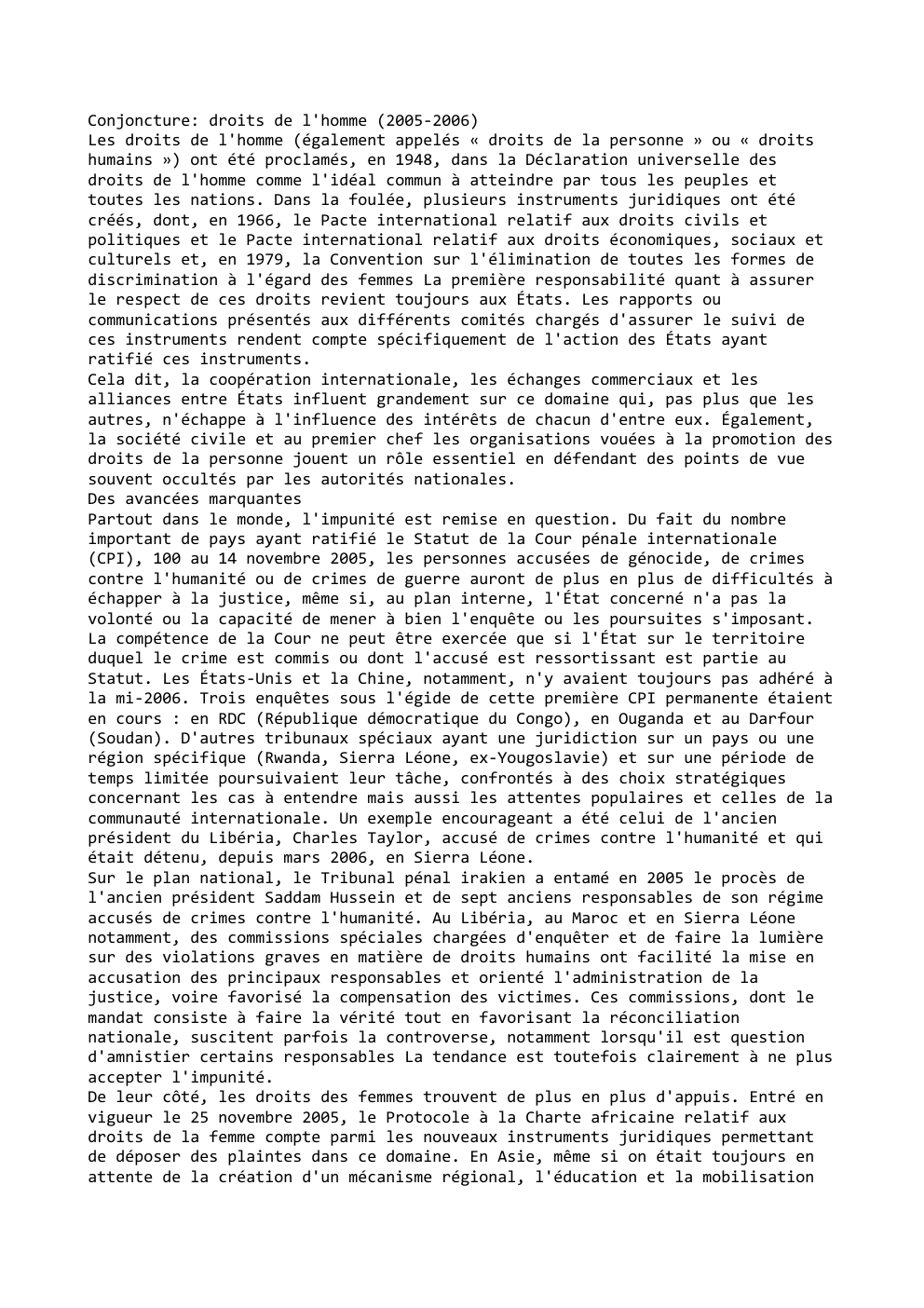Conjoncture: droits de l'homme (2005-2006) Les droits de l'homme (également appelés « droits de la personne » ou « droits...
Extrait du document
«
Conjoncture: droits de l'homme (2005-2006)
Les droits de l'homme (également appelés « droits de la personne » ou « droits
humains ») ont été proclamés, en 1948, dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et
toutes les nations.
Dans la foulée, plusieurs instruments juridiques ont été
créés, dont, en 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels et, en 1979, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes La première responsabilité quant à assurer
le respect de ces droits revient toujours aux États.
Les rapports ou
communications présentés aux différents comités chargés d'assurer le suivi de
ces instruments rendent compte spécifiquement de l'action des États ayant
ratifié ces instruments.
Cela dit, la coopération internationale, les échanges commerciaux et les
alliances entre États influent grandement sur ce domaine qui, pas plus que les
autres, n'échappe à l'influence des intérêts de chacun d'entre eux.
Également,
la société civile et au premier chef les organisations vouées à la promotion des
droits de la personne jouent un rôle essentiel en défendant des points de vue
souvent occultés par les autorités nationales.
Des avancées marquantes
Partout dans le monde, l'impunité est remise en question.
Du fait du nombre
important de pays ayant ratifié le Statut de la Cour pénale internationale
(CPI), 100 au 14 novembre 2005, les personnes accusées de génocide, de crimes
contre l'humanité ou de crimes de guerre auront de plus en plus de difficultés à
échapper à la justice, même si, au plan interne, l'État concerné n'a pas la
volonté ou la capacité de mener à bien l'enquête ou les poursuites s'imposant.
La compétence de la Cour ne peut être exercée que si l'État sur le territoire
duquel le crime est commis ou dont l'accusé est ressortissant est partie au
Statut.
Les États-Unis et la Chine, notamment, n'y avaient toujours pas adhéré à
la mi-2006.
Trois enquêtes sous l'égide de cette première CPI permanente étaient
en cours : en RDC (République démocratique du Congo), en Ouganda et au Darfour
(Soudan).
D'autres tribunaux spéciaux ayant une juridiction sur un pays ou une
région spécifique (Rwanda, Sierra Léone, ex-Yougoslavie) et sur une période de
temps limitée poursuivaient leur tâche, confrontés à des choix stratégiques
concernant les cas à entendre mais aussi les attentes populaires et celles de la
communauté internationale.
Un exemple encourageant a été celui de l'ancien
président du Libéria, Charles Taylor, accusé de crimes contre l'humanité et qui
était détenu, depuis mars 2006, en Sierra Léone.
Sur le plan national, le Tribunal pénal irakien a entamé en 2005 le procès de
l'ancien président Saddam Hussein et de sept anciens responsables de son régime
accusés de crimes contre l'humanité.
Au Libéria, au Maroc et en Sierra Léone
notamment, des commissions spéciales chargées d'enquêter et de faire la lumière
sur des violations graves en matière de droits humains ont facilité la mise en
accusation des principaux responsables et orienté l'administration de la
justice, voire favorisé la compensation des victimes.
Ces commissions, dont le
mandat consiste à faire la vérité tout en favorisant la réconciliation
nationale, suscitent parfois la controverse, notamment lorsqu'il est question
d'amnistier certains responsables La tendance est toutefois clairement à ne plus
accepter l'impunité.
De leur côté, les droits des femmes trouvent de plus en plus d'appuis.
Entré en
vigueur le 25 novembre 2005, le Protocole à la Charte africaine relatif aux
droits de la femme compte parmi les nouveaux instruments juridiques permettant
de déposer des plaintes dans ce domaine.
En Asie, même si on était toujours en
attente de la création d'un mécanisme régional, l'éducation et la mobilisation
se poursuivent et la situation des femmes et des enfants est de mieux en mieux
comprise.
En 2000, les femmes représentaient 16,3 % des législateurs dans les
parlements du monde (contre 11,3 % en 1995).
Les programmes de coopération
internationale ont adopté une approche sexo-spécifique, qui s'appuie sur les
droits des femmes et favorise leur participation aux actions de développement.
Sociologues, anthropologues et militants des droits humains remettent en
question la notion de culture comme barrière à la dignité des femmes, préférant
l'intégrer, à titre contextuel, comme un champ de possibilités d'actions
dynamiques.
Cela étant, les conflits armés, les fondamentalismes religieux et
certaines pratiques comme l'excision font toujours obstacle à l'affirmation de
ces droits.
Enfin, au sein des Nations unies, le nouveau Conseil des droits de l'homme, créé
en mars 2006, a remplacé la Commission des droits de l'homme discréditée par la
présence en son sein de pays aux régimes répressifs.
Composé de 47 États
membres, qui devront observer des normes plus strictes, il devrait s'attaquer de
façon plus objective aux violations des droits de la personne partout où elles
se produisent.
L'élection, en mai 2006, de certains pays dont la Chine, a été
vivement critiquée.
Il reste que, à titre de membres du nouveau Conseil des
droits de l'homme, ceux-ci devront ratifier les....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓