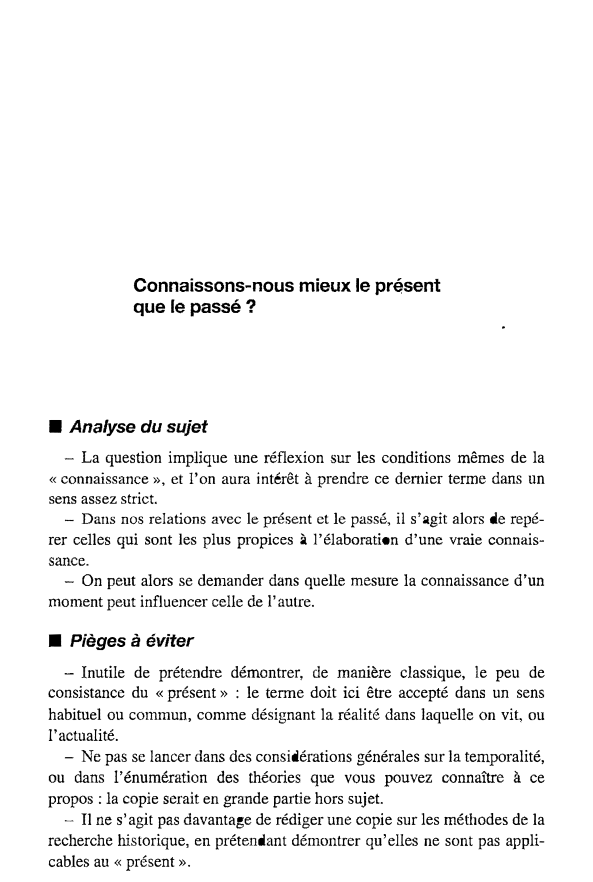Connaissons-nous mieux le présent que le passé ? ■ Analyse du sujet - La question implique une réflexion sur les...
Extrait du document
«
Connaissons-nous mieux le présent
que le passé ?
■ Analyse du sujet
- La question implique une réflexion sur les conditions mêmes de la
«connaissance», et l'on aura intérêt à prendre ce dernier terme dans un
sens assez strict.
- Dans nos relations avec le présent et le passé, il s'agit alors de repé
rer celles qui sont les plus propices à l'élaboration d'une vraie connais
sance.
- On peut alors se demander dans quelle mesure la connaissance d'un
moment peut influencer celle de l'autre.
■
Pièges à éviter
- Inutile de prétendre démontrer, de manière classique, le peu de
consistance du « présent » : le terme doit ici être accepté dans un sens
habituel ou commun, comme désignant la réalité dans laquelle on vit, ou
l'actualité.
- Ne pas se lancer dans des considérations générales sur la temporalité,
ou dans l'énumération des théories que vous pouvez connaître à ce
propos : la copie serait en grande partie hors sujet.
- Il ne s'agit pas davantage de rédiger une copie sur les méthodes de la
recherche historique, en prétendant démontrer qu'elles ne sont pas appli
cables au« présent».
SUJETS CORRIGÉS
CORRIGÉ
[Introduction]
Ne se privant pas des charmes évidents d'un jeu de mots, Paul Claudel
affirme que la « connaissance » implique une « co-naissance », et désigne
donc en priorité une « naissance avec» (le phénomène que l'on veut
connaître).
S'il est un moment avec lequel semble être dans cette situation de« co-naissance », c'est évidemment le présent: chacun de ses instants coïncide avec les miens, et je suis de la sorte « de mon temps», à la
fois en harmonie ou au même rythme que lui et investi par ce qui le caractérise.
Doit-on en déduire que je suis pour si peu capable de réellement le
connaître - dans un autre sens, il est vrai, que celui de Claudel ? Et, plus
particulièrement, connaissons-nous mieux ce présent auquel nous participons que le passé - dont la première caractéristique est de ne plus être là
où nous sommes ?
[I.
La relation au présent]
Commençons par caractériser notre relation au présent, la façon dont
nous y sommes en effet immergés.
Le présent s'offre, dans le quotidien,
sous l'aspect de ce qui nous entoure : ces rues, ces immeubles, ces automobiles, ces silhouettes que j'aperçois au cours de la moindre promenade,
avec leurs vêtements, leur allure, leurs occupations et préoccupations
diverses.
C'est aussi bien les informations que me fournit l' « actualité »,
par définition liée au présent lui-même, au monde tel qu'il est en cours,
puisqu'elle me parvient de manière ininterrompue, comme une sorte de
flux qui me donne des « nouvelles » innombrables et hétérogènes - d'un
accident de circulation, grave, semble-t-il, sur une autoroute lointaine, à
un conflit qui vient d'éclater entre deux États que j'aurai peut-être du mal
à situer sur une carte, en passant par la mort d'un écrivain célèbre (c'est
sans doute la première fois que de nombreuses personnes entendent prononcer son nom) ou les cours du jour à la Bourse.
Le présent, c'est encore la masse des conversations saisies en passant,
par bribes; le déversement de diverses catégories d'images - affiches
publicitaires, photographies de presse, émissions de télévision, éventuellement un film dans la soirée qui me donnent du monde une vision à
chaque fois partielle, éclatée; l'information que je retire, si j'en trouve le
temps, de la lecture des journaux, d'une biographie, d'un essai.
Le présent, c'est la multiplicité des événements survenus dans le monde, jour
après jour : impossibles à totaliser, trop rapides dans leur formulation
pour qu'on puisse les classer, se substituant indéfiniment les uns aux
autres.
C'est la vision rapide d'un paysage aperçu d'un train, le parcours
CORRIGÉS
que je dois effectuer malgré ma fatigue, les soucis familiaux, le travail en
cours ...
Un tel présent est plus ou mois extensible : il est possible de conserver
le souvenir de ce qu'on m'a dit il y a quelques jours, mais j'ai déjà oublié
les arguments échangés par les participants d'un débat télévisé la semaine
dernière.
Il est si riche en informations, et donc si complexe, que l'on doit
sans cesse y opérer des sélections sans doute arbitraires en fonction
d'intérêts particuliers, des besoins du moment.
Bergson fait ainsi remarquer qu'on n'est attentif qu'à ce qui peut être utile ou efficace; ainsi, des
parties entières du monde tel qu'il est au présent m'échappent.
[Il.
Conditions de la connaissance]
Comment prétendre connaître un tel présent.
J'en perçois des apparences ou des échos, mais cela suffit-il pour en élaborer une véritable
connaissance ?
Toute connaissance, même s'il ne s'agit pas ici de la considérer dans un
sens rigoureusement scientifique, implique une distance nécessaire entre
le sujet et l'objet.
Relativement au présent, ce recul me fait évidemment
défaut, en raison même de mon immersion dans son agitation plus ou
moins frénétique.
Mais connaître suppose aussi que l'on s'intéresse à ce
qu'il y a, dans un objet, d'universel.
Hegel l'a fortement souligné : un
objet à connaître n'est jamais considéré en lui-même, pour ses qualités
anecdotiques et singulières, mais en tant qu'il est représentatif des lois
générales auxquels il obéit ou qui le constituent : à travers la singularité,
c'est bien l'universel qui est visé.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓