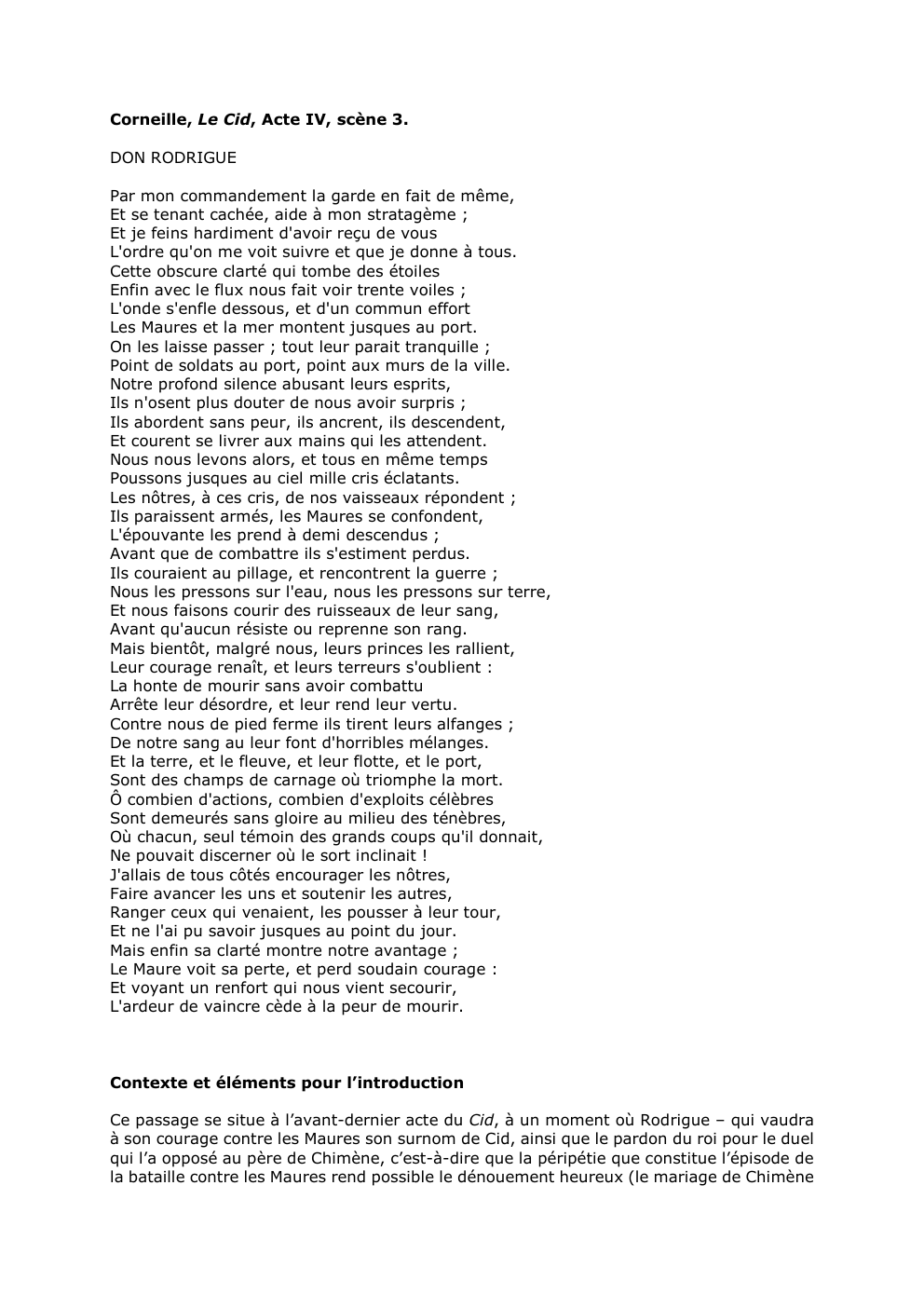Corneille, Le Cid, Acte IV, scène 3. DON RODRIGUE Par mon commandement la garde en fait de même, Et se...
Extrait du document
«
Corneille, Le Cid, Acte IV, scène 3.
DON RODRIGUE
Par mon commandement la garde en fait de même,
Et se tenant cachée, aide à mon stratagème ;
Et je feins hardiment d'avoir reçu de vous
L'ordre qu'on me voit suivre et que je donne à tous.
Cette obscure clarté qui tombe des étoiles
Enfin avec le flux nous fait voir trente voiles ;
L'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort
Les Maures et la mer montent jusques au port.
On les laisse passer ; tout leur parait tranquille ;
Point de soldats au port, point aux murs de la ville.
Notre profond silence abusant leurs esprits,
Ils n'osent plus douter de nous avoir surpris ;
Ils abordent sans peur, ils ancrent, ils descendent,
Et courent se livrer aux mains qui les attendent.
Nous nous levons alors, et tous en même temps
Poussons jusques au ciel mille cris éclatants.
Les nôtres, à ces cris, de nos vaisseaux répondent ;
Ils paraissent armés, les Maures se confondent,
L'épouvante les prend à demi descendus ;
Avant que de combattre ils s'estiment perdus.
Ils couraient au pillage, et rencontrent la guerre ;
Nous les pressons sur l'eau, nous les pressons sur terre,
Et nous faisons courir des ruisseaux de leur sang,
Avant qu'aucun résiste ou reprenne son rang.
Mais bientôt, malgré nous, leurs princes les rallient,
Leur courage renaît, et leurs terreurs s'oublient :
La honte de mourir sans avoir combattu
Arrête leur désordre, et leur rend leur vertu.
Contre nous de pied ferme ils tirent leurs alfanges ;
De notre sang au leur font d'horribles mélanges.
Et la terre, et le fleuve, et leur flotte, et le port,
Sont des champs de carnage où triomphe la mort.
Ô combien d'actions, combien d'exploits célèbres
Sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres,
Où chacun, seul témoin des grands coups qu'il donnait,
Ne pouvait discerner où le sort inclinait !
J'allais de tous côtés encourager les nôtres,
Faire avancer les uns et soutenir les autres,
Ranger ceux qui venaient, les pousser à leur tour,
Et ne l'ai pu savoir jusques au point du jour.
Mais enfin sa clarté montre notre avantage ;
Le Maure voit sa perte, et perd soudain courage :
Et voyant un renfort qui nous vient secourir,
L'ardeur de vaincre cède à la peur de mourir.
Contexte et éléments pour l’introduction
Ce passage se situe à l’avant-dernier acte du Cid, à un moment où Rodrigue – qui vaudra
à son courage contre les Maures son surnom de Cid, ainsi que le pardon du roi pour le duel
qui l’a opposé au père de Chimène, c’est-à-dire que la péripétie que constitue l’épisode de
la bataille contre les Maures rend possible le dénouement heureux (le mariage de Chimène
et de Rodrigue) de la pièce – raconte cette bataille contre les Maures qu’il vient de livrer
et durant laquelle il s’est montré héroïque.
Les règles de bienséance du théâtre classique
refusaient en effet que des faits d’armes soient représentés sur scène : l’auteur dramatique
doit donc, pour rendre compte de ces faits d’armes, recourir à l’astuce d’une narration
prise en charge par l’un des personnages de la pièce.
Ce respect des règles de la bienséance constitue une première clé de lecture possible du
texte : il faudra observer en effet comment Corneille, qui ne peut représenter réellement
une bataille sur la scène, parvient tout de même à représenter cette bataille par le biais
du langage ; il faudra donc étudier tous les procédés par lesquelles cette bataille est mise
en scène grâce au langage – et notamment le recours au style épique.
On pourra
remarquer que c’est ce récit épique de la bataille qui structure le texte, puisqu’on y
distingue deux parties, la première, jusqu’à « Et courent se livrer aux mains qui les
attendent.
», se rapportant au silence précédant la bataille et au piège tendu aux Maures,
la seconde, qui commence avec « Nous nous levons alors, et tous en même temps /
Poussons jusques au ciel mille cris éclatants » étant consacrée à une description très
évocatoire et vivante de la bataille.
Il faudra être particulièrement attentif à la force
poétique du langage de Corneille.
Une seconde piste de lecture peut consister à étudier la mise en scène qui est faite, par le
récit de cette bataille, du personnage même de Rodrigue, dont les états d’âme et les
dilemmes sont au centre de la progression de l’ensemble de l’œuvre : Rodrigue apparaît
ici, en effet, comme étant à la fois héroïque et modeste, puisqu’il noie toujours la
description de la bataille qu’il a dirigée et dont l’honneur public lui revient dans un « nous »
indéterminé.
On pourra, grâce à ces deux examens, mesurer la singularité du texte de Corneille, qui se
sert des règles de la bienséance pour rendre son texte encore plus évocatoire et qui
propose une exploration de l’âme complexe d’un de ses personnages principaux.
Eléments pour le développement
NB : les éléments donnés ici ne sont volontairement pas composés en plan abouti
pour un commentaire ; ils ne font que mettre en lumière les éléments à
commenter : il vous revient de hiérarchiser ces éléments en fonction de votre
propre lecture du texte.
I.
Un récit épique, qui respecte et dépasse à la fois les règles classiques de la
bienséance
- Remarquer tout d’abord le statut du texte : celui-ci constitue en effet le récit d’une
bataille, et inclut donc un passage au genre narratif dans un....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓