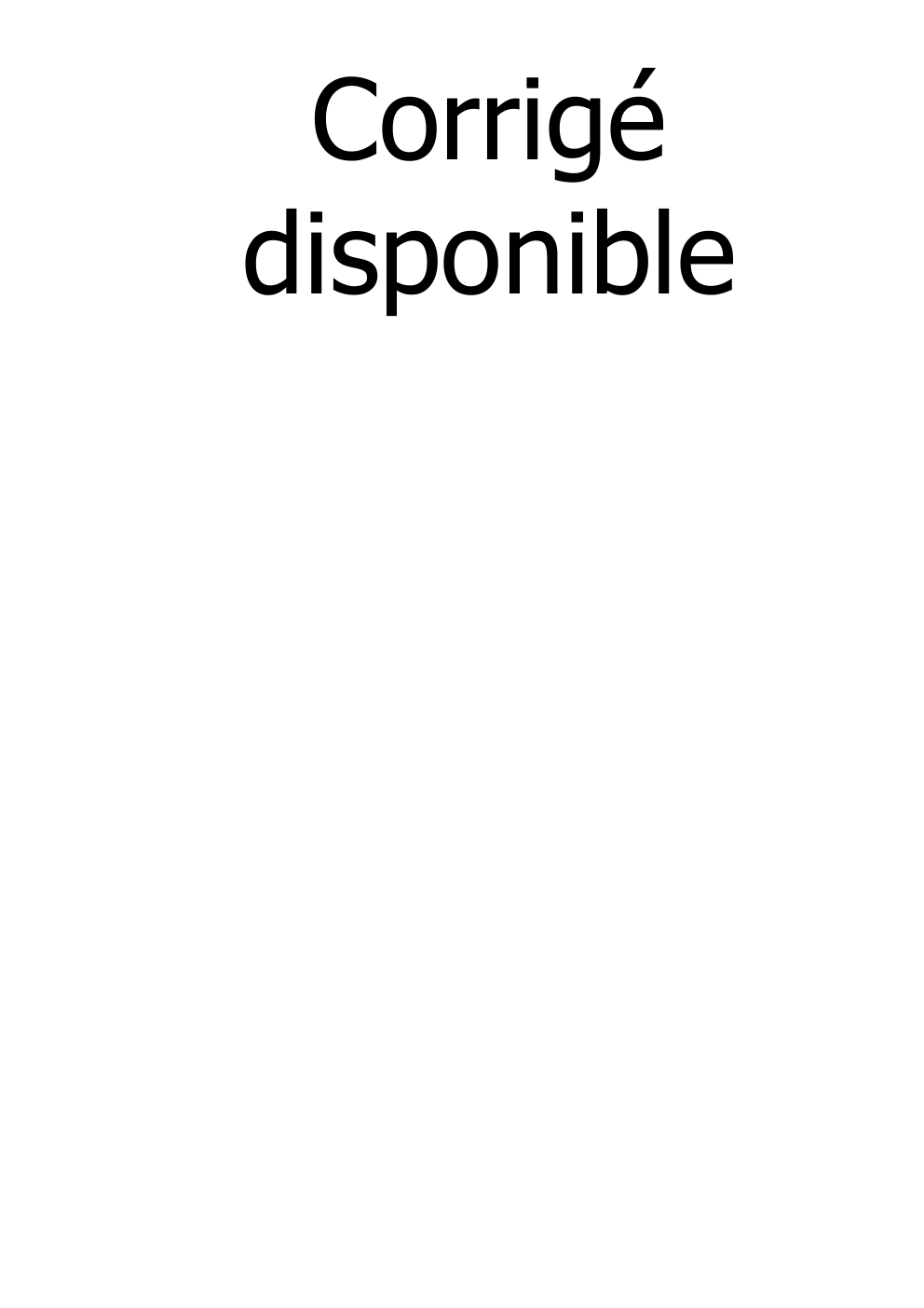Corrigé disponible La Fontaine introduit le livre I des Fables en s'adressant à monseigneur le Dauphin en ces termes :...
Extrait du document
«
Corrigé
disponible
La Fontaine introduit le livre I des Fables en s'adressant à monseigneur le Dauphin en ces
termes : « je ne doute point monseigneur, que vous ne regardiez favorablement des inventions si
utiles et tout ensemble si agréables ».
À partir de vos lectures personnelles vous discuterez de
l'articulation de ces deux aspects, plaire et instruire dans les genres de l'essai, du dialogue et de
l'apologue ?
Comment convaincre ? Quels sont les outils littéraires, les genres que l'auteur peut utiliser afin d'être le
plus persuasif possible ?
I- Les genres dédiés à l'argumentation
Traditionnellement, l'argumentation trouve son lieu d'expression dans les genres « sérieux » :
A- Le dialogue
Le dialogue => mettre en mots des notions abstraites ou morales ; faire dialoguer des personnages,
confrontations d'idées => l'auteur peut ainsi amener son lecteur à réfléchir et/ou à ce qu'il adhère à sa
propre thèse.
Multiplicités des thèmes abordés et notions (bien/mal, beau/laid...).
Dialoguer, c'est tenter
de convaincre, de persuader son interlocuteur (cf.
le dialogue chez Socrate) : cela est reproduit à l'écrit
par l'auteur.
Cf Entretien d'un père avec ses enfants (ex : question de respect du Serment d'Hippocrate : un criminel
mérite t-il d'être soigné ?) => Diderot apprécie le dialogue pour sa vivacité et les possibilités qu'il offre
de confronter des opinions différentes => aucun des personnages n'est censé représenter la pensée de
l'auteur à lui seul : c'est sa réflexion intégrale qui est illustrée.
B- La correspondance
Correspondance qui contient un discours.
Par la forme de la lettre, adressée ou pas, l'auteur donne son
idée, développe un sujet, une thèse.
Cf.
Les Provinciales de Pascal qui défendent le jansénisme ou Les
Lettres philosophiques de Voltaire : la lettre est un moyen d'exprimer haut et fort des positions
politiques, ses idées philosophiques.
Cf « Lettre sur le commerce » de Voltaire => éloge de la société anglaise qui travaille vs les Français et
les Anglais
C- L'essai
Le lieu privilégié de l'expression et du développement des idées abstraites => l'essai.
• Domaine : histoire, économie, politique, science, pédagogie...=> forme d'un article étoffé, d'un traité,
d'un livre d'histoire, de mémoires, d'une étude, d'une discussion philosophique, d'une lettre ouverte, d'un
pamphlet...
=>discours délibératif où l'auteur affiche souvent son point de vue
=> registre didactique puisqu'il propose un enseignement ou un partage de connaissances en un discours
structuré – plan rigoureux, thématique, analytique, logique sur un sujet précis.
∆) Le dialogue mais aussi la correspondance et surtout l'essai sont tout à fait appropriés à
l'expression de notions morales ou abstraites.
Toutefois, si ces genres de textes sont bien écrits et sont
porteurs d'idées, de messages et de réflexion, très souvent ils sont ardus à lire et à comprendre.
Or, pour
persuader le lecteur, il faut le toucher : lorsque le texte est trop complexe => le lecteur peut ne pas
comprendre ou ne pas faire attention au message => fait des « papillotes » avec le livre.
L'apologue est un genre argumentatif plus simple et peut-être tout autant efficace :
II- La fantaisie de l'apologue
A- des histoires simples
• Cf.
les Fables de La Fontaine => texte agréable à lire (VS un essai) ; importance du récit : véritables
petites scènes de genre, pittoresques et circonstanciées, le plus souvent teintées d'humour.
Jouant sur
l'alternance irrégulière de différents mètres (octosyllabes et alexandrins, par exemple), utilisant des
effets complexes de rythmes, d'assonances et de rimes, La Fontaine se sert de toutes les ressources de la
forme versifiée pour dynamiser le récit, lui donner l'allure naturelle d'un conte, à mi-chemin entre prose
et poésie.
Cf.
« Les Obsèques de la lionne » ; « Le singe et le léopard ».
B- Le dépaysement, l'amusement
• Zadig de Voltaire : histoire orientale, dépaysement du lecteur.
Voltaire situe l'action dans l'Orient
lointain, à une époque imaginaire et antique.
Exotisme qui rappelle les Mille et une nuits.
« Du temps
du roi Moabdard...
».
Structure traditionnelle du conte de Zadig.
• Candide : les personnages sont tous bons ou mauvais.
Jeux de mots sur les nom (Candide est naïf, M.
Vanderdendur, le méchant hollandais qui exploite le « nègre »...), facéties : les quartiers de noblesse...
Candide se promène à travers le monde, découvre un pays utopique, celui de l'Eldorado...
Voltaire décrit
le parcours d'un jeune homme naïf qui parcourt le monde, accompagné de Pangloss son mentor, un
philosophe pour qui « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ».
Dans Candide, nous sommes dans l'univers du conte, de l'histoire plaisante où le héros se fait
fesser en cadence et où ceux qui meurent peuvent revenir.
C- L'ironie
• L'ironie est l'art de dire le contraire de ce que l'on pense, de se moquer de quelqu'un ou de quelque
chose en vue de faire réagir un lecteur ou un interlocuteur.
De nombreux auteurs, dont Voltaire, ont eu
recourt à....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓