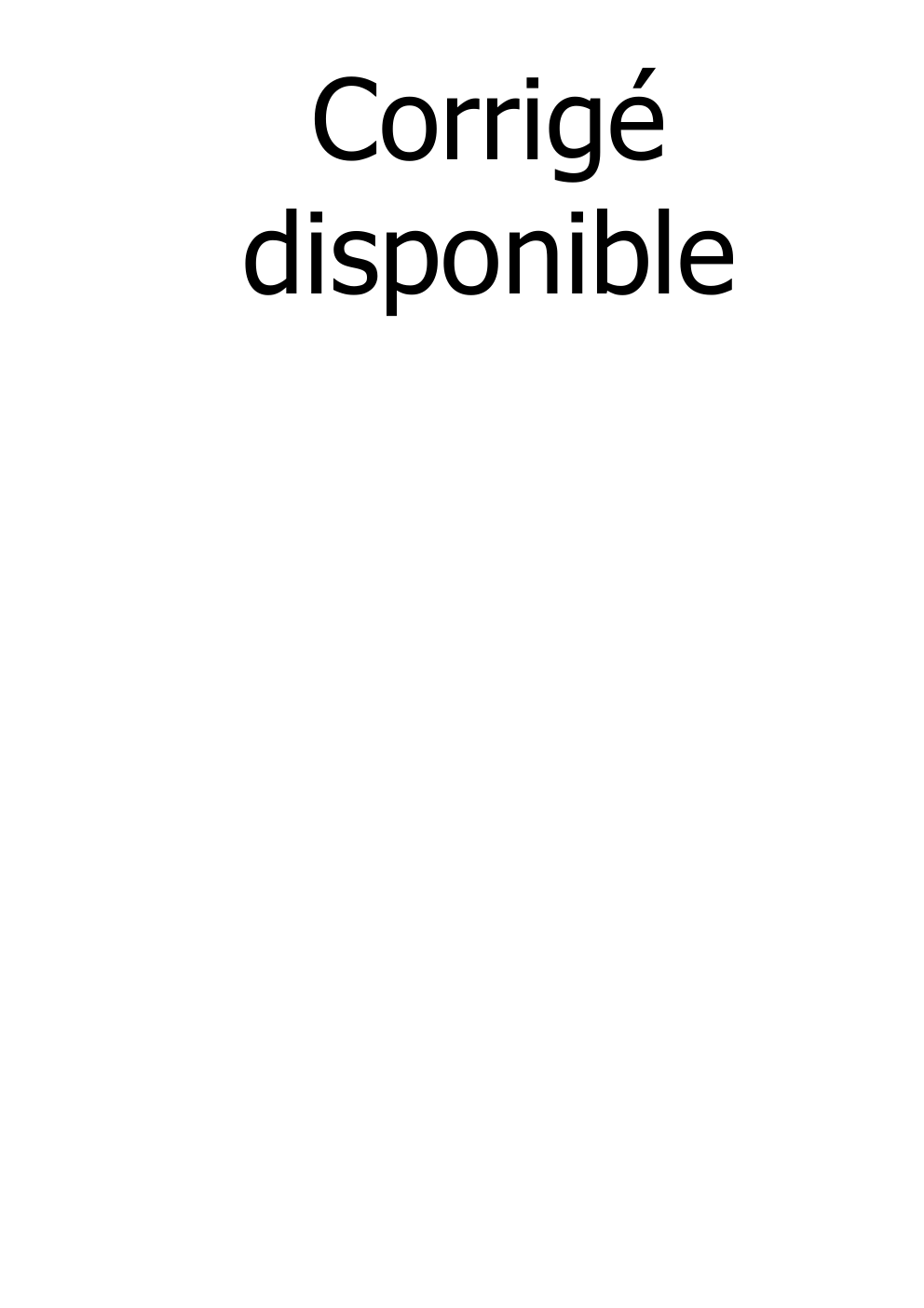Corrigé disponible Pourquoi le récit, la fable, l'apologue restent-ils si importants dans notre monde ? Qu'apportent ces textes ? Qu'apporte...
Extrait du document
«
Corrigé
disponible
Pourquoi le récit, la fable, l'apologue restent-ils si importants dans notre monde ?
Qu'apportent ces textes ? Qu'apporte la littérature a priori plus simple dans notre monde
moderne ?
Monde
moderne :
découvertes
scientifiques,
rationalisme,
réflexions,
précisons...
Rationalité scientifique / plaisir de la lecture et des mythes, légendes...
I- Le plaisir de la lecture
A- L'invitation au voyage
• Dans les légendes, on s'évade avec les héros.
Évasion => Cf.
la légende du roi Arthur.
Permet de rêver, de voir la vie sous un autre aspect.
Cf.
la boîte de Pandore.
• Mythe et légende : on rêve avec des héros.
Qualités et défauts des héros.
Cf.
Icare.
• Violence des sentiments, des passions (ex : violence de la passion d'Hermione...).
Violence physique : fin d'Andromaque (la folie et la mort).
Cf.
la jalousie de Phèdre :
Jalousie, passion déchirante.
Évoquer acte IV, scène 6 : ce sentiment extrême de la
jalousie lui donnes des idées de meurtres => Sentiment humain même s'il est exacerbé
(d'ailleurs, Racine écrivait aussi pour nous « purger » de nos mauvais sentiments).
• Valeurs fondamentales rappelées : Cf.
un mythe et une légende que vous développez
=> idée d'amitié, de trahison...
B- Quelques grandes « figures » mythologiques et légendairess
Ex : Prométhée =>Un héros apporte aux hommes le feu symbole du pouvoir divin, il est
puni.
• Peut permettre d'illustrer des théories...
Cf.
oedipe => tue son père et épouse sa mère
: l'inceste provoque des conséquences horribles.
Narcisse : Amoureux de sa propre image,
Narcisse en mourra.
• Robinson Crusoe de Defoe a beaucoup inspiré : au XIXe => la robinsonnade est un genre
très prolifique et chaque auteur aime à placer son ou ses héros dans une situation proche
de celle de leur ancêtre Robinson.
Ex : Le Robinson Suisse du pasteur Wyss, un Robinson
russe, une Robinsonnette par Granström, des Robinsons italiens par Emilio Salgari, une
École des Robinsons de Jules Verne etc.
+ oeuvres comprenant le nom de son acolyte,
comme c'est le cas dans le Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier => à
partir du modèle, les écrivains ont créé de nouvelles oeuvres.
Ex : pour Robinson, ils
écrivent des textes plus accessibles aux enfants (l'oeuvre de Defoe n'avait jamais été écrite
pour les petits => punition, solitude...).
∆) Rêve VS rationalité.
Le lecteur recherche dans la lecture un moment d'évasion,
de détente, un moment privilégié, hors du temps.
VS la rationalité scientifique.
Possibilités
de rêver.
NB : le lecteur peut imaginer, s'imaginer les personnages comme il l'entend, interpréter
un poème...
Liberté de l'imagination...
II- La littérature engagée : un art qui s'ancre dans la réalité
Depuis très longtemps, les écrivains utilisent leurs oeuvres à des fins « sociale »,
en intervenant et/ou dénonçant certains abus de la société dans leurs écrits.
Sartre :
« Nous ne voulons pas avoir honte d'écrire et nous n'avons pas envie de parler pour ne
rien dire.
(...) nous voulons que l'écrivain embrasse étroitement son époque ».
A- Les essayistes et les moralistes
Le lieu privilégié de l'expression et du développement des idées abstraites => l'essai.
• Domaine : histoire, économie, politique, science, pédagogie...=> forme d'un article
étoffé, d'un traité, d'un livre d'histoire, de mémoires, d'une étude, d'une discussion
philosophique, d'une lettre ouverte, d'un pamphlet...
=>discours délibératif où l'auteur
affiche souvent son point de vue
=> registre didactique puisqu'il propose un enseignement ou un partage de connaissances
en un discours structuré – plan rigoureux, thématique, analytique, logique sur un sujet
précis.
B- La littérature « miroir » de la société
Au XIXE siècle, le roman voulait être un miroir de la société => dénonciation des injustices
sociales.
• Prenez un exemple dans votre corpus, culture...
est développez-le.
Cf.
Hugo qui dénonce
la misère (Les Misérables) mais aussi la peine de mort (Claude Gueux ; Le Dernier jour
d'un condamné).
Cf.
naturalisme de Zola : montre toutes les corruptions, pauvreté,
mauvaises conditions de travail...
sous le Second Empire.
• Le Dernier jour d'un condamné : le narrateur est celui qui va se faire guillotiner => le
lecteur se sent proche de lui, compatit (et presque se met à sa place) => le lecteur sent
donc toute l'atrocité de la peine de mort – surtout à la fin puisque le récit s'arrête avec la
vit du condamné.
∆) Grande force de la fiction.
Le fait de passer par un personnage => le lecteur
s'identifie aux peines du personnage et prend conscience du message.
C- Le rire, vecteur des idéologies
• Certains auteurs ont utilisé la comédie comme anti-comédie : le comique, agressif ou
burlesque, cherche à détruire toutes les valeurs humaines pour montrer l'absurdité du
monde, tout en faisant éclater les catégories traditionnelles de la dramaturgie
(personnages, action, etc.)
• Alfred Jarry, Ubu roi, 1896 : ce personnage sanguinaire est étrangement annonciateur
des dictateurs du XXE siècle.
Ubu : évoquer son fameux « merdre », ses insultes, sa
grossièreté, sa méchanceté amusants mais très grinçants...
• Par ses comédies, Molière dénonce le ridicule d'une société.
Moraliste.
Castigat ridendo
mores.
=> se moque des avares Cf.
Harpagon (devenu un mythe), ses habits ridicules et son
désarroi lorsqu'il a perdu sa cassette : « Hélas ! mon pauvre argent, mon pauvre argent,
mon cher ami, on m'a privé de toi ! ».
=> critique des défauts des hommes et par exemple, l'aveuglement d'Orgon qui....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓