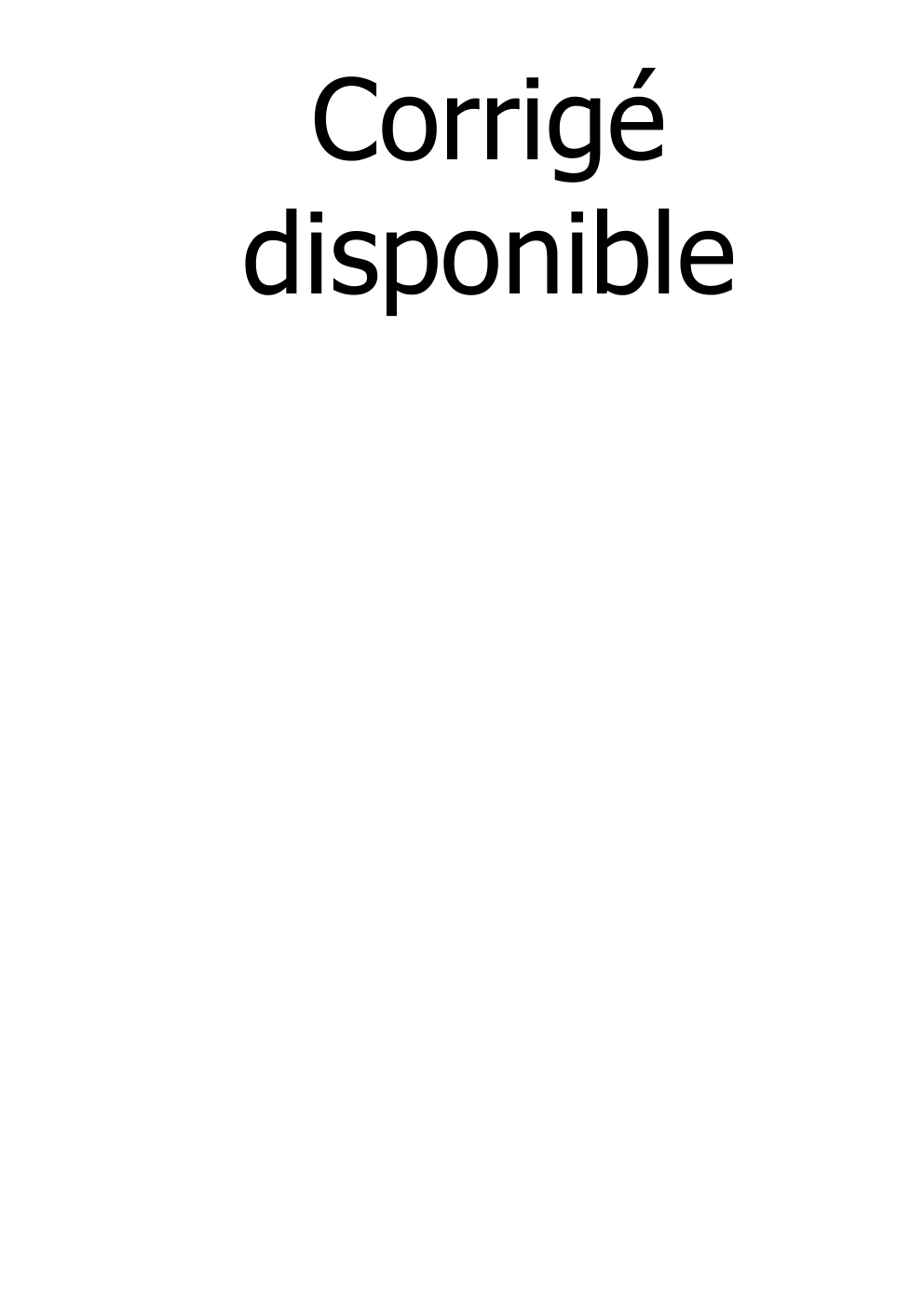Corrigé disponible Spécificités du texte poétique. I- Une poésie longtemps limitée au vers A- Définition • Du grec poeïen (fabriquer,...
Extrait du document
«
Corrigé
disponible
Spécificités du texte poétique.
I- Une poésie longtemps limitée au vers
A- Définition
• Du grec poeïen (fabriquer, produire), poésie=> art du langage « fabriqué » i.e différent,
rythmé => poésie vs prose.
• Le vers (latin versus, « le sillon, la ligne d'écriture », puis « le vers », historiquement «
ce qui retourne à la ligne »).
• Cf.
XVIe siècle : la Pléiade et règles précises (sonnet, alexandrin, rimes) ; XVIIE siècle :
Boileau et le respect des règles classiques.
∆) Pendant longtemps, poésie limitée à sa forme versifiée rigoureuse et codifiée : les règles
de versification, « tyrannie » du vers.
Est poétique ce qui est en vers.
B- Des règles très strictes
• Règles à respecter : les poètes les connaissaient => Évoquez et développez quelques
exemples en soulignant les contraintes ( ex => pas de hiatus ; valorisation de l'alexandrin
et des rimes riches ou suffisantes – alternance rime féminine, rime masculine...).
Cela
renforce aussi la beauté du poème.
• Certains poètes multiplient les contraintes existantes => Cf.
par exemple Hugo ou
Baudelaire qui écrivent des pantoums.
Ex : « Harmonie du soir » poème à forme fixe => suite de quatrains à rimes croisées ; le
2e et le 4e vers de chaque strophe forment le 1er et le 5e de la strophe suivante.
Le vers qui
ouvre la pièce la pièce doit la termine.
∆) la poésie => uniquement texte en vers.
Grande attention à la forme.
Mais progressivement, les poètes vont développer une nouvelle vision de la poésie.
C- Vers une poésie plus libre
• Le Parnasse, le symbolisme, le romantisme : respectent les règles de la poésie classique.
• Aloysius Bertrand publie Gaspard de la Nuit (1842) puis Baudelaire (Petits poèmes en
prose) et Rimbaud (Une saison en enfer) vont libérer la poésie de son « carcan » (NB :
Baudelaire et Rimbaud ont écrit des poésies qui riment et des poèmes à formes fixes).
• XXE siècle : surréalisme, dadaïsme => la forme poétique explose.
• Plus aucune règle n'est respectée.
On privilégie le fond, i.e la pensée du poète, son
message, à la forme : vers libre...
Ex : Eluard et Aragon => pas de ponctuation ; Antonin
Artaud => pas de rime (ex : L'Ombilic des Limbes).
• Mais, même si les règles ne sont pas respectées, les poètes font très attention à leur
texte.
Cf.
Apollinaire : calligrammes.
∆) Si les poètes délivrent leurs textes des contraintes classiques, il arrive qu'ils
recourent tout de même à l'alexandrin (=> volonté d'ancrer leur poème dans la poésie
traditionnelle, puisque ce vers est le vers noble de la poésie).
II- Un texte écrit qui mêle fond et forme
A- Les poèmes sont visibles
• Les poèmes sont des textes => sont écrits sur une feuille.
Visibles à l'oeil.
=> Esthétisme formé par des mots aux orthographes ressemblantes, acrostiches, cf.
certaines figures comme le chiasme, rimes pour l'oeil, beauté du texte de sa présentation
(sonnet, ballade...).
• Voire le texte permet de mieux le saisir.
R : si le texte de Leiris n'était qu'entendu, il perdrait peut-être du sens.
Voir le texte, sa
présentation en lexique aide.
• Voir le texte permet aussi de mieux voir les figures de styles => cf.
les anaphores dans
le texte de Michaux ou chez Aragon.
• Poème-dessin = calligramme.
=> Mise en page du texte poétique, comme celle des calligrammes d'Apollinaire : attire
l'oeil, et le fait se mouvoir selon un trajet plus ou moins imposé par le sens et le mouvement
de la phrase.
B- Les jeux de mots
• Refus des règles ordinaires de l'expression quotidienne.
Poète : jongleur avec les mots,
restitue les sensations et les objets (Ponge) en jouant sur les formes (poésie en vers libre
ou en prose).
• Paul Claudel, Cinq grandes Odes : « Les mots que j'emploie / Ce sont des mots de tous
les jours et ce ne sont point les mêmes ! »
• Dans son poème, Aragon joue avec les mots et les répétitions.
Ex : « Angoisse Adam-les-Passavant / Bors l'Aventure Avril-sur-Loire » ; « Adieu le lieudit l'lle-d'Elle / Adieu Lillebonne Ecublé » => répétitions des mots, mots très proches,
lettres qui reviennent => renforcées par les majuscules.
Proximités, jeux qui se voient.
R : tout un pan de la poésie moderne est faite de jeux avec le langage.
Le poème de
Desnos invente un « langage cuit » ; les paronomases de Max Jacob créent un univers
ludique où « Avenue du Maine / Les manèges déménagent ».
R : La poésie par ses jeux sur le langage peut apparaître comme une ornementation ou
un écart face au langage quotidien.
Le poète apparaît comme un technicien jouant gratuitement avec le langage.
C- Une nouvelle langue
• La poésie engage un usage....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓