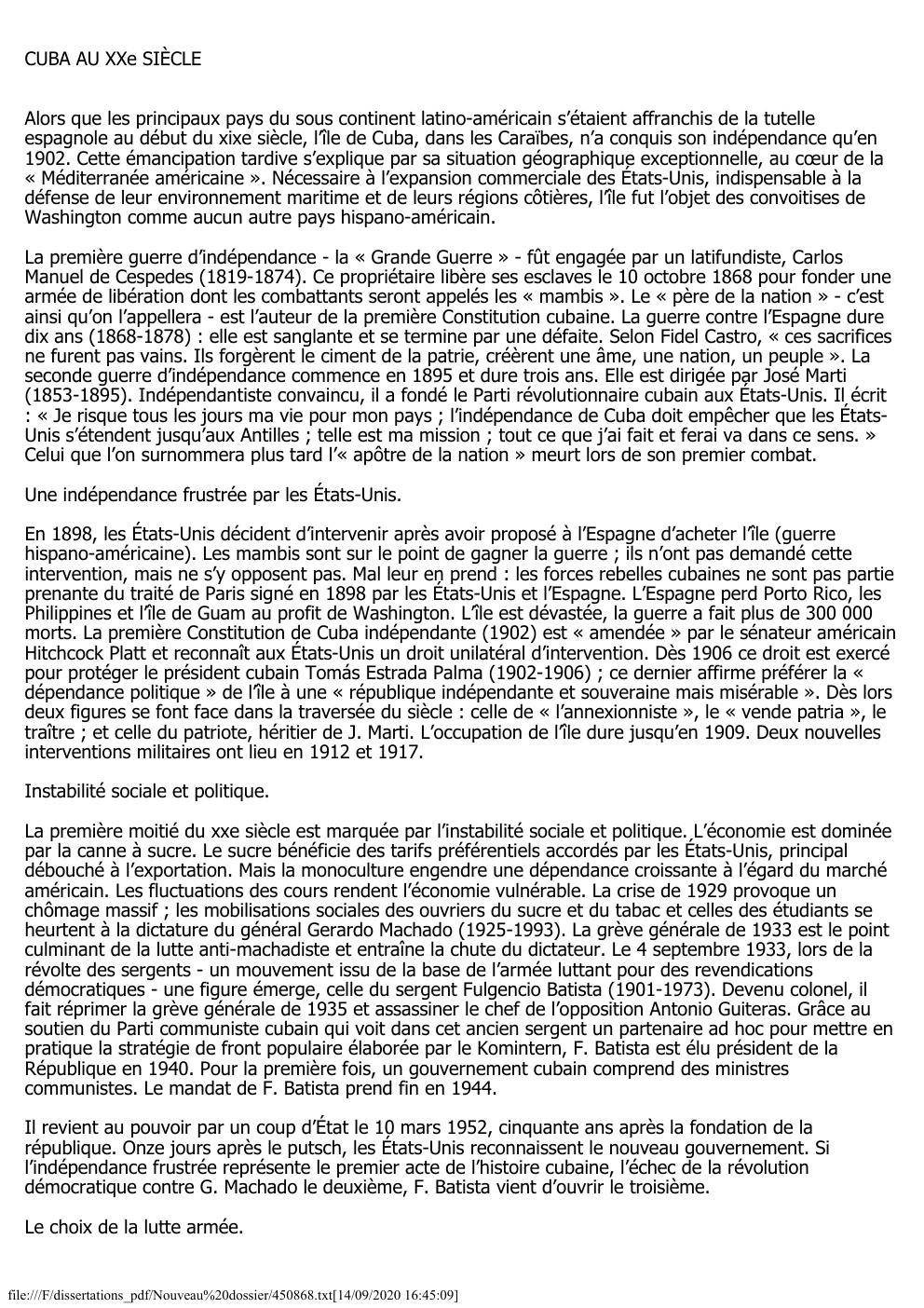CUBA AU XXe SIÈCLE Alors que les principaux pays du sous continent latino-américain s’étaient affranchis de la tutelle espagnole au...
Extrait du document
«
CUBA AU XXe SIÈCLE
Alors que les principaux pays du sous continent latino-américain s’étaient affranchis de la tutelle
espagnole au début du xixe siècle, l’île de Cuba, dans les Caraïbes, n’a conquis son indépendance qu’en
1902.
Cette émancipation tardive s’explique par sa situation géographique exceptionnelle, au cœur de la
« Méditerranée américaine ».
Nécessaire à l’expansion commerciale des États-Unis, indispensable à la
défense de leur environnement maritime et de leurs régions côtières, l’île fut l’objet des convoitises de
Washington comme aucun autre pays hispano-américain.
La première guerre d’indépendance - la « Grande Guerre » - fût engagée par un latifundiste, Carlos
Manuel de Cespedes (1819-1874).
Ce propriétaire libère ses esclaves le 10 octobre 1868 pour fonder une
armée de libération dont les combattants seront appelés les « mambis ».
Le « père de la nation » - c’est
ainsi qu’on l’appellera - est l’auteur de la première Constitution cubaine.
La guerre contre l’Espagne dure
dix ans (1868-1878) : elle est sanglante et se termine par une défaite.
Selon Fidel Castro, « ces sacrifices
ne furent pas vains.
Ils forgèrent le ciment de la patrie, créèrent une âme, une nation, un peuple ».
La
seconde guerre d’indépendance commence en 1895 et dure trois ans.
Elle est dirigée par José Marti
(1853-1895).
Indépendantiste convaincu, il a fondé le Parti révolutionnaire cubain aux États-Unis.
Il écrit
: « Je risque tous les jours ma vie pour mon pays ; l’indépendance de Cuba doit empêcher que les ÉtatsUnis s’étendent jusqu’aux Antilles ; telle est ma mission ; tout ce que j’ai fait et ferai va dans ce sens.
»
Celui que l’on surnommera plus tard l’« apôtre de la nation » meurt lors de son premier combat.
Une indépendance frustrée par les États-Unis.
En 1898, les États-Unis décident d’intervenir après avoir proposé à l’Espagne d’acheter l’île (guerre
hispano-américaine).
Les mambis sont sur le point de gagner la guerre ; ils n’ont pas demandé cette
intervention, mais ne s’y opposent pas.
Mal leur en prend : les forces rebelles cubaines ne sont pas partie
prenante du traité de Paris signé en 1898 par les États-Unis et l’Espagne.
L’Espagne perd Porto Rico, les
Philippines et l’île de Guam au profit de Washington.
L’île est dévastée, la guerre a fait plus de 300 000
morts.
La première Constitution de Cuba indépendante (1902) est « amendée » par le sénateur américain
Hitchcock Platt et reconnaît aux États-Unis un droit unilatéral d’intervention.
Dès 1906 ce droit est exercé
pour protéger le président cubain Tomás Estrada Palma (1902-1906) ; ce dernier affirme préférer la «
dépendance politique » de l’île à une « république indépendante et souveraine mais misérable ».
Dès lors
deux figures se font face dans la traversée du siècle : celle de « l’annexionniste », le « vende patria », le
traître ; et celle du patriote, héritier de J.
Marti.
L’occupation de l’île dure jusqu’en 1909.
Deux nouvelles
interventions militaires ont lieu en 1912 et 1917.
Instabilité sociale et politique.
La première moitié du xxe siècle est marquée par l’instabilité sociale et politique.
L’économie est dominée
par la canne à sucre.
Le sucre bénéficie des tarifs préférentiels accordés par les États-Unis, principal
débouché à l’exportation.
Mais la monoculture engendre une dépendance croissante à l’égard du marché
américain.
Les fluctuations des cours rendent l’économie vulnérable.
La crise de 1929 provoque un
chômage massif ; les mobilisations sociales des ouvriers du sucre et du tabac et celles des étudiants se
heurtent à la dictature du général Gerardo Machado (1925-1993).
La grève générale de 1933 est le point
culminant de la lutte anti-machadiste et entraîne la chute du dictateur.
Le 4 septembre 1933, lors de la
révolte des sergents - un mouvement issu de la base de l’armée luttant pour des revendications
démocratiques - une figure émerge, celle du sergent Fulgencio Batista (1901-1973).
Devenu colonel, il
fait réprimer la grève générale de 1935 et assassiner le chef de l’opposition Antonio Guiteras.
Grâce au
soutien du Parti communiste cubain qui voit dans cet ancien sergent un partenaire ad hoc pour mettre en
pratique la stratégie de front populaire élaborée par le Komintern, F.
Batista est élu président de la
République en 1940.
Pour la première fois, un gouvernement cubain comprend des ministres
communistes.
Le mandat de F.
Batista prend fin en 1944.
Il revient au pouvoir par un coup d’État le 10 mars 1952, cinquante ans après la fondation de la
république.
Onze jours après le putsch, les États-Unis reconnaissent le nouveau gouvernement.
Si
l’indépendance frustrée représente le premier acte de l’histoire cubaine, l’échec de la révolution
démocratique contre G.
Machado le deuxième, F.
Batista vient d’ouvrir le troisième.
Le choix de la lutte armée.
file:///F/dissertations_pdf/Nouveau%20dossier/450868.txt[14/09/2020 16:45:09]
Le coup de force ne rencontre aucune résistance.
Il faut attendre plus d’un an pour qu’un groupe de
jeunes gens regroupés autour de F.
Castro - un avocat membre du Parti orthodoxe - organise une
protestation armée contre le tyran, en attaquant la caserne de la Moncada à Santiago (province
d’Oriente) le 26 juillet 1953, dans l’espoir de renverser la dictature : il s’agit de l’acte fondateur du
Mouvement du 26 juillet.
Le Parti socialiste populaire (PSP, communiste) condamne très vivement les « aventuriers petits bourgeois
» qui ont participé à ce combat et ne les défend pas contre la répression.
Emprisonné, puis condamné à
l’exil, F.
Castro s’entraîne au Mexique à la guerre de guérilla.
Il y rencontre un jeune médecin argentin,
Ernesto Guevara, qui vient de vivre au Guatémala le renversement d’un gouvernement démocratique par
des militaires entraînés par Washington.
Comme F.
Castro, il est convaincu de la nécessité de la lutte
armée.
Commencée dans la Sierra Maestra en 1956, la guérilla dure à peine plus de deux ans.
Stimulés
par les succès de l’Armée rebelle dirigée par F.
Castro et E.
Che Guevara, des étudiants, des paysans, des
ouvriers se mobilisent dans la lutte contre le dictateur.
En janvier 1959, une grève générale
révolutionnaire paralyse le pays.
L’Armée rebelle prend le pouvoir....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓