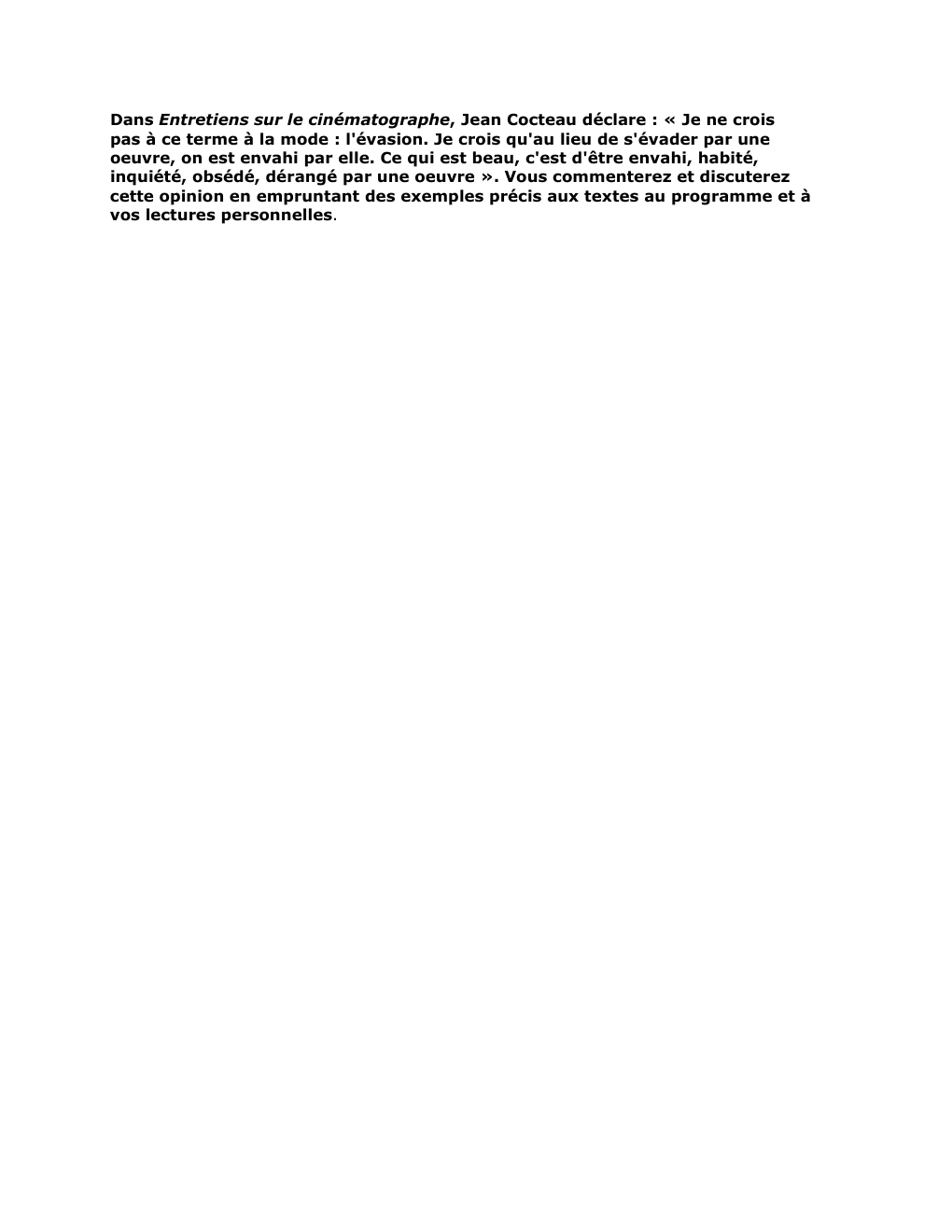Dans Entretiens sur le cinématographe, Jean Cocteau déclare : « Je ne crois pas à ce terme à la mode...
Extrait du document
«
Dans Entretiens sur le cinématographe, Jean Cocteau déclare : « Je ne crois
pas à ce terme à la mode : l'évasion.
Je crois qu'au lieu de s'évader par une
oeuvre, on est envahi par elle.
Ce qui est beau, c'est d'être envahi, habité,
inquiété, obsédé, dérangé par une oeuvre ».
Vous commenterez et discuterez
cette opinion en empruntant des exemples précis aux textes au programme et à
vos lectures personnelles.
Dans Entretiens sur le cinématographe, Jean Cocteau déclare : « Je ne crois
pas à ce terme à la mode : l'évasion.
Je crois qu'au lieu de s'évader par une
oeuvre, on est envahi par elle.
Ce qui est beau, c'est d'être envahi, habité,
inquiété, obsédé, dérangé par une œuvre ».
Vous commenterez et discuterez
cette opinion en empruntant des exemples précis aux textes au programme et à
vos lectures personnelles.
Normalement, il est vrai que l’on considère que la lecture d’une œuvre nous fait voyager.
Pourtant, le texte et les aventures peuvent nous toucher vraiment, nous déranger, nous
faire réfléchir…
I- Le plaisir de la lecture
A- L’évasion
• Roman, pièce de théâtre, poésie… => sont construits autour de personnages.
Si on
s’identifie au personnage : on entre plus facilement dans la fiction, on s’évade.
La
littérature fait oublier les soucis l’espace du temps de la lecture le réel.
• Cf.
les robinsonnades du XIXe siècle : Les Nouveaux Robinsons suisses et toute la vogue
des histoires qui se déroulent sur une île déserte loin de tout.
Exotisme.
• Longues description au XIXe qui font rêver les lecteurs.
À l’époque, pas de télévision : il
faut s’occuper.
On plonge ainsi dans le Paris de la Restauration avec Balzac.
• Identification importante dans les romans d’apprentissages > on grandit avec le héros,
on le suit, on suit son parcours.
Cf.
Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir.
Cf.
Frédéric dans
L’Éducation sentimentale.
B- Le travail de la forme
L’œuvre littéraire plait par sa forme.
• Beauté du texte => travail de la forme, du rythme, des sonorités.
Cf.
un poème
« Harmonie du Soir », « L’invitation au voyage » de Baudelaire, ou même un tragédie de
Racine > beauté du texte.
• Ne pas oublier le style du romancier.
Cf.
Flaubert qui rêvait d’écrire un livre « sur rien »
afin que les lecteurs prennent conscience du véritable travail d’écrivain qui se trouve
derrière la fiction.
Cf.
Chateaubriand qui introduit de la prose poétique.
Cf.
l’écriture de Zola, entre réalisme
et images, symboles (cf.
le Blanc dans Au Bonheur des dames…) + cf.
les belles phrases…
• Cf.
Flaubert => grande attention portée à la forme de ses phrases, à leurs sonorités, etc.
> soumettait tous ses textes à l’épreuve du « gueuloir »).
NB : certains auteurs, comme les Parnassiens, ont refusé d’utiliser leur plume à des fins
« utiles » => but de leurs œuvres : beauté du texte.
Ex : Théophile Gautier, « il n'y a de
vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid » (Préface de
Mademoiselle de Maupin).
C- Les plaisirs de la fiction : la peinture des personnages
• Véritables travail et talent de l’écrivain qui, finement, peint les consciences, les
contradictions, les conceptions, les idées de ses personnages => lecteur découvre la
pensée d’un père corse (Cf.
la Vendetta de Balzac), d’un Normand un peu avare (Cf.
La
Ficelle de Maupassant), d’une jeune femme qui découvre la vie (La Femme de trente ans,
Une vie, Madame Bovary…).
Grande précision dans la psychologie du personnage.
Cf.
le
portrait de Balzac de la Vieille fille ou de Grandet.
Cf.
les portraits de Julien Sorel (> vu
par Mme de Rênal, le narrateur, Mathilde…).
Découverte d’un monde différent, de
psychologies nouvelles…
∆) Le lecteur recherche dans la lecture un moment d’évasion, de détente...
Pourtant, il est vrai que l’œuvre peut nous toucher, nous provoquer…
II- Lorsque l’œuvre fait réagir
Une œuvre peut profondément toucher le lecteur > ne s’évade pas mais réfléchis,
repense…
A- Personnages déroutants et même déplaisants
• Personnages qui vont profondément nous mettre mal à l’aise, nous déplaire…
Ex : Le personnage de Bardamu dans Voyage au bout de la nuit > personnage négatif,
peureux, désagréable… Actions révoltantes.
Cf.
sa passivité quand la femme meurt devant
lui en perdant son sang.
Pourtant, il nous touche.
Il peut nous rappeler certains de nos
mauvais côtés… Personnage qui ne laisse pas indifférent et qui nous fait voir le monde
d’une manière différente, sous un angle assez sarcastique…
Ex : Meursault dans L'Étranger de Camus => semble étrange, en décalage.
Par exemple :
il tue « l’Arabe » sans savoir bien pourquoi, il menait avant cela une petite vie sans
beaucoup d’intérêt, il ne connaît pas de sentiments très très forts (la mort de sa mère
l’attriste peu…).
Ex : Roquentin dans La Nausée de Sartre => anti-héros, n’agit jamais de manière
exceptionnelle, aussi peu engageant que sa vie à Bouville…
B- La réaction
• Il arrive que l’œuvre fasse réagir vivement le lecteur.
Partialité du narrateur : à travers
son récit => on perçoit son état d’esprit, sa sensibilité.
Ex : on peut être révolté par la vision de Maupassant sur les femmes => très bon écrivain
mais extrêmement misogyne.
La femme est souvent soit une prostituée, soit une personne
perverse, une personne très intéressée cherchant à exploiter l’homme, soit alors une
« pondeuse » (le mot est de Maupassant… !).
Ex : Maupassant, Une famille : « C'était une
mère, enfin, une grosse mère banale, la pondeuse, la poulinière humaine, la machine de
chair qui procrée sans autre préoccupation dans l'âme que ses enfants et son livre de
cuisine ».
Cf.
la manière dont les personnages masculins parlent avec dégoût des femmes
enceintes.
Ex : dans Le Mont Oriol (mais il y a de nombreux autres exemples) la manière
dont l’amant de Christine se détourne d’elle une fois qu’elle est enceinte (il est le père de
l’enfant qu’elle porte…), elle le dégoûte.
Ex : les nouvelles où le narrateur parle avec mépris du mariage, des femmes mariées…
*....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓