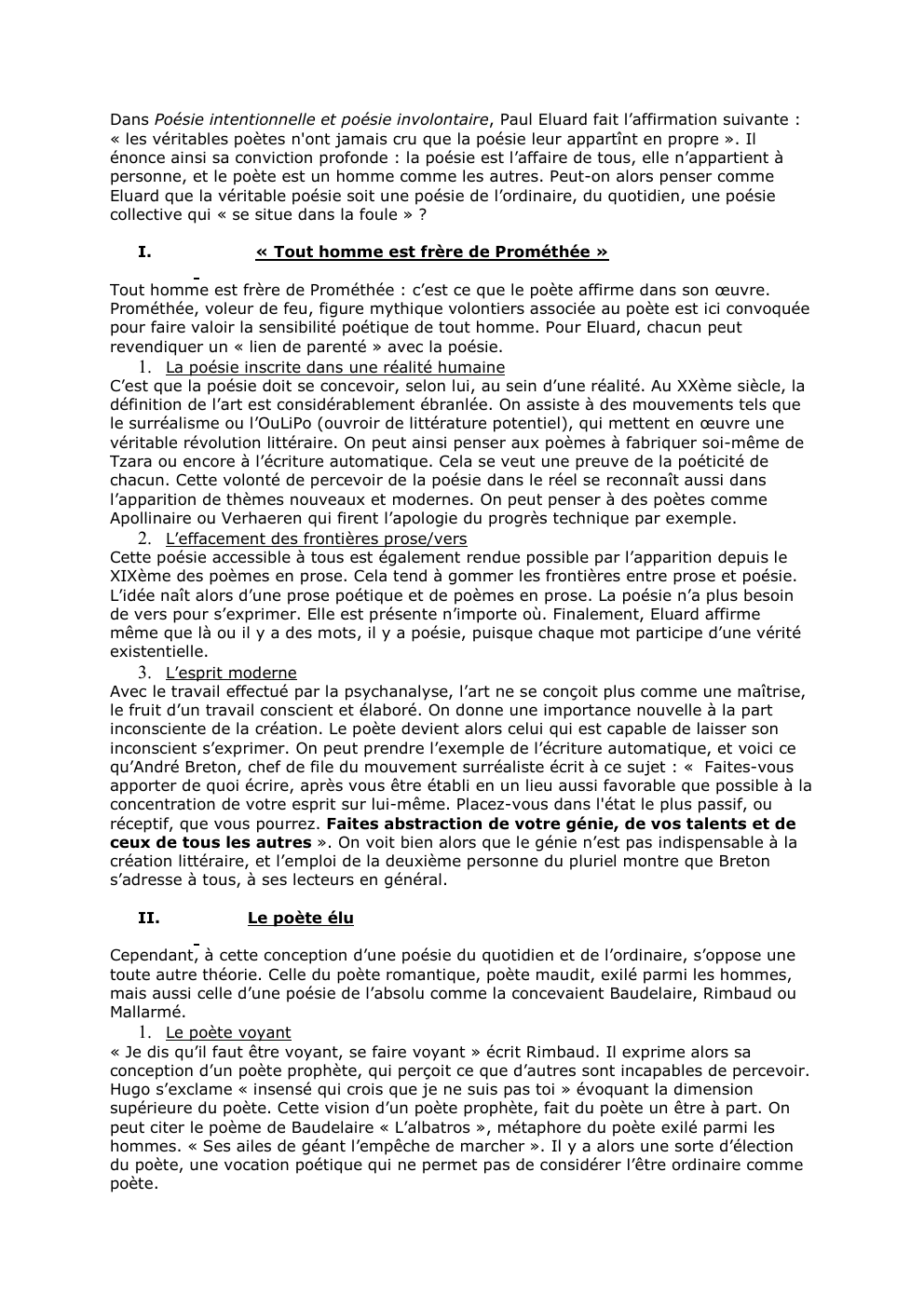Dans Poésie intentionnelle et poésie involontaire, Paul Eluard fait l’affirmation suivante : « les véritables poètes n'ont jamais cru que...
Extrait du document
«
Dans Poésie intentionnelle et poésie involontaire, Paul Eluard fait l’affirmation suivante :
« les véritables poètes n'ont jamais cru que la poésie leur appartînt en propre ».
Il
énonce ainsi sa conviction profonde : la poésie est l’affaire de tous, elle n’appartient à
personne, et le poète est un homme comme les autres.
Peut-on alors penser comme
Eluard que la véritable poésie soit une poésie de l’ordinaire, du quotidien, une poésie
collective qui « se situe dans la foule » ?
I.
« Tout homme est frère de Prométhée »
Tout homme est frère de Prométhée : c’est ce que le poète affirme dans son œuvre.
Prométhée, voleur de feu, figure mythique volontiers associée au poète est ici convoquée
pour faire valoir la sensibilité poétique de tout homme.
Pour Eluard, chacun peut
revendiquer un « lien de parenté » avec la poésie.
1.
La poésie inscrite dans une réalité humaine
C’est que la poésie doit se concevoir, selon lui, au sein d’une réalité.
Au XXème siècle, la
définition de l’art est considérablement ébranlée.
On assiste à des mouvements tels que
le surréalisme ou l’OuLiPo (ouvroir de littérature potentiel), qui mettent en œuvre une
véritable révolution littéraire.
On peut ainsi penser aux poèmes à fabriquer soi-même de
Tzara ou encore à l’écriture automatique.
Cela se veut une preuve de la poéticité de
chacun.
Cette volonté de percevoir de la poésie dans le réel se reconnaît aussi dans
l’apparition de thèmes nouveaux et modernes.
On peut penser à des poètes comme
Apollinaire ou Verhaeren qui firent l’apologie du progrès technique par exemple.
2.
L’effacement des frontières prose/vers
Cette poésie accessible à tous est également rendue possible par l’apparition depuis le
XIXème des poèmes en prose.
Cela tend à gommer les frontières entre prose et poésie.
L’idée naît alors d’une prose poétique et de poèmes en prose.
La poésie n’a plus besoin
de vers pour s’exprimer.
Elle est présente n’importe où.
Finalement, Eluard affirme
même que là ou il y a des mots, il y a poésie, puisque chaque mot participe d’une vérité
existentielle.
3.
L’esprit moderne
Avec le travail effectué par la psychanalyse, l’art ne se conçoit plus comme une maîtrise,
le fruit d’un travail conscient et élaboré.
On donne une importance nouvelle à la part
inconsciente de la création.
Le poète devient alors celui qui est capable de laisser son
inconscient s’exprimer.
On peut prendre l’exemple de l’écriture automatique, et voici ce
qu’André Breton, chef de file du mouvement surréaliste écrit à ce sujet : « Faites-vous
apporter de quoi écrire, après vous être établi en un lieu aussi favorable que possible à la
concentration de votre esprit sur lui-même.
Placez-vous dans l'état le plus passif, ou
réceptif, que vous pourrez.
Faites abstraction de votre génie, de vos talents et de
ceux de tous les autres ».
On voit bien alors que le génie n’est pas indispensable à la
création littéraire, et l’emploi de la deuxième personne du pluriel montre que Breton
s’adresse à tous, à ses lecteurs en général.
II.
Le poète élu
Cependant, à cette conception d’une poésie du quotidien et de l’ordinaire, s’oppose une
toute autre théorie.
Celle du poète romantique, poète maudit, exilé parmi les hommes,
mais aussi celle d’une poésie de l’absolu comme la concevaient Baudelaire, Rimbaud ou
Mallarmé.
1.
Le poète voyant
« Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant » écrit Rimbaud.
Il exprime alors sa
conception d’un poète prophète, qui perçoit ce que d’autres sont incapables de percevoir.
Hugo s’exclame « insensé qui crois que je ne suis pas toi » évoquant la dimension
supérieure du poète.
Cette vision d’un poète prophète, fait du poète un être à part.
On
peut citer le poème de Baudelaire « L’albatros », métaphore du poète exilé parmi les
hommes.
« Ses ailes de géant l’empêche de marcher ».
Il y a alors une sorte d’élection
du poète, une vocation poétique qui ne permet pas de considérer l’être ordinaire comme
poète.
2.
L’hermétisme poétique
D’autre part, ce qui conduit à réserver la poésie à une élite c’est notamment
l’hermétisme de certains poètes comme Mallarmé, ou plus tard Valery, Michaux, SaintJohn Perse…Ces poètes emploient une syntaxe ou un vocabulaire difficile à saisir pour les
non-spécialistes.
Cela conduit d’ailleurs cette poésie à n’être que peu lue et cela renforce
l’idée du poète exclu.
Dans un désir d’absolu, ces poètes « négligent » si l’on peut dire la
réception de l’œuvre.
Non seulement tout le monde ne peut pas être poète, mais tout le
monde ne peut pas lire la poésie.
On peut citer certains poèmes particulièrement obscurs
de Mallarmé comme le « Styx » (attention ne pas reprendre la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓