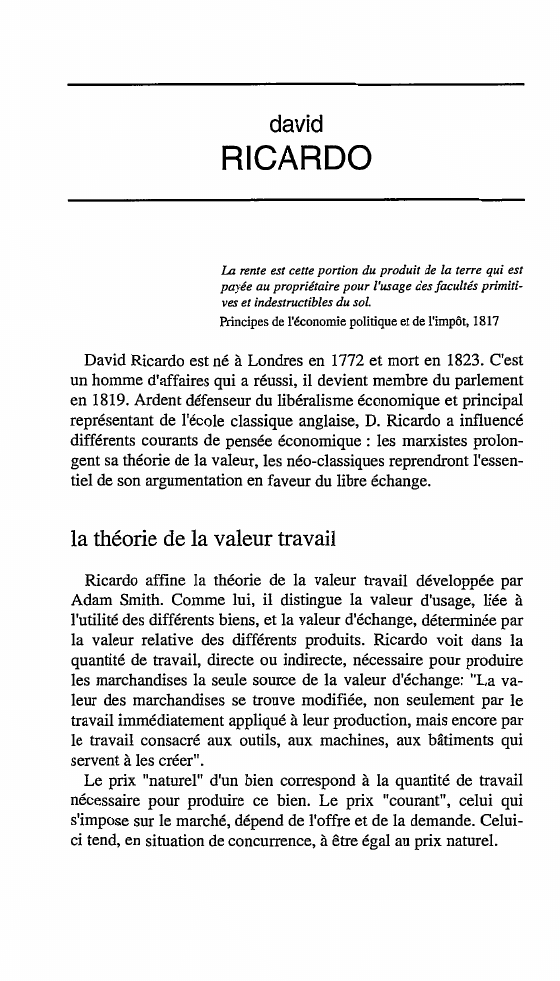david RICARDO La rente est cette portion du produit de la terre qui est payée au propriétaire pour l'usage des...
Extrait du document
«
david
RICARDO
La rente est cette portion du produit de la terre qui est
payée au propriétaire pour l'usage des facultés primitives et indestructibles du sol.
Principes de l'économie politique et de l'impôt, 1817
David Ricardo est né à Londres en 1772 et mort en 1823.
C'est
un homme d'affaires qui a réussi, il devient membre du parlement
en 1819.
Ardent défenseur du libéralisme économique et principal
représentant de l'école classique anglaise, D.
Ricardo a influencé
différents courants de pensée économique : les marxistes prolongent sa théorie de la valeur, les néo-classiques reprendront l'essentiel de son argumentation en faveur du libre échange.
la théorie de la valeur travail
Ricardo affine la théorie de la valeur travail développée par
Adam Smith.
Comme lui, il distingue la valeur d'usage, liée à
l'utilité des différents biens, et la valeur d'échange, déterminée par
la valeur relative des différents produits.
Ricardo voit dans la
quantité de travail, directe ou indirecte, nécessaire pour produire
les marchandises la seule source de la valeur d'échange: "La valeur des marchandises se trouve modifiée, non seulement par le
travail immédiatement appliqué à leur production, mais encore par
le travail consacré aux outils, aux machines, aux bâtiments qui
servent à les créer".
Le prix "naturel" d'un bien correspond à la quantité de travail
nécessaire pour produire ce bien.
Le prix "courant", celui qui
s'impose sur le marché, dépend de l'offre et de la demande.
Celuici tend, en situation de concurrence, à être égal au prix naturel.
la théorie de la répartition
La théorie de la répartition de David Ricardo est beaucoup plus
élaborée que celle d'Adam Smith.
En particulier, il montre les in
ter-relations qui peuvent exister entre la croissance et la réparti
tion, la théorie de la rente jouant un rôle central dans son analyse.
la détennination des salaires
Le travail étant considéré comme une marchandise, son prix na
turel, c'est à dire le salaire naturel, dépend de la quantité de travail
nécessaire pour assurer la subsistance de l'ouvrier; son prix cou
rant, c'est à dire le salaire effectivement perçu par le travailleur,
peut s'écarter momentanément du prix naturel du travail mais il
tend, par le jeu de la concurrence, à s'en rapprocher.
Les salaires ont donc tendance à s'établir au minimum de subsis
tance de l'ouvrier puisque ceux-ci "ainsi que tout autre contrat(...)
doivent être livrés à la concurrence franche et libre du marché, et
n'être jamais entravés par l'intervention du gouverneur".
Il s'agit d'un minimum sociologique, c'est à dire qu'il "varie à
différentes époques dans un même pays, et il est très différent
dans des pays divers".
la théorie de la rente
La rente diffère du profit du capital investi dans la terre, c'est le
revenu payé au propriétaire pour l'exploitation de la terre.
Lorsque des terres de fertilité différentes sont mises en oeuvre,
la rente est égale à la différence entre la production de blé obtenue
sur une terre donnée et la production de blé obtenue avec la même
quantité de travail et de capital sur la terre la moins fertile.
Le
propriétaire de cette dernière ne perçoit donc pas de rente.
En re
vanche, plus la population augmente et plus l'exploitation de ter
res de moins en moins fertiles est nécessaire pour nourrir la popu
lation; il en résulte une tendance historique à l'accroissement de la
rente perçue par les propriétaires des terres les plus fertiles.
la baisse tendancielle du taux de profit
Le minimum de subsistance des ouvriers, et donc leur salaire,
dépend en grande partie du prix du blé.
Or celui-ci augmente au
fur et à mesure que des terres de moins en moins fertiles sont ex
ploitées.
Ceci résulte de ce que les terres les moins fertiles mises
en exploitation nécessitent de plus en plus de travail pour une
même quantité produite.
En conséquence, les profits que rien ne modifie si "ce n'est la
hausse ou la baisse des salaires" ont tendance à diminuer.
Ricardo
énonce ainsi la loi de la baisse tendancielle du taux de profit.
Il va
mener encore plus loin son analyse en reliant l'étude de la réparti
tion à celle de la croissance.
la vision de l'état stationnaire
La baisse tendancielle des taux de profit conduit Ricardo à la vi-,
sion de l "'état stationnaire", c'est à dire de la croissance zéro, par
manque d'incitation à produire de la part des entreprises puisqu' "il
est aussi impossible au fermier et au manufacturier de vivre sans
profit qu'à l'ouvrier d'exister sans salaire".
L'apparition de l'état stationnaire ne peut être reculée dans le
temps que si l'accroissement du prix du blé est freiné.
C'est une
des raisons pour lesquelles Ricardo fut favorable au libre échange
et à la suppression des "corn law" qui limitaient l'importation du
blé en Grande-Bretagne.
L'entrée libre de blé en provenance de
l'étranger devait en effet permettre une diminution du prix du blé
qui ne porterait préjudice qu'aux propriétaires fonciers qui ver
raient diminuer leur rente, liée à un avantage de situation et non à
un effort productif.
un argument supplémentaire en faveur du libéralisme
Ainsi l'analyse de la répartition conduit Ricardo à présenter un
argument supplémentaire en faveur du libéralisme; celui-ci permet
de réduire les rentes de situation au bénéfice d'un revenu d'acti
vité, le profit, qui soutient la croissance.
La défense du libéralisme chez Ricardo s'exprime également par
la formulation de la théorie des avantages comparatifs.
la théorie des avantages comparatifs
une argumentation en faveur du libre échange...
Ricardo adhère aux idées défendues par A.
Smith selon lesquel
les le libéralisme crée un contexte favorable à la croissance éco
nomique.
Dans cette logique, il s'oppose aux pratiques protection
nistes.
Son argumentation favorable au libre échange est plus gé
nérale que celle d'A.
Smith dans la mesure où la conclusion de la
théorie des avantages comparatifs de Ricardo est que, même en
l'absence d'avantages absolus, les pays ont intérêt à être libre
échangistes; il suffit pour cela que les coûts relatifs des marchan
dises soient différents d'un pays à l'autre, ce qui est généralement
le cas.
En effet, un pays a intérêt à se spécialiser dans les marchandises
pour lesquelles il possède l'avantage relatif le plus grand, c'est à
dire pour lesquelles le coût relatif est le plus faible.
Ricardo raisonne en considérant les coûts réels du travail, ex
primés dans l'exemple développé dans son ouvrage "Principes de
l'économie politique et de l'impôt" en temps de travail.
Ainsi, il
considère une situation où l'Angleterre a besoin , "pour fabriquer le
drap, du travail de 100 hommes par an, tandis que si elle voulait
faire du vin, il lui faudrait peut-être le travail de 120 hommes par
an.
(...
) En Portugal, la fabrication du vin pourrait ne demander
que le travail de 80 hommes, pendant une année , tandis que la fa
brication du drap, dans ce pays, exigerait le travail de 90 hom
mes".
Et, Ricardo met en évidence que "quoique le Portugal pût
faire son drap en n'employant que 90 hommes, il préférerait le ti
rer d'un autre pays où il faudrait 100 ouvriers pour le fabriquer,
parce qu'il trouverait plus de profit à employer son capital à la
production de vin, en échange duquel il obtiendrait de l'Angleterre
plus de drap qu'il ne pourrait produire en détournant une portion
de son capital employé à la culture des vignes, et en l'employant à
la fabrication des draps."
...valable sous certaines hypothèses
Ricardo a précisé le cadre d'hypothèses dans lesquelles sa dé
monstration est valable.
En particulier, il suppose une très faible
136 RICARDO
mobilité des capitaux au niveau international.
Cette hypothèse de
rigidité des facteurs de production, si elle était, pour partie, réaliste au début....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓