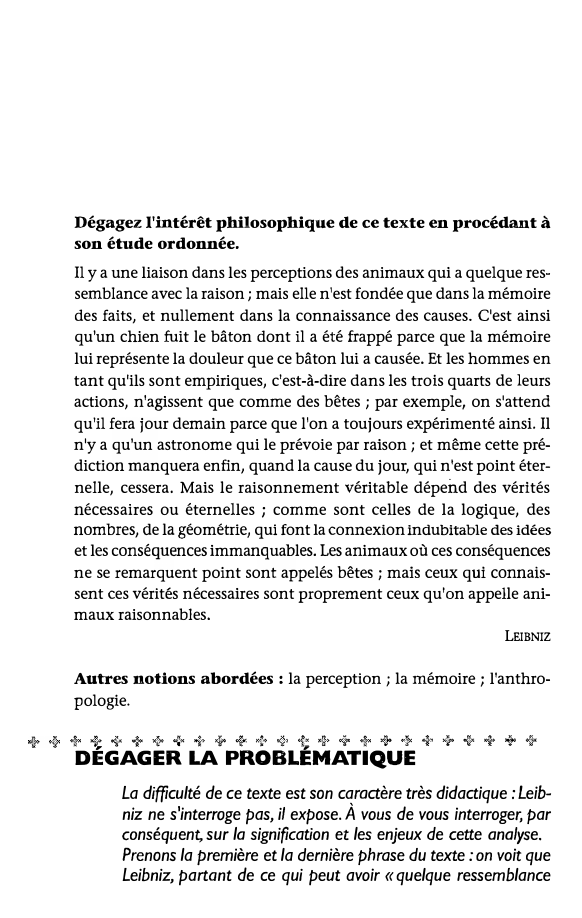Dégagez l'intérêt philosophique de ce texte en procédant à son étude ordonnée. Il y a une liaison dans les perceptions...
Extrait du document
«
Dégagez l'intérêt philosophique de ce texte en procédant à
son étude ordonnée.
Il y a une liaison dans les perceptions des animaux qui a quelque res
semblance avec la raison; mais elle n'est fondée que dans la mémoire
des faits, et nullement dans la connaissance des causes.
C'est ainsi
qu'un chien fuit le bâton dont il a été frappé parce que la mémoire
lui représente la douleur que ce bâton lui a causée.
Et les hommes en
tant qu'ils sont empiriques, c'est-à-dire dans les trois quarts de leurs
actions, n'agissent que comme des bêtes ; par exemple, on s'attend
qu'il fera jour demain parce que l'on a toujours expérimenté ainsi.
Il
n'y a qu'un astronome qui le prévoie par raison ; et même cette pré
diction manquera enfin, quand la cause du jour, qui n'est point éter
nelle, cessera.
Mais le raisonnement véritable dépend des vérités
nécessaires ou éternelles ; comme sont celles de la logique, des
nombres, de la géométrie, qui font la connexion indubitable des idées
et les conséquences immanquables.
Les animaux où ces conséquences
ne se remarquent point sont appelés bêtes ; mais ceux qui connais
sent ces vérités nécessaires sont proprement ceux qu'on appelle ani
maux raisonnables.
LEIBNIZ
Autres notions abordées: la perception; la mémoire; l'anthro
pologie.
+�+++++++++++++++++++++
DÉGAGER LA PROBLÉMATIQUE
La difficulté de ce texte est son caractère très didactique : Leib
niz ne s'interroge pas, il expose.
À vous de vous interroger, par
conséquent, sur la signification et les enjeux de cette analyse.
Prenons la première et la dernière phrase du texte : on voit que
Leibniz, partant de ce qui peut avoir « quelque ressemblance
avec la raison» chez les animaux, parvient à la définition la plus
rigoureuse de la raison, qui permet de distinguer les hommes
qui « sont proprement ceux qu'on appelle animaux raisonnables».
Leibniz reprend donc à son compte la fameuse distinction aristotélicienne pour définir plus précisément cette
différence spécifique qui distingue l'homme du reste du monde
des «bêtes».
++++~++++++++++++++++++++
REPERER LE MOUVEMENT DU TEXTE
Dans un premier temps, Leibniz repère le genre de liaison de
représentations que l'on peut attribuer aux animaux d'après la
cohérence de leurs conduites : ils perçoivent des images et les
associent dans leur mémoire.
Mais la remémoration d'enchaînement n'est pas encore une connaissance.
Leibniz remarque alors que.
l'homme est un animal raisonnable: il partage avec les animaux l'association d'idées, qu'il
porte à un plus haut point d'abstraction lorsqu'il procède par
induction comme le fait l'astronome.
Mais ce qui fait de l'homme un anjmal raisonnable, c'est la
possibilité de connaître les « vérités éternelles» : en ce/a il
exprime une correspondance plus étroite avec Dieu lui-même.
++
❖ ❖
++
❖
+ + + + + + + ·+ + +
EXPLICITER LES TERMES
❖
++
❖
++++
- Mémoire des faits I connaissance_ des causes : cette opposition permet de souligner la différence entre perceptions et souvenirs d'une part, et concepts d'autre part La mémoire des faits
n'implique que la faculté de se représenter d'anciennes perceptions grâce à l'imagination.
Elles ont certes subi une transformation en raison du travail de la mémoire, mais elles sont
tout de même analogues aux perceptions actuelles.
La connaissance des causes mobilise au contraire des données abstraites,
elle suppose une liaison logique d'éléments généraux qui ne sont
plus liés directement à l'intuition sensible.
- «Les hommes en tant qu'ils sont empiriques[...
] n'agissent
que comme des bêtes» :il ne faut surtout pas penser que Leibniz reproche ici à l'homme un comportement« bestial» ou qu'il
le juge stupide ! Il s'agit tout simplement de remarquer que
notre rapport à l'expérience (« en tant que nous sommes empiriques») ne requiert pas de nous une élaboration très abstraite
110 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
de nos connaissances.
La connaissance commune repose sur
l'opinion et l'habitude.
- « des vérités nécessaires et éternelles» : c'est-à-dire des vérités qui ne sont pas dépendantes de l'état du monde, qui ne
concernent pas les phénomènes mais ont un plus haut degré
de généralité.
Aux exemples que cite Leibniz, à savoir les principes de la logique et des mathématiques, on pourrait éventuellement ajouter les « vérités métaphysiques».
Alors que
Descartes pense que Dieu a créé toutes les vérités (par exemple
les vérités mathématiques) « comme un souverain en son
royaume», c'est-à-dire qu'il aurait pu les créer différentes, Leibniz pense que leur nécessité est telle qu'elle exclut tout changement, y compris pour Dieu.
Ces vérités sont «incréées»,
c'est-à-dire véritablement éternelles.
Introduction
Que veut-on dire au juste lorsque l'on dit que l'homme est un « animal
raisonnable»? Cela signifie-t-il, comme le suggère Descartes, que les autres
animaux, entièrement dépourvus de raison, soient de simples machines ?
Et en quoi consiste véritablement la raison humaine ?
Leibniz propose une réponse à ces deux questions simultanément en
appuyant sa compréhension de la raison humaine sur une comparaison avec
la conduite quasi rationnelle des animaux.
Pour établir cette comparaison, Leibniz suit une démarche en trois temps
qui sont autant d'étapes de l'analyse du concept de raison.
La première
consiste à repérer la « liaison des idées» effectuée par les animaux doués non
seulement de perception, mais aussi de mémoire.
Les deux étapes suivantes
sont une analyse terme à terme du concept d'animal raisonnable : animal,
l'homme utilise aussi l'association d'idées, en la perfectionnant toutefois par
la démarche intellectuelle de l'induction, de la connaissance des causes empiriques.
Rationnel, l'homme ne l'est au sens propre que parce qu'il peut accéder aux« vérités éternelles».
C'est à ce concept et à ce qui le distingue même
des connaissances de l'astronome, qu'il nous faudra porter une attention
particulière.
Suir.t national
osophle • Série L
111
Étude ordonnée et intérêt philosophique
En abordant le texte, on pourrait croire qu'il s'agit d'un plaidoyer pour la
reconnaissance d'une raison des animaux; ceux-ci ne sont pas identifiés à de
simples machines vivant purement dans l'instant : cette« liaison» ne révèle-telle pas la présence de la conscience ou de la raison? En fait, c'est pour en distinguer la raison proprement dite que Leibniz évoque cette conduite animale.
Notons tout d'abord que ce qui est lié, ce sont des «perceptions» et non des
idées.
Leibniz ne dit pas que les animaux tiennent des raisonnements, mais que
leurs perceptions ne restent pas isolées les unes des autres et forment un tout
cohérent aboutissant à des conduites pertinentes.
Il ne donne pas à penser que
les animaux sont conscients de ce processus et encore moins qu'ils le dirigent
et le maîtrisent.
La mémoire travaille même chez l'homme de façon souterraine.
La ressemblance avec la raison apparaît....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓