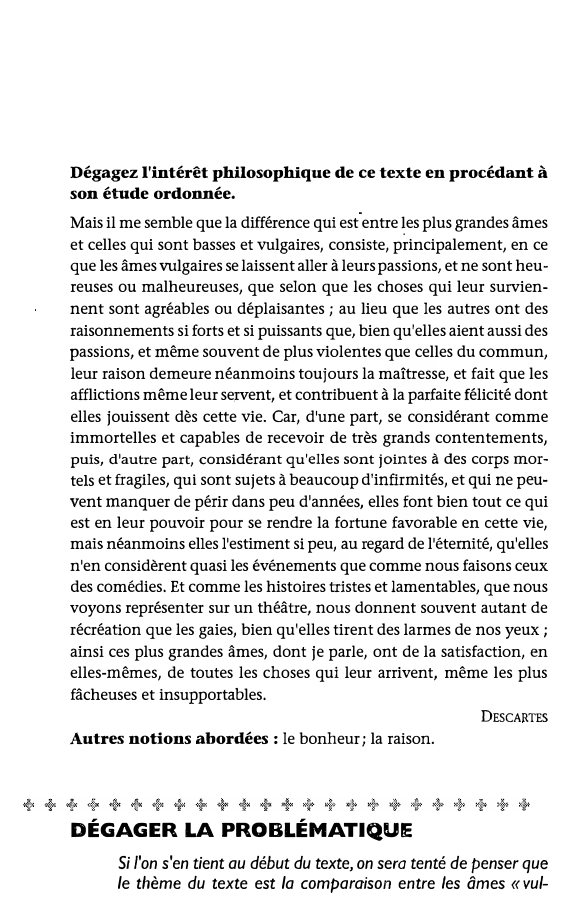Dégagez l'intérêt philosophique de ce texte en procédant à son étude ordonnée. Mais il me semble que la différence qui...
Extrait du document
«
Dégagez l'intérêt philosophique de ce texte en procédant à
son étude ordonnée.
Mais il me semble que la différence qui est entre �es plus grandes âmes
et celles qui sont basses et vulgaires, consiste, principalement, en ce
que les âmes vulgaires se laissent aller à leurs passions, et ne sont heu
reuses ou malheureuses, que selon que les choses qui leur survien
nent sont agréables ou déplaisantes ; au lieu que les autres ont des
raisonnements si forts et si puissants que, bien qu'elles aient aussi des
passions, et même souvent de plus violentes que celles du commun,
leur raison demeure néanmoins toujours la maîtresse, et fait que les
afflictions même leur servent, et contribuent à la parfaite félicité dont
elles jouissent dès cette vie.
Car, d'une part, se considérant comme
immortelles et capables de recevoir de très grands contentements,
puis, d'autre part, considérant qu'elles sont jointes à des corps mor
tels et fragiles, qui sont sujets à beaucoup d'infirmités, et qui ne peu
vent manquer de périr dans peu d'années, elles font bien tout ce qui
est en leur pouvoir pour se rendre la fortune favorable en cette vie,
mais néanmoins elles l'estiment si peu, au regard de l'éternité, qu'elles
n'en considèrent quasi les événements que comme nous faisons ceux
des comédies.
Et comme les histoires tristes et lamentables, que nous
voyons représenter sur un théâtre, nous donnent souvent autant de
récréation que les gaies, bien qu'elles tirent des larmes de nos yeux ;
ainsi ces plus grandes âmes, dont je parle, ont de la satisfaction, en
elles-mêmes, de toutes les choses qui leur arrivent, même les plus
fâcheuses et insupportables.
DESCARTES
Autres notions abordées : le bonheur; la raison.
DÉGAGER LA PROBLÉMATIQUE
Si l'on s'en tient au début du texte, on sera tenté de penser que
le thème du texte est la comparaison entre /es âmes « vu/-
gaires » et les âmes «nobles», les secondes étant libres à l'égard
des passions qui égarent les premières.
Or une lecture plus attentive montre que cette comparaison
occupe une place assez réduite dans le texte.
Pour s'assurer que l'on a bien saisi la problématique,
il est souvent utile de comparer la première et la dernière phrase du texte en se demandant par quelle
démarche l'auteur est passé de l'une à l'autre.
Ici, la réflexion porte en fait sur la question suivante : comment
les âmes nobles (les hommes raisonnables, les sages) font-elles
pour demeurer heureuses malgré les passions et les malheurs?
++++~+++++++++++++++++++
REPERER LE MOUVEMENT DU TEXTE
Pour mieux faire le portrait de l'âme «élevée», Descartes commence par l'opposer à l'âme« basse», dont l'état intérieur varie
au gré des circonstances extérieures ; l'homme raisonnable, au
contraire, nourrit la stabilité de sa «félicité» aussi bien des événements heureux que des infortunes.
Descartes explique ensuite le principe des « raisonnements si
forts» de l'homme raisonnable : il s'agit de maintenir la
conscience de la distinction réelle entre l'âme et le corps : le
caractère fragile et mortel du corps ne saurait affecter la tranquillité et la satisfaction de /'âme qui se sait immortelle.
Dans le droit fil de la tradition stoïcienne, Descartes illustre
cette distinction par l'analogie du théâtre.
Le sage travaille à son
bonheur mais observe à l'égard de son existence l'attitude d'un
spectateur que le destin des personnages de la pièce ne peut
affecter.
++++++++++++++++++++++++
EXPLICITER LES TERMES
- « Des raisonnements si forts et si puissants» : cette expres-
sion semble emblématique du rationalisme cartésien.
Suffit-il
donc de réfléchir puissamment pour vaincre les passions et
n'être affecté par aucune contrariété ? Comment comprendre
ce terme de «forts raisonnements» ?
Deux explications sont possibles : on peut tout d'abord rappeler que la raison est la capacité d'établir des rapports, des
proportions.
Autrement dit la capacité de ne pas seulement
vivre l'émotion immédiate, mais de la relativiser par rapport à
Polvnésie fq1ncais~
Philosophie - Serle ES
45
des éléments objectifs (considérer la nature exacte de la cause
de l'émotion, /es actions concrètes possibles, etc.).
La seconde
explication est proposée par Descartes dans la suite du texte :
par la raison j'ai l'idée de la distinction de l'âme et du corps (qui
demeurent cependant unis) et je peux me consoler des tourments du corps en me rappelant que l'âme est appelée à considérer toute chose sub specie aeternitatis, du point de vue
de l'éternité.
- « Des passions ...
plus violentes que ce/les du commun» :
n'est-il pas étonnant d'affirmer que /es tempéraments /es plus
raisonnables éprouvent des passions plus fortes que ceux qui
semblent livrés en permanence à toutes sortes de passions ?
En fait la sensibilité de ces derniers est émoussée par l'habitude
des changements d'humeur, alors que /es tempéraments nobles
possèdent une conscience plus aiguë et attentive des mouvements de /eiJr âme.
- « Immortelles et capables de recevoir de très grands contentements» : l'immortalité de l'âme est un attribut métaphysique
fondamental, établi à la suite du cogito; c'est en tant qu'âme
(«chose pensante») que je découvre que je suis de façon certaine.
L'âme est connue avant le corps et de façon plus certaine.
L'âme est capable de « recevoir de très grands contentements»
dans la mesure où elle peut connaître la joie, plus complète et
plus durable que le plaisir qui est le lot du corps.
Le «contentement» est un thème cher à Descartes, qui l'associe toujours
à la découverte de la vérité.
Introduction
Face aux aléas du sort, aux revers de fortune, les hommes peuvent-ils
vivre autrement que dans une alternance permanente de misère profonde
et d'enthousiasme éphémère, si bien qu'il deviendrait impossible de parler
d'une réussite de la vie elle-même, d'une vie heureuse ?
46
Descartes, fidèle en cela à la tradition stoïcienne, pense au contraire que
le sage doit savoir conserver une « parfaite félicité» malgré les tourments et même grâce à eux.
Pour développer cette thèse, Descartes s'appuie tout d'abord sur l'opposition entre les âmes «vulgaires» livrées aux passions et les âmes «nobles»
qui savent leur ?PPOSer de «profonds raisonnements».
Ces derniers sont
ensuite détaillés ; ils ont pour principe l'opposition entre l'immortalité de
l'âme et le caractère mortel du corps ; cette opposition aboutit enfin à la
métaphore du spectateur.
Nous étudierons ces arguments en nous demandant comment à travers
cet extrait apparaît un aspect moral de ce qu'on appelle le « rationalisme cartésien».
Étude ordonnée et intérêt philosophique
La première moitié du texte est occupée par l'exposé de «la différence qui
est entre les plus grandes âmes et celles qui sont basses et vulgaires».
On peut noter d'emblée que l'enjeu de cette opposition n'est pas la pure
opposition entre raison et passion au sens où les âmes basses ne connaîtraient
que les passions et les âmes élevées que la raison.
Aucune communication ne
serait alors possible ni aucune conversion de l'âme.
Les âmes nobles connaissent au contraire l'épreuve des passions, et même, dit Descartes, «de plus violentes que celles du commun».
Précision qui peut s'expliquer par le fait que les
âmes....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓