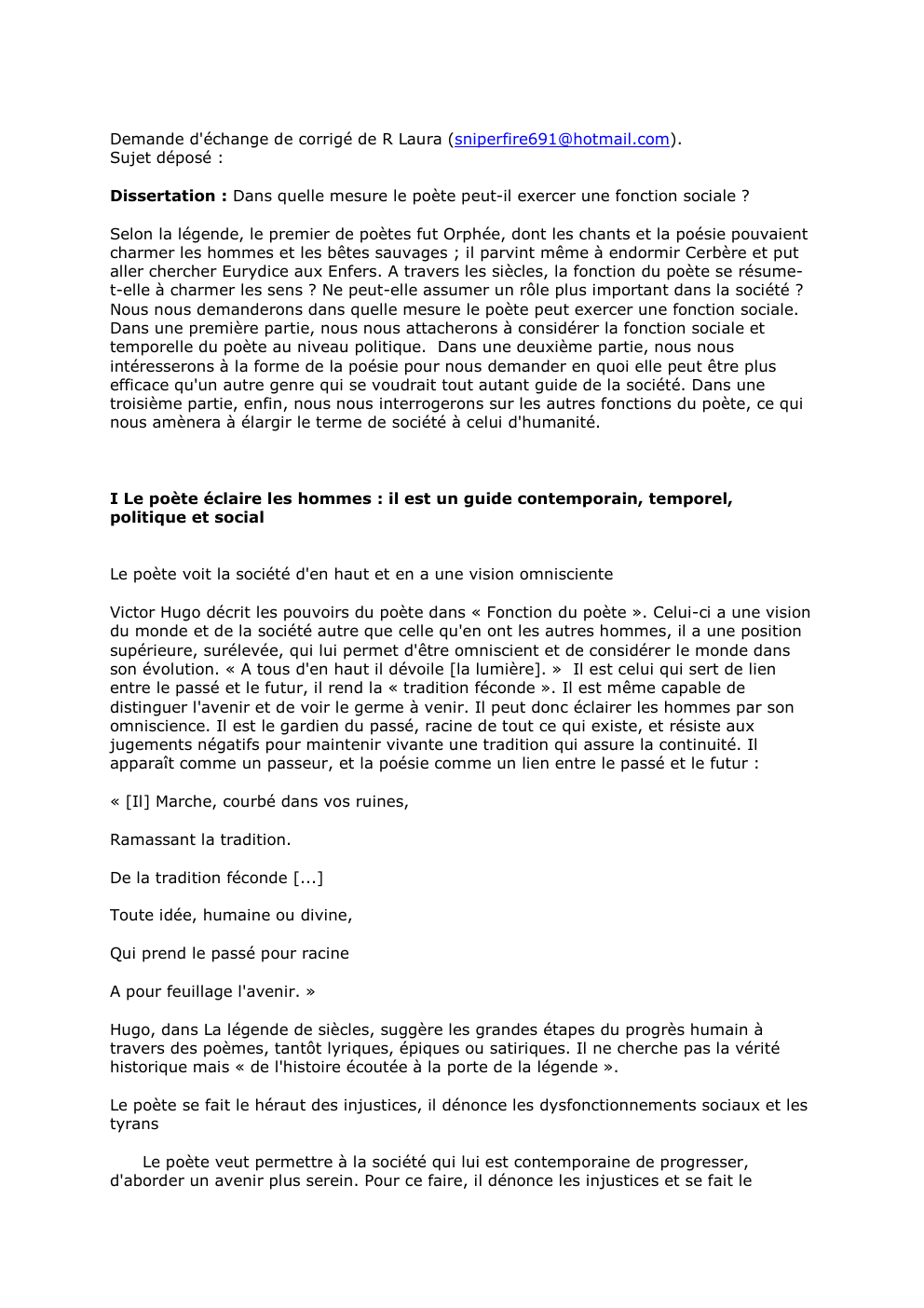Demande d'échange de corrigé de R Laura ([email protected]). Sujet déposé : Dissertation : Dans quelle mesure le poète peut-il exercer...
Extrait du document
«
Demande d'échange de corrigé de R Laura ([email protected]).
Sujet déposé :
Dissertation : Dans quelle mesure le poète peut-il exercer une fonction sociale ?
Selon la légende, le premier de poètes fut Orphée, dont les chants et la poésie pouvaient
charmer les hommes et les bêtes sauvages ; il parvint même à endormir Cerbère et put
aller chercher Eurydice aux Enfers.
A travers les siècles, la fonction du poète se résumet-elle à charmer les sens ? Ne peut-elle assumer un rôle plus important dans la société ?
Nous nous demanderons dans quelle mesure le poète peut exercer une fonction sociale.
Dans une première partie, nous nous attacherons à considérer la fonction sociale et
temporelle du poète au niveau politique.
Dans une deuxième partie, nous nous
intéresserons à la forme de la poésie pour nous demander en quoi elle peut être plus
efficace qu'un autre genre qui se voudrait tout autant guide de la société.
Dans une
troisième partie, enfin, nous nous interrogerons sur les autres fonctions du poète, ce qui
nous amènera à élargir le terme de société à celui d'humanité.
I Le poète éclaire les hommes : il est un guide contemporain, temporel,
politique et social
Le poète voit la société d'en haut et en a une vision omnisciente
Victor Hugo décrit les pouvoirs du poète dans « Fonction du poète ».
Celui-ci a une vision
du monde et de la société autre que celle qu'en ont les autres hommes, il a une position
supérieure, surélevée, qui lui permet d'être omniscient et de considérer le monde dans
son évolution.
« A tous d'en haut il dévoile [la lumière].
» Il est celui qui sert de lien
entre le passé et le futur, il rend la « tradition féconde ».
Il est même capable de
distinguer l'avenir et de voir le germe à venir.
Il peut donc éclairer les hommes par son
omniscience.
Il est le gardien du passé, racine de tout ce qui existe, et résiste aux
jugements négatifs pour maintenir vivante une tradition qui assure la continuité.
Il
apparaît comme un passeur, et la poésie comme un lien entre le passé et le futur :
« [Il] Marche, courbé dans vos ruines,
Ramassant la tradition.
De la tradition féconde [...]
Toute idée, humaine ou divine,
Qui prend le passé pour racine
A pour feuillage l'avenir.
»
Hugo, dans La légende de siècles, suggère les grandes étapes du progrès humain à
travers des poèmes, tantôt lyriques, épiques ou satiriques.
Il ne cherche pas la vérité
historique mais « de l'histoire écoutée à la porte de la légende ».
Le poète se fait le héraut des injustices, il dénonce les dysfonctionnements sociaux et les
tyrans
Le poète veut permettre à la société qui lui est contemporaine de progresser,
d'aborder un avenir plus serein.
Pour ce faire, il dénonce les injustices et se fait le
messager de la vérité.
Ainsi Victor Hugo dénonce le tyran, Napoléon III, dans « Ultima
Verba », alors qu'il est exilé à Jersey ; au moment où les exilés peuvent rentrer en
France à condition de se soumettre, l'auteur appelle à ne pas céder et rappelle qu'il
soutiendra la liberté et la République envers et contre tous, même s'il doit être seul.
Ses
Châtiments constituent une satire du second Empire.
Cette mission du poète comme
dénonciateur n'est pas une nouveauté au 19ème siècle : Hugo s'inscrit dans toute une
tradition littéraire, qui fait des auteurs des porte-parole de la vérité et de la
justice.
Entre 1577 et 1616, Agrippa d'Aubigné écrit Les Tragiques, grand poème
épique dans lequel il dénonce Henri IV, le roi apostat qui s'est donné à l'ennemi,
passant du camp des Protestants à celui des Catholiques au moment où il se fait
baptiser.
Des années plus tard, La Fontaine fait la satire des grands, de leurs ridicules et
de leurs injustices dans ses Fables.
Après Hugo, Rimbaud dénonce les ravages de la
guerre de 1870 dans son poème « Le Dormeur du Val » ; au XXème siècle, Paul Eluard
répond à ses amis qui lui ont reproché de s'être engagé politiquement que « La poésie
doit avoir pour but la vérité pratique ».
La fonction sociale de la poésie est pour lui
essentielle.
3) Le poète fait l'éloge des hommes à prendre pour modèle, des héros contemporains
Il (Paul Eluard) se fait le chantre de la résistance en 1942 en écrivant son célèbre poème
« Liberté », dont voici la première strophe :
«Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J'écris ton nom »
Le quatrième vers se répète à chaque strophe, se faisant incantatoire et donnant toute sa
force à l'appel de la liberté.
Dans « Strophes pour se souvenir », extraites du Roman inachevé paru en 1956, Louis
Aragon lui aussi s'engage politiquement en rendant hommage à des combattants
injustement condamnés à mort, des membres du groupe Manouchian, résistants
étrangers fusillés par les Allemands en 1944.
Son poème montre la fonction de
dénonciation, mais aussi de célébration de la poésie : il met en avant leur courage en
présentant leur mort simple et sobre et en reprenant la dernière lettre de Manouchian,
qui de prose devient poésie et appel à l'espoir, au bonheur, à la justice de l'avenir, et
refus de la haine.
TR : Le poète peut bel et bien exercer une fonction sociale en donnant son opinion sur les
événements sociaux et politiques de son époque.
On peut s'interroger sur le choix du
genre de la poésie pour transmettre un message d'une telle nature : la poésie donne-telle de la force à l'argumentation ?
II La langue poétique est plus efficace
La poésie est plus facilement retenue
La forme de la poésie lyrique rend l'hommage d'Aragon au groupe Manouchian d'autant
plus fort, notamment par la force de l'anaphore de la dernière strophe :
« Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent
Vingt et trois qui donnaient leur c½ur avant le temps
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir
Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant.
»
La poésie touche davantage la sensibilité qu'un texte en prose, il persuade plutôt qu'il ne
convainc.
Il touche par la position des mots stratégiques, par les figures de style, les jeux
de répétition et de sonorités.
De plus, le texte poétique est plus facile à retenir et
contribue ainsi à sa mémorisation.
Les vers, qu'ils soient réguliers ou libres, expriment
avec force : on les retient aisément.
La fable, parce qu'il s'agit d'un apologue, mais aussi
parce qu'elle est musicale, a plus de force peut-être que quand elle est en prose, chez
Esope par exemple.
La Fontaine a réfléchi sur le pouvoir de la fable en ces termes :
« Les Fables ne sont pas ce qu'elles semblent être.
Le plus simple animal nous y tient lieu de Maître.
Une Morale nue apporte de l'ennui ;
Le conte fait passer le précepte avec lui.
En ces sortes de feinte il faut instruire et plaire,
Et conter pour conter me semble peu d'affaire.
» (« Le patre et le lion »)
Les proverbes de La Fontaine sont connus de tous, bien plus que leur auteur lui-même,
comme, pour n'en citer qu'un : « La raison du plus fort est toujours la meilleure.
»
Les rimes et la diction du poème le rendent incantatoire : ainsi, « Fonction du poète » de
Hugo, constitué de dizains d'octosyllabes construits sur la même disposition de rimes
(abab, cc, deed) offre des vers courts qui occasionnent un retour rapide à la rime et
donnent à la lecture du texte une allure saccadée et rapide, accumulant les images ;
ainsi se trouvent mises en relief énumérations et anaphores.
L'écriture poétique se
caractérise par son caractère polysémique et souvent elliptique.
Le choix de cette écriture
permet de concentrer et de mettre en valeur des images qui font ressortir des idées sous
une forme plus frappante pour l'imagination du lecteur.
Par exemple, Hugo file la
métaphore assimilant le poète au Christ, par analogies, associations d'idées et
glissements de sens ; les épines par exemple participent de la métaphore de la
végétation et de celle du martyr du Christ.
La dernière strophe du poème, par ses
hyperboles, l'accumulation de termes évoquant la lumière, se fait persuasive, et culmine
dans les deux derniers vers : « Car la poésie est l'étoile/ Qui mène à Dieu rois et
pasteurs ! ».
Le choix d'une forme poétique permet à Hugo de mettre en action les idées
qu'il exprime.
Le caractère imagé, musical, rythmé de l'écriture rend le texte plus
persuasif parce qu'il montre l'enthousiasme du poète et sa conviction personnelle.
Victor
Hugo varie les genres pour exprimer ce qu'il pense ; on pense par exemple aux Derniers
jours d'un condamné, texte également poignant.
Elle est intemporelle
La poésie dépasse le temps : en effet, même quand un poète s'engage politiquement à
une époque donnée, il défend toujours des valeurs universelles : liberté, égalité,
fraternité.
Dans « Liberté j'écris ton nom » d'Eluard, le présent de l'énonciation se
pérennise par l'écriture : « Sur mes cahiers d'écolier...
/J'écris ton nom.../ Liberté ».
Les
poètes, en peignant les hommes de leur époque, décrivent la nature humaine ; si les
hommes des fables de La Fontaine ont changé de caste sociale ou de langage, ils
révèlent les mêmes défauts et les mêmes qualités qu'aujourd'hui.
Cela explique pourquoi
les Fables peuvent être lues avec autant d'intérêt, aujourd'hui encore.
La poésie, un langage universel
Les poètes créent un langage intemporel et universel, qui est à la fois semblable et
différent de celui que l'on utilise tous les jours.
La principale différence, explique Sartre
dans Qu'est-ce que la littérature, c'est que la poésie n'a plus la fonction purement
utilitaire du langage de tous les jours.
Les mots deviennent des choses, des objets d'art.
L'ambiguïté du langage poétique est mise en évidence par Paul Claudel dans la
quatrième ode de ses Cinq grandes Odes (1910), textes poétiques écrits en versets (le
verset claudélien est un vers irrégulier, libre, qui repose sur des phrases de longueur
différente, marquées par des alinéas) :
«
Les mots que j'emploie,
Ce sont les mots de tous les jours, et ce ne sont point les mêmes !
Vous ne trouverez point de rimes dans mes vers ni aucun sortilège.
Ce sont vos phrases
mêmes.
Pas aucune de vos phrases que je ne sache reprendre !
Ces fleurs sont vos fleurs et vous ne les reconnaissez pas.
Et ces pieds sont vos pieds, mais voici que je marche sur la mer et que je foule les eaux
de la mer en triomphe ! »
( Quatrième Ode, « La Muse qui est la grâce ».)
Pour Arthur Rimbaud, le langage de la poésie doit correspondre au sujet.
En 1871, alors
qu'il n'a que dix-sept ans, il écrit une lettre restée célèbre à Paul Demeny et y explique
ses théories poétiques ; le poète est un « voyant » qui arrive à « l'inconnu....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓