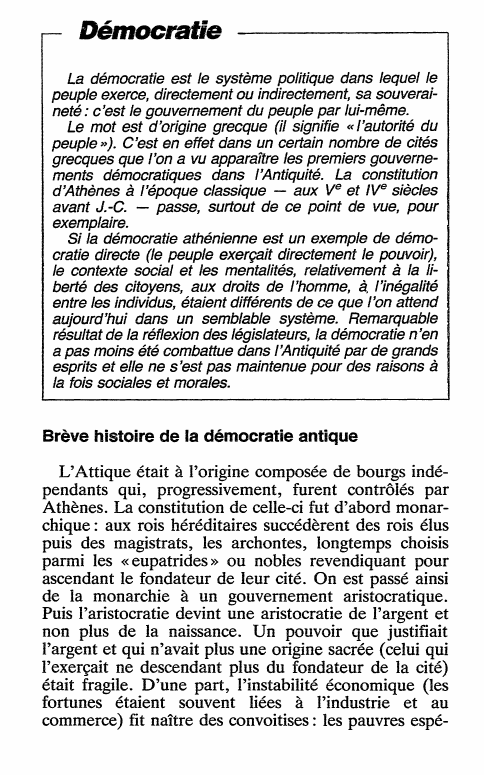Démocratie La démocratie est le système politique dans lequel le peuple exerce, directement ou indirectement, sa souveraineté: c'est le gouvernement...
Extrait du document
«
Démocratie
La démocratie est le système politique dans lequel le
peuple exerce, directement ou indirectement, sa souveraineté: c'est le gouvernement du peuple par lui-même.
Le mot est d'origine grecque (il signifie « l'autorité du
peuple»).
C'est en effet dans un certain nombre de cités
grecques que l'on a vu apparaitre les premiers gouvernements démocratiques dans /'Antiquité.
La constitution
d'Athènes à l'époque classique - aux
et
siècles
avant J.-C.
- passe, surtout de ce point de vue, pour
exemplaire.
Si la démocratie athénienne est un exemple de démocratie directe (le peuple exerçait directement le pouvoir),
le contexte social et les mentalités, relativement à la liberté des citoyens, aux droits de l'homme, él l'inégalité
entre les individus, étaient différents de ce que l'on attend
aujourd'hui dans un semblable système.
Remarquable
résultat de la réflexion des législateurs, la démocratie n'en
a pas moins été combattue dans /'Antiquité par de grands
esprits et elle ne s'est pas maintenue pour des raisons à
la fois sociales et morales.
ve tve
Brève histoire de la démocratie antique
L' Attique était à l'origine composée de bourgs indépendants qui, progressivement, furent contrôlés par
Athènes.
La constitution de celle-ci fut d'abord monarchique : aux rois héréditaires succédèrent des rois élus
puis des magistrats, les archontes, longtemps choisis
parmi les « eupatrides » ou nobles revendiquant pour
ascendant le fondateur de leur cité.
On est passé ainsi
de la monarchie à un gouvernement aristocratique.
Puis l'aristocratie devint une aristocratie de l'argent et
non plus de la naissance.
Un pouvoir que justifiait
l'argent et qui n'avait plus une origine sacrée (celui qui
l'exerçait ne descendant plus du fondateur de la cité)
était fragile.
D'une part, l'instabilité économique (les
fortunes étaient souvent liées à l'industrie et au
commerce) fit naître des convoitises : les pauvres espé-
rèrent s'enrichir eux aussi, donc gouverner.
D'autre
part, en raison des guerres fréquentes, le nombre des
citoyens diminua: il fallut faire appel aux autres qui,
ayant rempli des devoirs au combat, revendiquèrent
des droits dans la paix.
Ainsi naquit la démocratie : de
l'émergence de nouvelles catégories sociales et de la
transformation des mentalités.
Dracon (au vue siècle avant J.-C.), auteur d'un code
judiciaire sévère (le mot «draconien» nous est resté),
puis Solon (vers 640-vers 558 avant J.-C.), réformateur
qui fit notamment prévaloir entre les citoyens la distinction par la fortune sur celle de la naissance, préparèrent l'œuvre de Clisthène (VIe siècle avant J.-C.) qui,
procédant à un nouveau découpage territorial, donna
sa forme définitive à la constitution démocratique
d'Athènes.
Périclès, en 460 avant J.-C., fit accorder de
l'argent aux citoyens qui renonçaient à leur activité
personnelle pour servir l'Etat.
Puis l'inégalité des fortunes que ne compensait pas
l'égalité des droits entre les citoyens, et la conscience
que prirent les pauvres de leur pouvoir politique, minèrent la démocratie.
Ses règles furent moins strictement
observées.
On se fit payer pour assister à l'assemblée,
on vendit ses suffrages, on pressura les riches et on les
exila pour s'approprier leurs biens: la liberté et les
droits de l'individu comptaient peu devant le pouvoir
de l'Etat et l'Etat c'était, de plus en plus, une majorité
défavorisée qui entendait prendre l'argent où il fallait,
chez les riches, privés en l'occurrence de tout recours.
La démocratie se pervertit et elle évolua souvent vers
l'affrontement social, les uns s'efforçant de prendre aux
autres ce que ceux-ci refusaient de partager.
Dès lors que le régime d'assemblée et l'équilibre des
pouvoirs étaient moins strictement assurés, que les
citoyens se sentaient moins concernés par le service
désintéressé de l'Etat, la démocratie cessait d'être un
système politique efficace pour exprimer les revendications d'une partie défavorisée de la population.
On
devait assister à Rome à un semblable glissement qui
mena de la république à l'empire.
Fonctionnement de la démocratie
La constitution athénienne, à l'époque classique, fut
démocratique parce que le peuple gouvernait dans un
régime d'assemblée strictement contrôlé.
Il y avait en
effet une grâdation des pouvoirs.
Les magistrats, d'abord choisis par le sort lorsque
leur fonction était encore de nature religieuse, puis élus
par le peuple lorsqu'elle devint d'ordre public uniquement, veillaient aux intérêts matériels de la cité.
Ils
devaient faire exécuter les lois.
Leur charge était annuelle et il fallait présenter des garanties avant de l'assumer.
Comme ils étaient très nombreux, chaque citoyen pouvait espérer un jour sa part des honneurs.
Au-dessus des magistrats, il y avait le sénat ou
«boulé», composé de 500 citoyens tirés au sort chaque
année.
C'était une assemblée délibérante qui préparait
-les projets de lois.
Au-dessus du sénat, il y avait « l'ecclésia », ou assemblée du peuple, qui votait les lois et
qui exerçait souverainement le pouvoir.
Tous les citoyens pouvaient y participer: l'ordre du jour était
strict.
Quand un projet de décret avait été présenté, les
orateurs s'exprimaient pour ou contre.
Chacun, qu'il
fût riche ou pauvre, avait droit à la parole, à la condition de prouver qu'il était bien citoyen, de bonnes
mœurs, propriétaire dans l' Attique et honorablement
connu.
Le public était très attentif: il demandait à
avoir une connaissance complète de la question abordée.
Les orateurs pouvaient donc acquérir une grande
réputation ( on les appela «démagogues», ce qui veut
dire, au sens propre, «conducteurs de la cité», car ils
déterminaient le vote populaire).
Ils engageaient d'ailleurs leur responsabilité, et on pouvait plus tard leur
demander des comptes sur les conseils qu'ils avaient
donnés.
La parole était donc un rouage essentiel de la démocratie athénienne et la discussion sa méthode de travail.
Comme l'écrit Maurice Duverger dans Introduction à la
Politique: « Reprocher à la démocratie d'exprimer, au
grand jour, des controverses, des disputes, des conflits,
c'est méconnaître un de ses buts fondamentaux.
Elle
tend à substituer la discussion à la bataille, le dialogue
aux fusils ...
»
La conception que se faisaient....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓