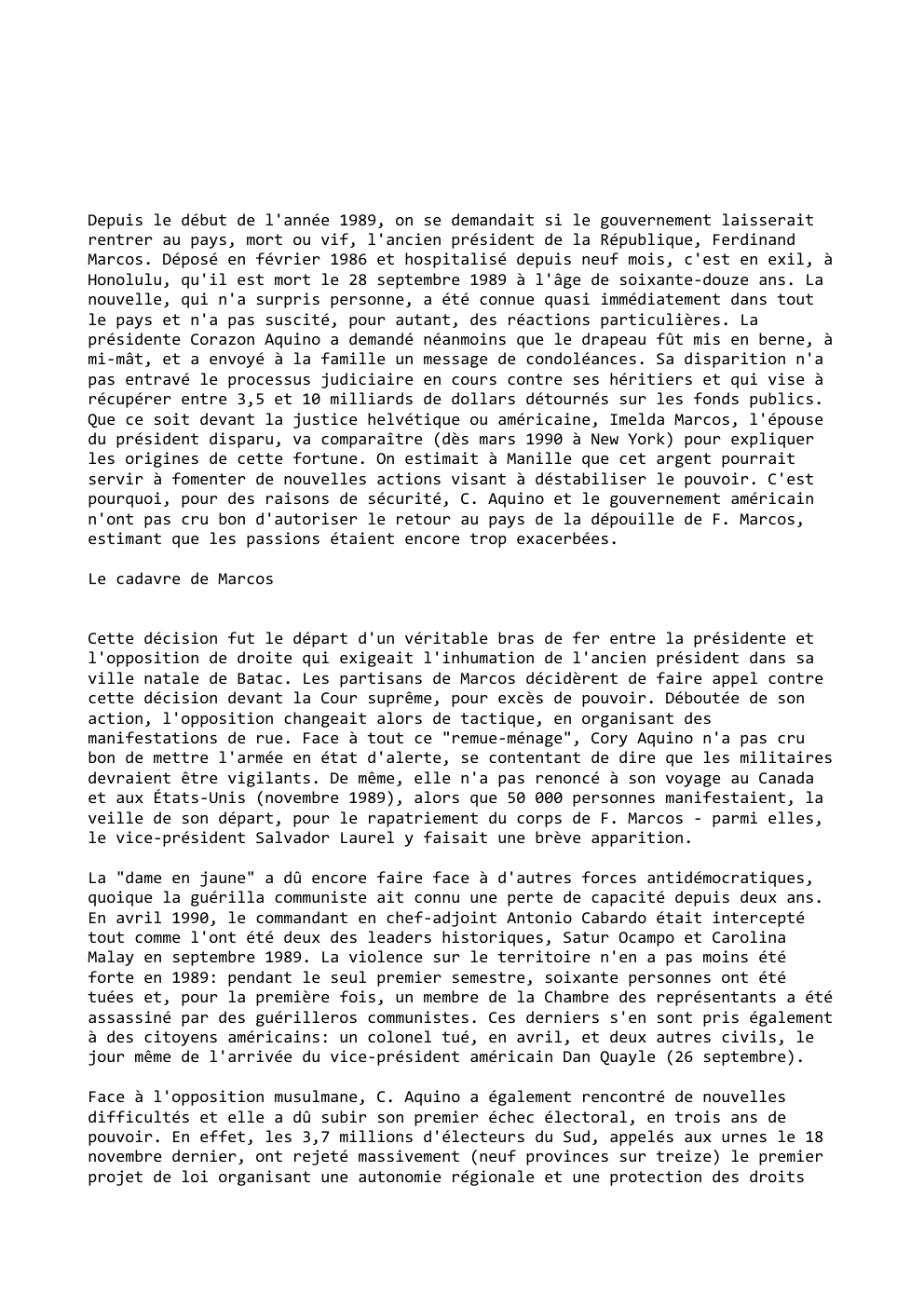Depuis le début de l'année 1989, on se demandait si le gouvernement laisserait rentrer au pays, mort ou vif, l'ancien...
Extrait du document
«
Depuis le début de l'année 1989, on se demandait si le gouvernement laisserait
rentrer au pays, mort ou vif, l'ancien président de la République, Ferdinand
Marcos.
Déposé en février 1986 et hospitalisé depuis neuf mois, c'est en exil, à
Honolulu, qu'il est mort le 28 septembre 1989 à l'âge de soixante-douze ans.
La
nouvelle, qui n'a surpris personne, a été connue quasi immédiatement dans tout
le pays et n'a pas suscité, pour autant, des réactions particulières.
La
présidente Corazon Aquino a demandé néanmoins que le drapeau fût mis en berne, à
mi-mât, et a envoyé à la famille un message de condoléances.
Sa disparition n'a
pas entravé le processus judiciaire en cours contre ses héritiers et qui vise à
récupérer entre 3,5 et 10 milliards de dollars détournés sur les fonds publics.
Que ce soit devant la justice helvétique ou américaine, Imelda Marcos, l'épouse
du président disparu, va comparaître (dès mars 1990 à New York) pour expliquer
les origines de cette fortune.
On estimait à Manille que cet argent pourrait
servir à fomenter de nouvelles actions visant à déstabiliser le pouvoir.
C'est
pourquoi, pour des raisons de sécurité, C.
Aquino et le gouvernement américain
n'ont pas cru bon d'autoriser le retour au pays de la dépouille de F.
Marcos,
estimant que les passions étaient encore trop exacerbées.
Le cadavre de Marcos
Cette décision fut le départ d'un véritable bras de fer entre la présidente et
l'opposition de droite qui exigeait l'inhumation de l'ancien président dans sa
ville natale de Batac.
Les partisans de Marcos décidèrent de faire appel contre
cette décision devant la Cour suprême, pour excès de pouvoir.
Déboutée de son
action, l'opposition changeait alors de tactique, en organisant des
manifestations de rue.
Face à tout ce "remue-ménage", Cory Aquino n'a pas cru
bon de mettre l'armée en état d'alerte, se contentant de dire que les militaires
devraient être vigilants.
De même, elle n'a pas renoncé à son voyage au Canada
et aux États-Unis (novembre 1989), alors que 50 000 personnes manifestaient, la
veille de son départ, pour le rapatriement du corps de F.
Marcos - parmi elles,
le vice-président Salvador Laurel y faisait une brève apparition.
La "dame en jaune" a dû encore faire face à d'autres forces antidémocratiques,
quoique la guérilla communiste ait connu une perte de capacité depuis deux ans.
En avril 1990, le commandant en chef-adjoint Antonio Cabardo était intercepté
tout comme l'ont été deux des leaders historiques, Satur Ocampo et Carolina
Malay en septembre 1989.
La violence sur le territoire n'en a pas moins été
forte en 1989: pendant le seul premier semestre, soixante personnes ont été
tuées et, pour la première fois, un membre de la Chambre des représentants a été
assassiné par des guérilleros communistes.
Ces derniers s'en sont pris également
à des citoyens américains: un colonel tué, en avril, et deux autres civils, le
jour même de l'arrivée du vice-président américain Dan Quayle (26 septembre).
Face à l'opposition musulmane, C.
Aquino a également rencontré de nouvelles
difficultés et elle a dû subir son premier échec électoral, en trois ans de
pouvoir.
En effet, les 3,7 millions d'électeurs du Sud, appelés aux urnes le 18
novembre dernier, ont rejeté massivement (neuf provinces sur treize) le premier
projet de loi organisant une autonomie régionale et une protection des droits
religieux et éducatifs des musulmans.
Crise gouvernementale aussi puisque, de
mars à juin 1989, quatre membres du Cabinet ont dû quitter leurs fonctions.
A
cela se sont ajoutées les difficultés rencontrées au Sénat: successivement, deux
ministres de la Réforme agraire, nommés par la présidente, n'ont pu être
confirmés par le pouvoir législatif et s'atteler à l'application de la loi de
1988 prévoyant une redistribution partielle des terres.
La question des bases américaines
Cette année 1989 aura encore montré toute la fragilité du pouvoir de C.
Aquino,
alors que devait s'entamer la phase délicate des négociations avec les
États-Unis pour le renouvellement, en septembre 1991, du bail de leurs bases
militaires.
La majorité des pays de la région souhaite un maintien de celles-ci,
mais il apparaît de plus en plus dans la classe politique philippine un
consensus pour leur démantèlement.
Dans l'entourage de la présidente, conscient
de leur rôle économique et des 68 000 emplois qu'elles représentent, on propose
d'étaler le repli américain sur neuf ans.
Même le Parti nationaliste de l'ancien
président Marcos a fini par demander leur fermeture et souhaiter l'abrogation
immédiate du traité de défense mutuel du 3 août 1951.
Chaque clan politique
s'est montré prêt à surenchérir face "aux impérialistes américains".....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓