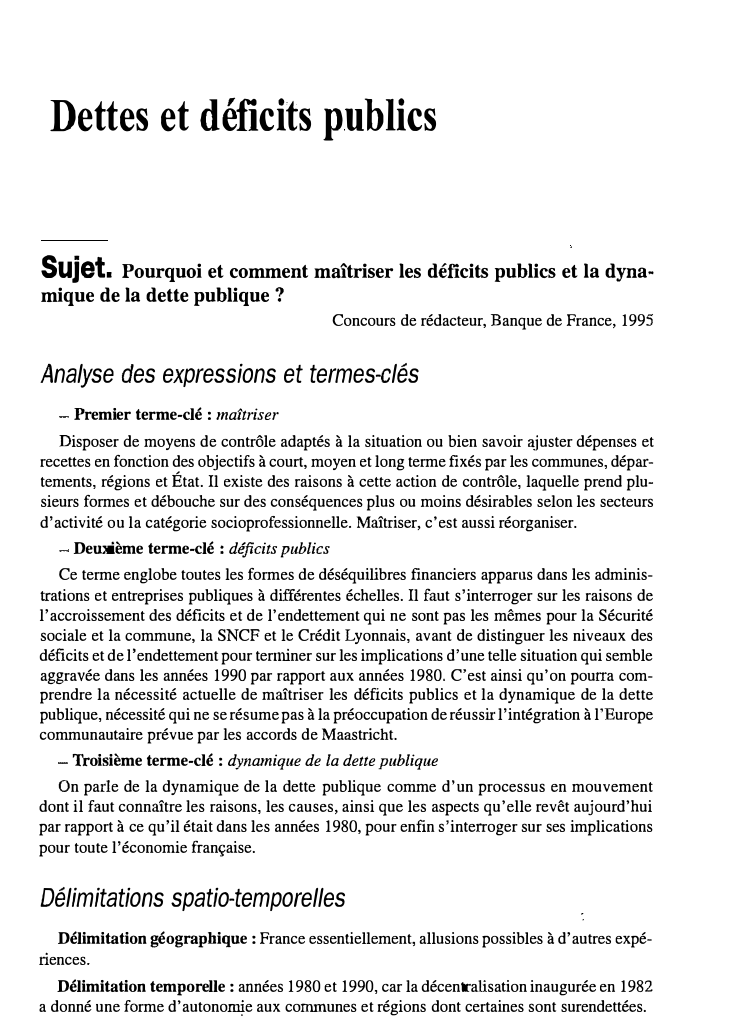Dettes et déficits publics Sujet. Pourquoi et comment maîtriser les déficits publics et la dyna mique de la dette publique...
Extrait du document
«
Dettes et déficits publics
Sujet.
Pourquoi et comment maîtriser les déficits publics et la dyna
mique de la dette publique ?
Concours de rédacteur, Banque de France, 1995
Analyse des expressions et termes-clés
Premier terme-clé: maitriser
Disposer de moyens de contrôle adaptés à la situation ou bien savoir ajuster dépenses et
recettes en fonction des objectifs à court, moyen et long terme fixés par les communes, dépar
tements, régions et État.
Il existe des raisons à cette action de contrôle, laquelle prend plu
sieurs formes et débouche sur des conséquences plus ou moins désirables selon les secteurs
d'activité ou la catégorie socioprofessionnelle.
Maîtriser, c'est aussi réorganiser.
Deuxième terme-clé : déficits publics
Ce terme englobe toutes les formes de déséquilibres financiers apparus dans les adminis
trations et entreprises publiques à différentes échelles.
Il faut s'interroger sur les raisons de
l'accroissement des déficits et de l'endettement qui ne sont pas les mêmes pour la Sécurité
sociale et la commune, la SNCF et le Crédit Lyonnais, avant de distinguer les niveaux des
déficits et de l' endettement pour terminer sur les implications d'une telle situation qui semble
aggravée dans les années 1990 par rapport aux années 1980.
C'est ainsi qu'on pourra com
prendre la nécessité actuelle de maîtriser les déficits publics et la dynamique de la dette
publique, nécessité qui ne se résume pas à la préoccupation de réussir l'intégration à l'Europe
communautaire prévue par les accords de Maastricht.
Troisième terme-clé: dynamique de la dette publique
On parle de la dynamique de la dette publique comme d'un processus en mouvement
dont il faut connaître les raisons, les causes, ainsi que les aspects qu'elle revêt aujourd'hui
par rapport à ce qu'il était dans les années 1980, pour enfin s'interroger sur ses implications
pour toute l'économie française.
Délimitations spatio-temporelles
Délimitation géographique: France essentiellement, allusions possibles à d'autres expé
riences.
Délimitation temporelle: années 1980 et 1990, car la décentralisation inaugurée en 1982
a donné une forme d'autononzj.e aux communes et régions dont certaines sont surendettées.
Problématique centrale et problématiques sous-jacentes
1.
La problématique centrale
Le problème principal se focalise sur la stratégie à mettre au point pour maîtriser l' accroissement des dettes et déficits publics après avoir bien mis en évidence les raisons d'une
telle évolution.
En effet, Ricardo (xrx•) et avant lui Melon (xvrll"), disaient qu'aucun déficit
n'est éternel, les générations suivantes paieront, d'où la nécessité chez les ménages d'épargner pour y faire face plus tard.
2.
Quatre problématiques sous-jacentes
Trouver une explication à« l'effet boule-de-neige» que représente aujourd'hui la dynamique de l'endettement publique.
Distinguer les formes de déficits publics et dettes publiques afin de montrer que les enjeux
ne sont pas les mêmes d'une institution à l'autre.
Montrer s'il y a une réelle volonté politique de s'attaquer à ce problème des finances
publiques, ce qui signifie en dernier ressort, s'interroger sur les nécessités de prélever tant
d'argent aux contribuables et de distribuer davantage à tous les secteurs et toutes les catégories socioprofessionnelles.
Discuter la nécessité de réagir contre la tendance inquiétante de la dette publique depuis
les années 1990.
Précautions dans le choix du plan directeur*
* Remarque.
La démonstration peut se faire avec l'une des trois logiques différentes (plans directeurs).
Avant d'opter pour l'une d'elles, une exploration rapide s'impose au candidat.
1.
Première possibilité : un plan directeur critique
Pour ce sujet, le plan critique consistera à exposer en première partie les raisons et les nécessités d'agir contre l'accroissement les déficits et les endettements publics, puis en seconde
partie montrer les limites conjoncturelles et structurelles à toute politique de redressement des
comptes des administrations et établissements publics.
2.
Deuxième possibilité : un plan directeur dialectique
Contrairement au précédent plan, celui-ci mettra l'accent sur le débat entre partisans du
soutien del' économie nationale par les pouvoirs publics, pour lesquels la maîtrise de la dynamique des déficits et des endettements publics ne devra pas remettre en cause certains droits
sociaux ou acquis des populations, et partisans d'un retour à l'État désengagé qui devra se
préoccuper très sérieusement du niveau des déséquilibres financiers.
Pour ces libéraux, la maîtrise des finances publiques signifie bien souvent des coupes sombres dans certains budgets.
Le candidat qui choisira ce plan devra connaître dans le détail les débats entre keynésiens et
monétaristes sur la question.
3.
Troisième possibilité : un plan directeur thématique
Tel que le sujet est formulé, le choix du plan thématique consiste à reprendre tout simplement les thèmes proposés explicitement.
La première partie sera consacrée aux raisons
de la maîtrise des déficits publics et la dynamique de la dette publique.
La seconde partie
exposera les manières possibles d'y parvenir en tenant compte, plus particulièrement, des
138
Quatre catégories de sujets - Seize plans détaillés
libertés étroites de manœuvres, qui s'offrent aujourd'hui à certaines institutions ou administrations plus ou moins connues du public pour leur déficit chronique ou leur endettement
excessif.
Les candidats qui choisiront ce plan, c'est-à-dire un grand nombre tentés par la
facilité, montreront à l'examinateur qu'ils n'ont aucune imagination en matière d'organisation des connaissances.
Mais d'un jury à l'autre cette «paresse» ne sera pas sanctionnée de
la même façon, certains ne diront absolument rien, tandis que d'autres pourront reprocher aux
candidats de choisir trop la facilité.
Officiellement, aucun jury ne sanctionne un candidat parce
qu'il a repris le plan suggéré dans l'énoncé, mais en pratique, le correcteur se lasse, au bout
de la dixième copie, en retrouvant toujours le même plan.
Le candidat doit faire preuve
d'audace dans l'organisation de ses arguments.
Le choix de la combinaison de plans
1.
Le plan directeur adopté: critique(/ & Il)
2.
Le premier plan de soutien: progressif (A & B)
3.
Le second plan de soutien : inventaire ( I à 5)
Indications utiles pour une introduction
La délimitation temporelle ne devra pas descendre au-dessous des années 1980, puisque le
sujet est centré sur le cas français.
En effet, la loi de.décentralisation de 1982 a donné beaucoup d'autonomie aux collectivités territoriales ; mais il y a aussi le développement des besoins
sociaux et collectifs, auxquels répondent les services publics, qui constitue le moteur de la
dynamique du déficit et de l'endettement public.
Le souci d'accorder plus de démocratie
aux citoyens par la décentralisation de la décision semble confronté à la nécessité de réformer le service public et de moderniser !'.État.
Cela passe donc obligatoirement par une réflexion
sur l'origine des déséquilibres et l'impératif de trouver une solution compatible avec le cadre
juridico-institutionnel, à moins que celui-ci ne soit lui-même une source de déséquilibre, et
dans ce cas, il fera partie intégrante de la recherche d'une solution.
Mais puisqu'il s'agit
d'un devoir d'économie politique, il faut donc éviter de faire des digressions sur le droit public
ce qui dénature l'harmonie générale de la copie.
Dès le premier paragraphe, le candidat exposera la problématique principale en la situant dans ce contexte typiquement français.
Dans
le second paragraphe qui commence par une phrase affirmative (cette phrase sert de lien entre
la problématique centrale et l'annonce du plan de travail), il est recommandé de formuler
autant de questions que de parties prévues dans le développement (un candidat moyen devra
opter pour la formule de l'introduction interrogative, voir l'exemple d'illustration dans le chapitre introductif de l'ouvrage).
Indications utiles pour le développement de la première partie
On ne peut répondre ni au « pourquoi » ni au « comment » ~aîtriser la dynamique de la
dette publique et du déficit sans avoir au préalable porté l'interrogation sur les sources objectives d'une dynamique qui s'est emballée dans les années 1980 et 1990.
Le candidat devra reconstituer le contexte général d'une stratégie de limitation d'une dérive
financière à tous les niveaux: entreprises publiques, communes, institutions d'État.
C'est ainsi
Sujets de première catégorie
139
que la première partie devra éclairer l'examinateur sur la perception théorique d'un déficit,
d'une impasse, d'une dette publique.
Les conceptions ne sont pas les mêmes d'une école de
pensée à une autre.
Si on est convaincu qu'un déficit est d'abord une avance faite à l'économie pour la relancer, on en déduira facilement que le déséquilibre dynamique des finances
publiques n'est pas en soi une preuve de l'échec d'une politique gouvernementale.
La discussion portera plutôt sur l'importance du déficit et de l'endettement, souvent par rapport à
des critères nationaux ou internationaux.
Même quand on est compréhensif à l'égard d'un
gouvernement qui intervient pour suppléer à une économie de marché en crise, à force de voir
changer constamment le niveau de la dette et du déficit, comparativement aux partenaires
du pays, on finit par discuter la nécessité d'imposer une limite au-delà de laquelle l'action
de l'État ne se justifie plus, faute de moyens financiers.
Dans cette première partie, le candidat devra s'interroger sur l'effet boule-de-neige des
finances publiques, après avoir constaté dans quelle circonstance la loi de Wagner a pu se
confirmer en même temps que l'extension de la bureaucratie.
En effet, il n'est point besoin
d'être expert pour remarquer combien fonctionne parfaitement aujourd'hui le principe des
vases communicants : l'alourdissement del' endettement public rejaillit d'une certaine manière
sur le déficit public.
Comme d'ailleurs il n'est point besoin d'être expert pour comprendre
comment le recours à l'endettement est devenu un moyen de différer la hausse des impôts,
surtout à l'approche d'échéances électorales importantes.
À ces phénomènes d'alourdissement des finances publiques s'ajoutent l'effet d'éviction et le monopole public ainsi que leurs
coûts pour les contribuables.
D'où la réaction indignée des....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓