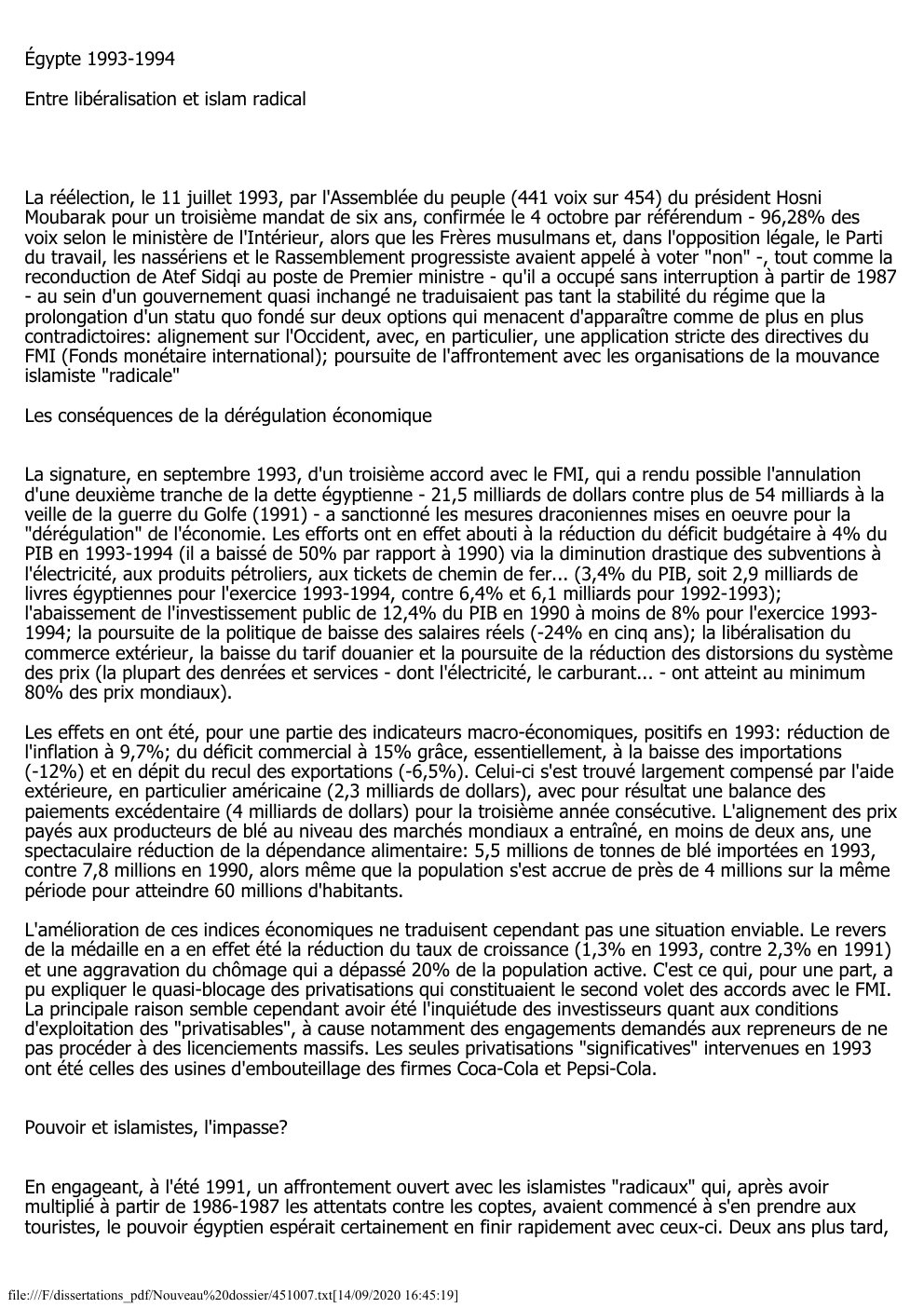Égypte 1993-1994 Entre libéralisation et islam radical La réélection, le 11 juillet 1993, par l'Assemblée du peuple (441 voix sur...
Extrait du document
«
Égypte 1993-1994
Entre libéralisation et islam radical
La réélection, le 11 juillet 1993, par l'Assemblée du peuple (441 voix sur 454) du président Hosni
Moubarak pour un troisième mandat de six ans, confirmée le 4 octobre par référendum - 96,28% des
voix selon le ministère de l'Intérieur, alors que les Frères musulmans et, dans l'opposition légale, le Parti
du travail, les nassériens et le Rassemblement progressiste avaient appelé à voter "non" -, tout comme la
reconduction de Atef Sidqi au poste de Premier ministre - qu'il a occupé sans interruption à partir de 1987
- au sein d'un gouvernement quasi inchangé ne traduisaient pas tant la stabilité du régime que la
prolongation d'un statu quo fondé sur deux options qui menacent d'apparaître comme de plus en plus
contradictoires: alignement sur l'Occident, avec, en particulier, une application stricte des directives du
FMI (Fonds monétaire international); poursuite de l'affrontement avec les organisations de la mouvance
islamiste "radicale"
Les conséquences de la dérégulation économique
La signature, en septembre 1993, d'un troisième accord avec le FMI, qui a rendu possible l'annulation
d'une deuxième tranche de la dette égyptienne - 21,5 milliards de dollars contre plus de 54 milliards à la
veille de la guerre du Golfe (1991) - a sanctionné les mesures draconiennes mises en oeuvre pour la
"dérégulation" de l'économie.
Les efforts ont en effet abouti à la réduction du déficit budgétaire à 4% du
PIB en 1993-1994 (il a baissé de 50% par rapport à 1990) via la diminution drastique des subventions à
l'électricité, aux produits pétroliers, aux tickets de chemin de fer...
(3,4% du PIB, soit 2,9 milliards de
livres égyptiennes pour l'exercice 1993-1994, contre 6,4% et 6,1 milliards pour 1992-1993);
l'abaissement de l'investissement public de 12,4% du PIB en 1990 à moins de 8% pour l'exercice 19931994; la poursuite de la politique de baisse des salaires réels (-24% en cinq ans); la libéralisation du
commerce extérieur, la baisse du tarif douanier et la poursuite de la réduction des distorsions du système
des prix (la plupart des denrées et services - dont l'électricité, le carburant...
- ont atteint au minimum
80% des prix mondiaux).
Les effets en ont été, pour une partie des indicateurs macro-économiques, positifs en 1993: réduction de
l'inflation à 9,7%; du déficit commercial à 15% grâce, essentiellement, à la baisse des importations
(-12%) et en dépit du recul des exportations (-6,5%).
Celui-ci s'est trouvé largement compensé par l'aide
extérieure, en particulier américaine (2,3 milliards de dollars), avec pour résultat une balance des
paiements excédentaire (4 milliards de dollars) pour la troisième année consécutive.
L'alignement des prix
payés aux producteurs de blé au niveau des marchés mondiaux a entraîné, en moins de deux ans, une
spectaculaire réduction de la dépendance alimentaire: 5,5 millions de tonnes de blé importées en 1993,
contre 7,8 millions en 1990, alors même que la population s'est accrue de près de 4 millions sur la même
période pour atteindre 60 millions d'habitants.
L'amélioration de ces indices économiques ne traduisent cependant pas une situation enviable.
Le revers
de la médaille en a en effet été la réduction du taux de croissance (1,3% en 1993, contre 2,3% en 1991)
et une aggravation du chômage qui a dépassé 20% de la population active.
C'est ce qui, pour une part, a
pu expliquer le quasi-blocage des privatisations qui constituaient le second volet des accords avec le FMI.
La principale raison semble cependant avoir été l'inquiétude des investisseurs quant aux conditions
d'exploitation des "privatisables", à cause notamment des engagements demandés aux repreneurs de ne
pas procéder à des licenciements massifs.
Les seules privatisations "significatives" intervenues en 1993
ont été celles des usines d'embouteillage des firmes Coca-Cola et Pepsi-Cola.
Pouvoir et islamistes, l'impasse?
En engageant, à l'été 1991, un affrontement ouvert avec les islamistes "radicaux" qui, après avoir
multiplié à partir de 1986-1987 les attentats contre les coptes, avaient commencé à s'en prendre aux
touristes, le pouvoir égyptien espérait certainement en finir rapidement avec ceux-ci.
Deux ans plus tard,
file:///F/dissertations_pdf/Nouveau%20dossier/451007.txt[14/09/2020 16:45:19]
le bras de fer prenait des proportions nettement plus considérables et aboutissait à vider le pays des
touristes qui avaient contribué, en 1991, à hauteur....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓