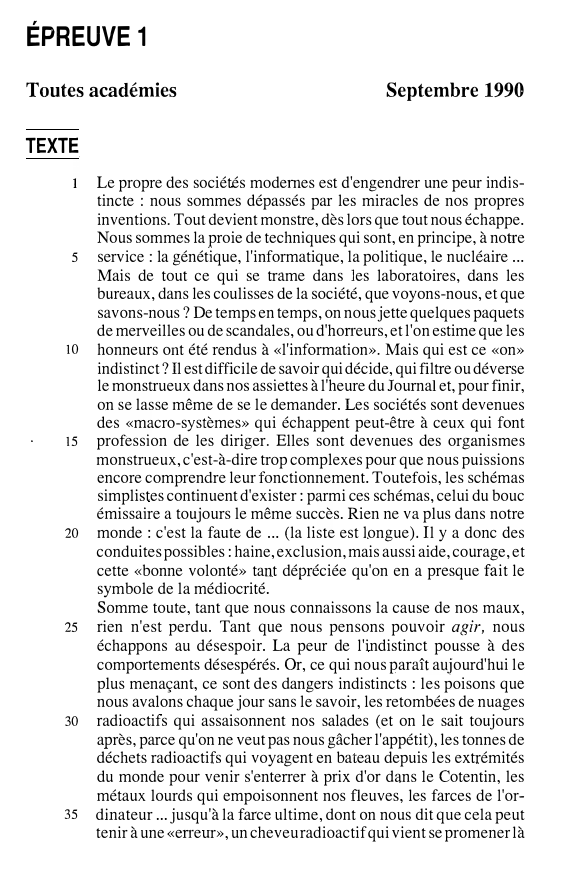ÉPREUVE 1 Toutes académies Septembre 1990 TEXTE 5 10 15 20 25 30 35 Le propre des sociétés modernes est...
Extrait du document
«
ÉPREUVE 1
Toutes académies
Septembre 1990
TEXTE
5
10
15
20
25
30
35
Le propre des sociétés modernes est d'engendrer une peur indis
tincte : nous sommes dépassés par les miracles de nos propres
inventions.
Tout devient monstre, dès lors que tout nous échappe.
Nous sommes la proie de techniques qui sont, en principe, à notre
service : la génétique, l'informatique, la politique, le nucléaire ...
Mais de tout ce qui se trame dans les laboratoires, dans les
bureaux, dans les coulisses de la société, que voyons-nous, et que
savons-nous? De temps en temps, on nous jette quelques paquets
de merveilles ou de scandales, ou d'horreurs, et l'on estime que les
honneurs ont été rendus à «l'information».
Mais qui est ce «on»
indistinct? Il est difficile de savoir qui décide, qui filtre ou déverse
le monstrueux dans nos assiettes à l'heure du Journal et, pour finir,
on se lasse même de se le demander.
Les sociétés sont devenues
des «macro-systèmes» qui échappent peut-être à ceux qui font
profession de les diriger.
Elles sont devenues des organismes
monstrueux, c'est-à-dire trop complexes pour que nous puissions
encore comprendre leur fonctionnement.
Toutefois, les schémas
simplistes continuent d'exister: parmi ces schémas, celui du bouc
émissaire a toujours le même succès.
Rien ne va plus dans notre
monde: c'est la faute de ...
(la liste est longue).
Il y a donc des
conduites possibles: haine, exclusion, mais aussi aide, courage, et
cette «bonne volonté» tant dépréciée qu'on en a presque fait le
symbole de la médiocrité.
Somme toute, tant que nous connaissons la cause de nos maux,
rien n'est perdu.
Tant que nous pensons pouvoir agir, nous
échappons au désespoir.
La peur de l'indistinct pousse à des
comportements désespérés.
Or, ce qui nous paraît aujourd'hui le
plus menaçant, ce sont des dangers indistincts : les poisons que
nous avalons chaque jour sans le savoir, les retombées de nuages
radioactifs qui assaisonnent nos salades (et on le sait toujours
après, parce qu'on ne veut pas nous gâcher l'appétit), les tonnes de
déchets radioactifs qui voyagent en bateau depuis les extrémités
du monde pour venir s'enterrer à prix d'or dans le Cotentin, les
métaux lourds qui empoisonnent nos fleuves, les farces de l'ordinateur ...
jusqu'à la farce ultime, dont on nous dit que cela peut
tenir à une «erreur», un cheveu radioactif qui vient se promener là
40
45
50
55
60
par hasard, qui «appuie sur le bouton» et hop ! volatilisée, la
termitière humaine !
Un jour, il s'est trouvé une chef d'État pour appeler au calme et dire
qu'il fallait se rassurer : c'est un homme qui appuie sur le bouton,
un seul, le chef.
Il était bon de le dire.
On se sent mieux depuis.
C'est vrai, les bombes ne partent pas toutes seules !
Mais on ne sait toujours pas comment les empêcher de partir ! On
ne sait pas, non plus, comment empêcher les centrales nucléaires
d'exploser.
Pour cela, il y a les ingénieurs, les spécialistes ...
Que
de pères bienveillants nous protègent ! Et pourtant, toutes les
rassurantes garanties ne nous empêchent pas de grelotter de peur.
Faire confiance à une catégorie supérieure d'humanité qui «sait»,
cela ne va pas sans risque, à supposer qu'on parvienne à cet acte
de foi.
Autrefois, l'Apocalypse était entre les mains de Dieu.
Il
avait le droit d'aITêter le jeu, car les hommes exagèrent (cela, ils
le savent).
Mais on pouvait espérer ...
«Prompt à l'amour et lent à
la colère» ...
Et puis, il y avait toujours un salut pour les justes
(chacun est sûr d'en être), il y avait donc une solution.
Maintenant
c'est plus grave.
D'abord, l'homme n'est pas indulgent.
Il est plutôt
prompt à la colère.
Pas très sage.
En plus de cela, ses machines ne
sont pas sûres.
Voilà pourquoi l'Apocalypse n'est plus un mythe.
Voilà pourquoi
on regrette les dragons, les sirènes, les hydres, les centaures...
Il y
avait toujours un héros pour en venir à bout et nous raconter, après,
de belles histoires.
Claude Kappler, Les Monstres modernes,
«Magazine littéraire», n° 232, juillet-août 1986.
Questions
1.
Résumé (8 points)
Vous résumerez ce texte en 170 mots.
Une marge de 10 % en plus ou en moins est admise.
Vous indiquerez, à la fin de votre résumé, le nombre de mots employés.
2.
Vocabulaire (2 points)
Vous expliquerez le sens, dans le texte, des deux expressions suivantes :
- « les schémas simplistes » (l.
17-18) ;
- « la termitière humaine » (l.
37-38).
3.
Discussion (10 points)
Pensez-vous que nous sommes «dépassés par le miracle de nos propres
inventions» ?
2.
VOCABULAIRE (2 points)
1.
«les schémas simplistes»
D'un terme grec signifiant «manière d'être», «figure», le mot schéma désigne
d'abord, dans le domaine concret, une représentation simplifiée et fonction
nelle («une figure schématique»), puis la représentation mentale d'un objet
ou d'un processus.
Qualifiés de simplistes, c'est-à-dire simplifiés à l'extrême par une vision trop
partielle des choses (c'est la nuance apportée au mot «simple» par le suffixe
-iste), ce sont des représentations mentales réductrices, ne rendant pas
compte de la réalité dans sa diversité, ni des causes dans leur variété.
Face
à la complexité du monde, les «schémas simplistes», sorte de «prêt-à-porter
de la pensée», font recette, car ils évitent à une société donnée une réflexion
plus poussée et éventuellement une remise en question.
2.
«la termitière humaine»
Cette métaphore désigne ici la terre habitée et aménagée par les hommes,
par référence au nid, impressionnant mais fragile, bâti par les termites.
Ces insectes ont depuis toujours suscité l'étonnement, à l'égal des fournis,
pour leur activité incessante et leur capacité à s'organiser au sein d'une sorte
de société hiérarchisée.
C'est donc une façon pour l'auteur de présenter les
hommes comme des créatures minuscules et besogneuses dont le nid (c'est
à-dire essentiellement les espaces urbanisés) peut être à tout instant anéanti
(par le cataclysme nucléaire).
3.
DISCUSSION (10 points)
Rappel du sujet : Pensez-vous que nous sommes «dépassés par le miracle
de nos propres inventions»?
PRÉLIMINAIRE
Le débat sur les inconvénients du progrès technique et scientifique est
devenu d'une telle banalité qu'il faut absolument donner du relief, de la
précision, de l'actualité à vos idées et vos exemples si vous voulez intéresser
et donc obtenir une note correcte.
Le danger est grand de s'en tenir à des
formules convenues et de sombrer dans la platitude !
Examinons soigneusement les termes du sujet : trois mots importants lui
donnent sa coloration : «dépassés», «miracle», «nos propres».
-«dépassés» conduira à mettre l'accent sur les conséquences inattendues,
sur notre irréflexion, notre manque de prévoyance.
-«miracle» insiste sur le côté prodigieux, incroyable de certaines inventions
et il conviendra de ne pas paraître trop blasés !
- quant à «nos propres», il souligne le côté paradoxal de la situation, nos
inventions se retournant contre nous-mêmes, thème bien connu de réflexions
sur la sottise humaine.
En résumé, l'examen attentif du sujet nous aiguille dans la direction bien
connue : le thème de «l'apprenti-sorcier» est sous-jacent, et ce ne sont pas
tant nos inventions «miraculeuses», mais l'utilisation excessive, inconsciente
ou franchement nocive qui en est faite qu'il faudra mettre en relief, en creusant
la notion contenue dans «dépassés" (dans quelle mesure et pourquoi cer
taines inventions nous «échappent», paraissent n'être plus «maîtrisées»?
dans quels domaines est-ce le plus frappant, le plus inquiétant ?, etc.).
Le texte vous aide de surcroît à repérer quelques grands domaines qu'il
faudra évoquer (énergie nucléaire, génétique, informatique ...
).
Introduction
Les risques multiples suscités par le progrès technologique dans nos sociétés
alimentent un débat majeur de notre temps.
Il est sans cesse ranimé par des
catastrophes ou par la découverte de nouveaux risques potentiels, de
nouveaux problèmes de politique ou d'éthique qui surgissent sans cesse.
Devant les déclarations parfois ambiguës ou contradictoires des scientifi
ques, l'homme de la rue ne sait plus très bien ce qu'il doit penser: ce progrès
tant vanté est-il maîtrisé ou sommes-nous des apprentis-sorciers qui seront
un jour stupidement responsables de leur propre perte ?
Dans un article du Magazine littéraire intitulé Les monstres modernes, Claude
Kappler revient sur ce thème en insistant sur tout ce qui peut faire craindre une
sorte de nouvelle Apocalypse.
Il souligne,quant à lui, «que nous sommes
dépassés par le miracle de nos propres inventions».
Passant en revue les domaines principaux où se dessinent les plus grands
risques, il conviendrait d'examiner ce qui peut donner l'impression d'un
manque de maîtrise de la part des hommes et donc susciter les plus grandes
inquiétudes, mais en même temps essayer de discerner si nous sommes tout
à fait démunis en face des risques liés au progrès.
Première partie : faire la part de l'exploitation médiatique
et ne pas oublier le facteur humain
Évoquons tout d'abord les accidents ou incidents divers qui surviennent à la
surface de la planète, qui occupent la une des journaux et frappent d'autant
plus l'imagination que les inventions merveilleuses dont nous disposons
accroissent à chaque fois l'ampleur des catastrophes en termes de risques
écologiques et de nombre de victimes.
Il faut à leur sujet faire la part de l'exploitation médiatique : plus rien ne peut
se passer sans que nous en soyons informés.
Il y a même des modes, des
choix journalistiques qui conduisent à amplifier telle série de faits ; ce sera
tantôt les risques liés à la circulation, tantôt....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓