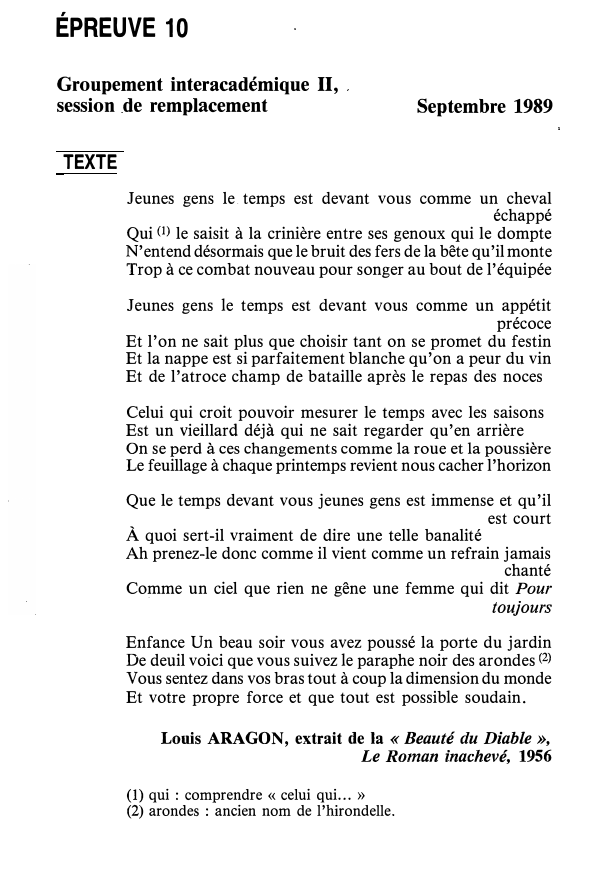ÉPREUVE 10 Groupement interacadémique II, session de remplacement Septembre 1989 TEXTE Jeunes gens le. temps est devant vous comme un...
Extrait du document
«
ÉPREUVE 10
Groupement interacadémique II,
session de remplacement
Septembre 1989
TEXTE
Jeunes gens le.
temps est devant vous comme un cheval
échappé
Qui OJ le saisit à la crinière entre ses genoux qui le dompte
N'entend désormais que le bruit des fers de la bête qu'il monte
Trop à ce combat nouveau pour songer au bout de l'équipée
Jeunes gens le temps est devant vous comme un appétit
précoce
Et l'on ne sait plus que choisir tant on se promet du festin
Et la nappe est si parfaitement blanche qu'on a peur du vin
Et de l'atroce champ de bataille après le repas des noces
Celui qui croit pouvoir mesurer le temps avec les saisons
Est un vieillard déjà qui ne sait regarder qu'en arrière
On se perd à ces changements comme la roue et la poussière
Le feuillage à chaque printemps revient nous cacher l'horizon
Que le temps devant vous jeunes gens est immense et qu'il
est court
À quoi sert-il vraiment de dire une telle banalité
Ah prenez-le donc comme il vient comme un refrain jamais
chanté
Comme
un ciel que rien ne gêne une femme qui dit Pour
·
toujours
Enfance Un beau soir vous avez poussé la porte du jardin
De deuil voici que vous suivez le paraphe noir des arondes (ZJ
Vous sentez dans vos bras tout à coup la dimension du monde
Et votre propre force et que tout est possible soudain.
Louis ARAGON, extrait de la « Beauté du Diable»,
Le Roman inachevé, 1956
qui : comprendre « celui qui...
»
(2) arondes : ancien nom de l'hirondelle.
(1)
Vous ferez de ce texte un commentaire composé excluant l'étude jux
talinéaire.
Vous pourriez montrer, par exemple, comment le rythme,
la composition, les images, les sonorités rendent compte d'un retour
cyclique du temps et renouvellent le thème traditionnel de la jeunesse.
■
Colette (Épreuve 8) parlait de son enfance.
Aragon ici chante l'adoles
cence.
Texte optimiste aussi, mais moins naturel que celui de Colette.
On
sait la volonté de prosélytisme d'Aragon, fervent communiste, et qui juste
après guerre veut entraîner une jeunesse constructive.
■
Ne pas se laisser inquiéter par l'absence complète de ponctuation, trace
du surréalisme originel d'Aragon.
Il faut lire très attentivement, et l'on
retrouve soi-même assez facilement la place des virgules et points.
Introduction
En 1956, Aragon a depuis quelques décennies dépassé sa période surréa
liste.
Sous l'influence de sa femme, la romancière russe Elsa Triolet, il est
devenu un écrivain engagé.
Il a été résistant et se révèle comme le chantre
du communisme.
En 1956, date de la parution du Roman inachevé, le poète
s'attache à une facture plus traditionnelle qu'à ses débuts.
Ainsi, dans un extrait de La Beauté du Diable.
Certes, ce sont encore des
vers libres ici, plus longs que l'alexandrin, non ponctués.
Mais la composi
tion est de quatrains.
Les intentions et les images qui les rendent se tradi
tionnalisent aussi - si l'on ose écrire ainsi -.
Il n'en est plus à la« dictée
de l'inconscient» surréaliste pour exprimer cette originale présentation du
temps à une jeunesse qu'il veut galvaniser.
Aussi étudiera-t-on d'abord cette expression du temps : il passe, certes,
mais loin d'en dégager une inquiétude existentielle, Aragon insiste sur le
CONNAISSANCES LITTÉRAIRES
• Louis Aragon (1897-1982), passionné toute sa vie, et depuis sa plus
petite enfance, de littérature, fonde en 1919 avec A.
Breton et Ph.
Sou
pault la revue littéraire Littérature et se consacre désormais à toutes
les formes d'écriture: essayiste, romancier, poète, historien (du mou
vement communiste, auquel il adhère dès 1927 et jusqu'à sa mort).
Après
avoir été dadaiste et surréaliste, il rencontre et épouse !'écrivain russe
Elsa Triolet (1896-1970) à laquelle il dédiera une grande partie de son
œuvre, soit de résistant : Le Crève-cœur (1941), soit de grand poète
populaire: La Diane française (1946), soit d'amour: Cantique à Elsa
(1942) ; Les Yeux d'Elsa (1942) ; Elsa (1959) ; Le Fou d'Elsa (1963).
Citons aussi certains de ses romans comme Aurélien (1945) ou Les
Beaux Quartiers (1936).
retour assuré des cycles, donc sur une notion de " Pour toujours ».
Puis
le commentaire pourrait se porter sur le tableau de la jeunesse présenté
par Aragon dans ces cinq quatrains, son analyse et son désir d'une ardeur
et d'une vitalité qui caractérisent cet âge.
Première partie : le temps
On a l'habitude dans les textes lyriques de voir traiter le thème de la fuite
du temps, allié à l'irrémédiable conduite vers la mort de la condition humaine.
« Le temps s'en va, le temps s'en va, ma dame ;/Las! le temps, non, mais
nous nous en allons,/Et tôt serons étendus sous la lame» Ronsard dans
ce mélancolique sonnet fait bien remarquer que ce n'est pas le temps mais
nous-mêmes qui fuyons vers la fin; le temps est quand même presque tou
jours pris comme symbole de cette fuite, de cet écoulement, comme çelui
de l'eau de la Seine sous Le Pont Mirabeau (Apollinaire).
Or la manière d'utiliser le symbole du temps est tout à fait différente dans
ce texte d'Aragon.
Le temps devient un entraîneur.
Il est guide, aide, maî
tre mais surtout il ouvre les voies, comme le ferait un bon génie.
Sa première caractéristique est montrée par l'anaphore « le temps est devant
vous».
«Devant» c'est le futur, l'espoir - rien n'étant encore atteint - ,
le besoin et le désir de construire, de faire quelque chose.
Le temps est
donc vitesse, ardeur un peu folle à vaincre; l'élément: « qui le dompte»
- c'est-à-dire « celui qui le dompte» - , en contre-rejet, lance le vers sui
vant avec un élan que plus rien n'arrête : « ...
qui le dompte
N'entend désormais que le bruit des fers de fa bête qu'il monte»
L'accumulation des explosives: dentales (d, t), labiales (b) et surtout gut
turales (qu, qu) imite le bruit du galop « échappé ».
C'est le temps qui entraîne ce mouvement, qui le motive et y aide.
Le temps demande donc d'aller de l'avant, de risquer, de prendre des déci
sions rapides, de saisir l'occasion vite, sans atermoiement.
Il empêche une
réflexion repliée sur elle-même qui « croit pouvoir fie] mesurer» et s'y perd.
Le temps ne permet pas l'arrêt et rejette le passé, celui que l'on « regarde
[.
..] en arrière».
Il faut donc en jouir, le goûter, mais plus encore avant que pendant ou après.
Avant, tout est beau, comme une « nappe[.
..
] parfaitement blanche», car
rien n'a souillé les espoirs misés sur le temps.
Quand tout est passé, l'image
restante peut être un" atroce champ de bataille » où tout ce qui a servi git
sur « fa nappe» souillée « du vin» des orgies.
Le temps doit être vu en dévo
rateur, image classique certes, celle de Saturne, le dieu antique du temps
qui dévorait ses enfants à la naissance.
Mais cette présentation chez Ara
gon n'est pas péjorative.
Il faut prendre le temps « comme il vient», donc
en jouir sans s'apesantir sur ce qu'il deviendra, penser que le temps est
tout entier pour chacun d'entre nous, « comme un refrain jamais chanté».
Ainsi, bien que l'éphémérité soit une caractéristique du temps, complément
de son mouvement rapide et entraînant, s'il « est court», il est aussi
«immense».
Il est l'inconnu, la vision d'horizon, c'est ce que traduit cet
adjectif prolongé par les sonorités nasales; peut-être l'est-il tant parce qu'il
revient sans cesse, comme l'indique l'image de « fa roue» et le rappel de
ses « changements», donc du cycle des saisons.
Il devient donc pour Aragon essentiellement présent et futur; futur surtout.
Le passé est gommé, le temps ne s'y arrête pas et ne veut pas le voir.
Il
s'emporte toujours vers l'avant, sans entraves:« comme un ciel que rien
ne gêne», et Aragon, parmi les adverbes de temps, ne veut retenir que celui
qui réclame l'assurance de l'éternité: «toujours».
Est-ce reste de surréalisme, dont une des réclamations était que l'on se
laisse aller à la dictée des images, d'associations en associations? En tout
cas Aragon présente le temps en une succesion imagée: la course en avant,
c'est le« cheval» au galop.
Peut-être reprend-il la parabole du cheval de
!'Apocalypse, mais avec une intention inverse, car ici il présente le cheval
- temps dompté par les jeunes gens; - puis c'est l'image du« festin»
en un double tableau: la table préparée avant, toute soignée; celle qui sup
porte les reliefs du repas et les dégâts de la fête, mais à laquelle il ne faut
pas s'attarder, ...
après.
Autre image représentative du temps, l'amour.
Pour ce grand amoureux
que fut Aragon, qui chanta toute sa vie sa femme Elsa dans mille poèmes,
l'amour comme le temps est frappé de dualité: il est« immense» et«court»,
court comme la vie.
Mais« immense» l'emporte avec ses nuances: uni
que, absolu, éternel:« refrain jamais chanté » à d'autres, donc unique;« ciel
que rien ne gêne » donc absolu dans sa pureté; disant « Pour toujours»
par la bouche de la femme aimée, donc éternel, surtout qu'il revient sans
cesse en sa « roue» cyclique.
Seconde partie : la jeunesse
Cependant cette peinture du temps n'est pas vraiment faite pour elle-même,
elle est faite pour les« Jeunes gens», auxquels le poète s'adresse dès le
premier vers.
En leur présentant toutes ces qualités du temps, il les adjure
en réalité de les saisir et de les faire leurs.
L'apostrophe répétée au pre
mier et deuxième quatrain est un appel.
S'il leur montre ce mouvement
ardent du« cheval échappé» c'est pour qu'ils puissent le« saisir» au vol.
L'image est celle de ces cavaliers sauvages et vibrants qui se lancent dans
les steppes« à la crinière» de chevaux sauvages ou difficiles et qu'ils se
font une joie....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓