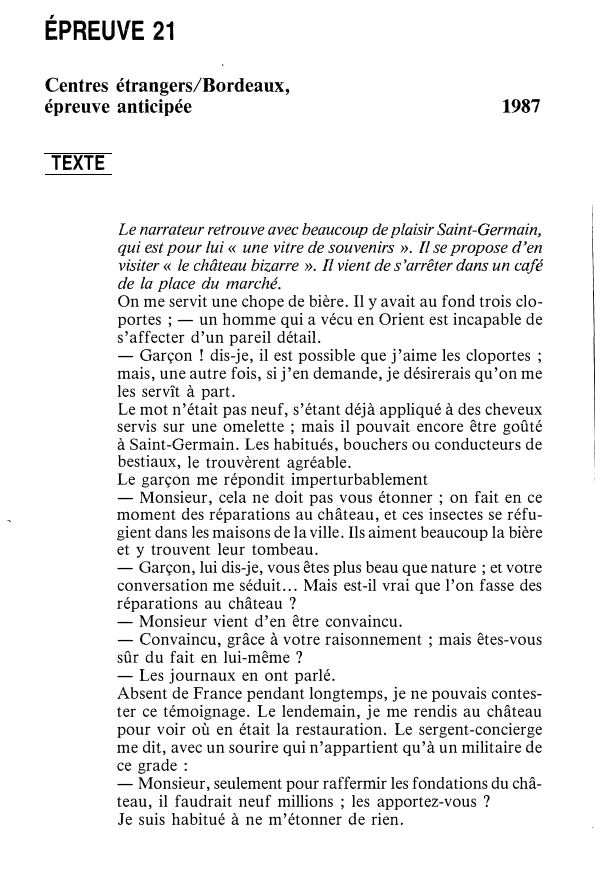ÉPREUVE 21 Centres étrangers/Bordeaux, épreuve anticipée 1987 TEXTE Le narrateur retrouve avec beaucoup de plaisir Saint-Germain, qui est pour lui«...
Extrait du document
«
ÉPREUVE 21
Centres étrangers/Bordeaux,
épreuve anticipée
1987
TEXTE
Le narrateur retrouve avec beaucoup de plaisir Saint-Germain,
qui est pour lui« une vitre de souvenirs ».
Il se propose d'en
visiter« le château bizarre ».
Il vient de s'arrêter dans un café
de la place du marché.
On me servit une chope de bière.
Il y avait au fond trois clo
portes ; - un homme qui a vécu en Orient est incapable de
s'affecter d'un pareil détaiL
- Garçon ! dis-je, il est possible que j'aime les cloportes ;
mais, une autre fois, si j'en demande, je désirerais qu'on me
les servît à part.
Le mot n'était pas neuf, s'étant déjà appliqué à des cheveux
servis sur une omelette ; mais il pouvait encore être goüté
à Saint-Germain.
Les habitués, bouchers ou conducteurs de
bestiaux, le trouvèrent agrfoble.
Le garçon me répondit imperturbablement
- Ivlonsieur, cela ne doit pas vous étonner ; on fait en ce
moment des réparations au château, et ces insectes se réfu
gient dans les maisons de la ville.
Ils aiment beaucoup la bière
et y trouvent leur tombeau.
- Garçon, lui dis-je, vous êtes plus beau que nature ; et votre
conversation me séduit...
Mais est-il vrai que l'on fasse des
réparations au château ?
- Monsieur vient d'en être convaincu.
- Convaincu, grâce à votre raisonnement ; mais êtes-vous
sür du fait en lui-même ?
- Les journaux en ont parlé.
Absent de France pendant longtemps, je ne pouvais contes
ter ce témoignage.
Le lendemain, je me rendis au château
pour voir où en était la restauration.
Le sergent-concierge
me dit, avec un sourire qui n'appartient qu'à un militaire de
ce grade:
- Monsieur, seulement pour raffermir les fondations du châ
teau, il faudrait neuf millions ; les apportez-vous ?
Je suis habitué à ne m'étonner de rien.
- Je ne les ai pas sur moi, observai-je ; mais cela pourrait
encore se trouver !
- Eh bien, dit-il, quand vous les apporterez, nous vous
ferons voir le château.
Gérard de Nerval, (1808-1855), « Le château de
Saint-Germain», Promenades et souvenirs, 1854-1855
Vous ferez de ce texte un commentaire composé.
Vous pourrez, par
exemple, en étudiant le caractère théâtral de la narration, vous inter
roger sur la drôlerie de l'anecdote et sur l'image que donne de lui-même
G.
de Nerval.
■ Texte humoristique, presque sans cesse en style direct, donc très agréable
à lire.
On pourra constituer deux thèmes avec ces éléments : théâtre ;
comique.
Cependant, pour qui connaît un peu G.
de Nerval, il peut y avoir surprise.
On ne s'attend ni à cette structure ni à ce ton chez l'auteur de Fantaisie
ou de El Desdichado.
Il faudra donc aborder ce phénomène nouveau et
réfléchir sur« l'image que donne de lui-même G.
de Nerval».
Les indica
tions du libellé le suggèrent d'ailleurs.
■
Devoir rédigé
C'est au x1x• siècle, au moment où le romantisme est en plein essor
que Gérard de Nerval, auteur de récits subtils et originaux, laisse paraître
dans les œuvres susdites une délicate sensibilité.
Citons particulièrement
à ce propos Les Filles du Feu.
D'autre part sa poésie si musicale, si« sur
réelle », selon son expression, si elle ne fut pas immédiatement perçue à
sa juste valeur - ne le traita-t-on pas de « romantique mineur » ! - eut une
influence posthume considérable.
C'est pour luifaire honneur que le mou
vement surréaliste se dota de ce nom - surréel - surréalisme -, ses poé
sies, Les Chimères, ouvrant la voie aux recherches futures dans le domaine
du rêve.
Mais Nerval est fort malade à la fin de sa vie, et dans les intervalles
de séjours en maison de santé, il s'attache au Réel et le conte dans des
anecdotes réunies dans le recueil Promenades et Souvenirs, ici années ·
1854-1855.
Cette page en est un extrait ; présentée en une petite pièce
comique en deux scènes, elle est fort éloignée de l'habitue/le immatérialité
nervalienne.
Nous pourrions y étudier d'abord le caractère théâtral de la présenta
tion narrative.
Celui-ci souligne la drôlerie de l'anecdote contée, dont
l'analyse constituerait un second thème.
Enfin on tenterait de cerner l'image
que donne de lui-même Gérard de Nerval, si surprenante pour qui ne le
connaît que superficiellement.
ÉPREUVE 21
Ce qui frappe d'abord, c'est que plutôt qu'une narration - quelques
lignes seulement sont de récit - nous avons ici des dialogues et un mouvement théâtral.
En effet la page repose sur deux scènes présentées en
« coups de théâtre » : la découverte des cloportes, puis la demande des
millions.
De même l'action se déroule sur deux décors : un café de SaintGermain ; l'entrée du château.
Le dialogue plus encore est essentiel, toujours établi entre Gérard et une autre personne, un de ces êtres ordinairement secondaires, nommés au théâtre des « utilités " : un garçon de café,
puis un « sergent-concierge », donc de ces personnages qui constituent à
la scène des« rôles de composition».
Toutes ces indications sont des détails
de caractère théâtral, d'autant plus qu'ils s'appuient sur dialogues et changements de décors, avec attitudes, mouvements, volte-face.
Pas de description en réalité.
Aucun point n'est apporté pour nous permettre de parler de la physionomie ou de l'aspect moral de tel ou tel personnage.
C'est ainsi qu'il en est au théâtre, car l'auteur se glisse dans le
rôle ; qui saurait dire si Andromaque est blonde ou a des yeux bleus ? Les
indications sont seulement suggestives, glissées dans une réplique P,ar
exemple, comme« garçon, lui dis-je, vous êtes plus beau que nature».
Evidemment « beau » est à double entente, plus ironique que descriptif; mais
au théâtre, le public établirait directement ce double sens par comparaison visuelle avec le physique de l'acteur porteur du rôle.
D'ailleurs, le public est sous-entendu; il peut être rattaché à ce que
Nerval présente sous le terme « habitués »,précisant« bouchers ou conducteurs», qui assistent à la scène; mais, ambiguilé: sont-ils présents au café
ou à la pièce ? La langue d'autre part est tout à fait théâtrale.
Les répliques
sont très brèves.
Il s'agit d'un rythme rapide, sans le moindre temps mort,
comme l'exige le mouvement scénique.
Les phrases sont courtes, expressives, comme dans tout bon dialogue théâtral.
Leur contenu est soutenu
d'une pointe d'humour, ce qui frappe plus vite le spectateur éventuel.
Certes le garçon de café utilise un langage relativement plus châtié qu'on ne
l'attendrait de sa position sociale.
Il ne s'agit nullement de ces paroles un
peu frustes - ou brusques - attribuées généralement aux garçons de
café ; il est extrêmement poli, trop même ; or c'est pour mieux faire passer
l'étonnante découverte des cloportes.
Car tout contribue à mettre en valeur la drôlerie de cette première anecdote ; l'élément comique est créé par l'effet de surprise et ceci d'autant
mieux que le comique est accentué au fur et à mesure par d'autres effets
propres à provoquer le rire.
Dès le début du texte, ce comique est basé sur la présence de trois
cloportes dans une chope de bière.
Ce n'est pas drôle en soi, mais ce qui
l'est c'est la manière dont se passe la découverte et la façon inattendue
dont réagit le garçon.
Le désir de rire se trouve doublé par fa réplique du
narrateur, dégagée en pince-sans-rire : « un homme qui a vécu en Orient
est incapable de s'affecter d'un pareil détail».
C'est une forme de détachement qui accentue l'énormité du fait: n'importe quelle personne sensée ne prendrait pas la présence de ces bestioles dans son propre verre
pour un vulgaire détail.
Ironie donc.
D'ailleurs un procédé de répétition prolonge le rire ; c'est la seconde réplique du narrateur: « il est possible que
j'aime les cloportes : mais une autre fois, si j'en demande, je désirerais qu'on
me les servît à part.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓