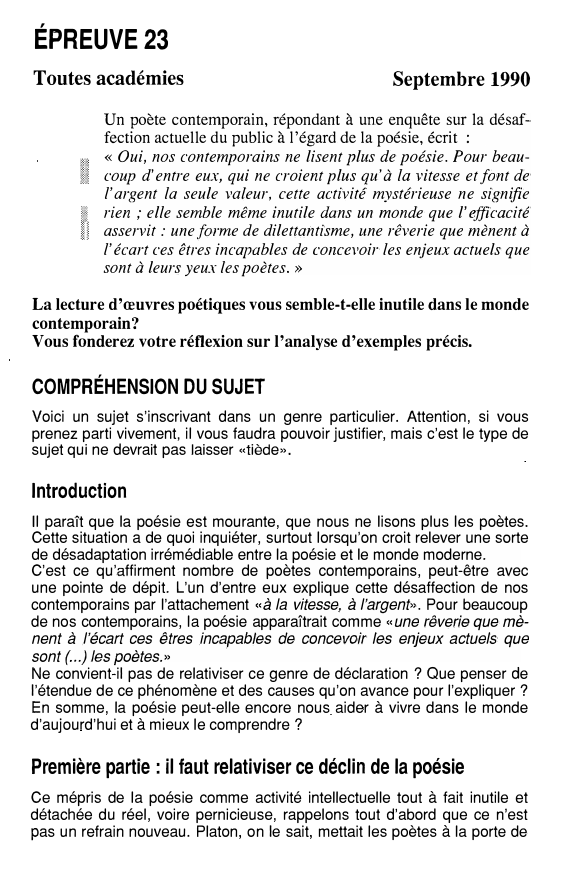ÉPREUVE 23 Toutes académies ii J �1 Septembre 1990 Un poète contemporain, répondant à une enquête sur la désaf fection...
Extrait du document
«
ÉPREUVE 23
Toutes académies
ii
J
�1
Septembre 1990
Un poète contemporain, répondant à une enquête sur la désaf
fection actuelle du public à l'égard de la poésie, écrit :
« Oui, nos contemporains ne lisent plus de poésie.
Pour beau
coup d'entre eux, qui ne croient plus qu'à la vitesse et font de
l'argent la seule valeur, cette activité mystérieuse ne signifie
rien ; elle semble même inutile clans un monde que l' efficacité
asservit: une forme de dilettantisme, une rêverie que mènent à
l'écart ces êtres incapables de concevoir les enjeux actuels que
sont à leurs yeux les poètes.
»
La lecture d'œuvres poétiques vous semble-t-elle inutile dans le monde
contemporain?
Vous fonderez votre réflexion sur l'analyse d'exemples précis.
COMPRÉHENSION DU SUJET
Voici un sujet s'inscrivant dans un genre particulier.
Attention, si vous
prenez parti vivement, il vous faudra pouvoir justifier, mais c'est le type de
sujet qui ne devrait pas laisser «tiède».
Introduction
Il paraît que la poésie est mourante, que nous ne lisons plus les poètes.
Cette situation a de quoi inquiéter, surtout lorsqu'on croit relever une sorte
de désadaptation irrémédiable entre la poésie et le monde moderne.
C'est ce qu'affirment nombre de poètes contemporains, peut-être avec
une pointe de dépit.
L'un d'entre eux explique cette désaffection de nos
contemporains par l'attachement «à la vitesse, à l'argent».
Pour beaucoup
de nos contemporains, la poésie apparaîtrait comme «une rêverie que mè
nent à l'écart ces êtres incapables de concevoir les enjeux actuels que
sont(...) les poètes.
»
Ne convient-il pas de relativiser ce genre de déclaration ? Que penser de
l'étendue de ce phénomène et des causes qu'on avance pour l'expliquer ?
En somme, la poésie peut-elle encore nous aider à vivre dans le monde
d'aujourd'hui et à mieux le comprendre ?
Première partie : il faut relativiser ce déclin de la poésie
Ce mépris de la poésie comme activité intellectuelle tout à fait inutile et
détachée du réel, voire pernicieuse, rappelons tout d'abord que ce n'est
pas un refrain nouveau.
Platon, on le sait, mettait les poètes à la porte de
sa République comme des créateurs de fantômes, d'illusions nuisibles aux
vertus sociales.
On connaît le mot de Malherbe : «un bon poète n'est pas
plus utile à l'État qu'un bon joueur de quilles» (simple boutade d'ailleurs,
démentie par des affirmations plus orgueilleuses).
En un siècle épris de
raison par goût et par nécessité, Montesquieu, dans les Lettres persanes,
fait dire à Rica : «les poètes, c'est-à-dire ces auteurs dont le métier est de
mettre des entraves au bon sens et d'accabler la raison sous les agré
ments comme on ensevelissait autrefois les femmes sous leurs ornements
et leurs parures".
Et c'est un fait que les poètes sont étrangement absents
du xv111• siècle.
Au x1x•, ce divorce entre le poète et une société marchande où le profit, la
rentabilité règnent sans partage et qui relègue précisément le poète à une
place subalterne, est exprimé de la façon la plus nette qui soit dans le
Chatterton de Vigny, le Lord maire de Londres s'exclamant: «Vous n'avez
rien pu faire que vos maudits vers et à quoi sont-ils bons, je vous prie ?»
Verlaine aussi rend coup pour coup, lorsqu'il évoque M.
Prudhomme :
« Quant aux faiseurs de vers, ces vauriens, ces maroufles,
Ces fainéants barbus, mal peignés, il les a
Plus en horreur que son éternel coryza....
»
Il faut dire que dans le même temps les outrances romantiques sur le
thème de l'artiste toisant le vulgaire de toute la hauteur de son génie, du
mage directement inspiré par Dieu...
en agaçaient plus d'un.
Dans notre siècle même, chaque grand poète, surtout officiel, surtout com
blé, y est allé de son couplet sur le déclin de la poésie dans une société
technicienne préoccupée de rendement.
C'est Valéry écrivant en 1937 :
« On peut douter si nos petits-fils trouveront la moindre faveurs aux grâces
surannées de nos poètes les plus extraordinaires et de toute poésie en
général.
» C'est Saint-John Perse déclarant dans son allocution devant le
jury du Nobel en 1960 : «La poésie n'est pas souvent à l'honneur.
C'est
que la dissociation semble s'accroître entre l'œuvre poétique et l'activité
d'une société soumise aux servitudes matérielles.»
Ajoutons que les poètes sont en partie responsables du discrédit dans
lequel la poésie est, selon eux, tombée.Trop souvent, il leur est arrivé de
se fourvoyer dans des jeux savants de ruelle ou d'alcôve ; de s'adonner
au maniérisme ; de se réfugier dans l'hermétisme, compris et apprécié des
seuls amateurs éclairés ; de cultiver une image trop solitaire et dédai
gneuse du poète (Vigny), ou trop ambitieuse (Hugo).
Il ne faut pas s'éton
ner que le public se soit parfois lassé.
A contrario, des poètes plus populaires, comme Éluard et Aragon, pendant
comme après la guerre de 39-45, ont su reconquérir une large audience
avec les mots de tous les jours.
L'exemple le plus frappant est celui de
Prévert dont le recueil Paroles en format de poche est l'un des best-sellers
des dernières années ; mais il est vrai que, malgré Saint-John Perse,
Supervielle, René Char, Francis Ponge, Yves Bonnefoy, Guillevic et tant
d'autres, le grand public semble ne plus montrer pour la poésie un en
gouement très vif.
Ne nous laissons pas cependant abuser par une autre erreur d'optique :
la poésie par sa nature même restera toujours quelque peu confidentielle.
Elle est publiée par de petites maisons d'édition, par des centaines de
revues à tirage limité.
Elle ne peut prétendre au succès de librairie des
romans ou des essais, tout en étant assurée de passer de mains en
mains, d'être récitée et appréciée ne serait-ce que grâce à l'école.
Voilà
qui semble tout de même de nature à tempérer l'amertume de tous ceux
qui crient peut-être trop vite à une désaffection nouvelle et injuste vis-à-vis
de la poésie ces dernières années.
D'autre part, les raisons avancées pour expliquer ce déclin ne sont peut
être pas les bonnes.
En fait, la poésie, sous sa forme traditionnelle, est
victime d'un double mouvement.
Elle a quitté l'univers clos du poème pour se glisser partout, sur les ailes
de la musique et dans les paroles des chansons les plus humbles, même
si cela fait grincer des dents les puristes.
Des chanteurs comme Brassens,
Brel, Ferré, Ferrat et aussi Yves Montand, Barbara et tant d'autres, autant
comme paroliers que comme interprètes, l'ont grandement popularisée.
Refusera-t-on de considérer Charles Trenet comme un véritable poète, et
est-ce là une défaite ou une victoire de la poésie ?
D'autre part, le goût du public s'est orienté massivement vers d'autres
types d'œuvres ; pour satisfaire notre besoin d'information, de réflexion,
de culture, nous prisons les ouvrages documentaires, les essais, les
œuvres historiques ; pour nous évader, nous nqus adressons
massivement aux romans.
Mais ces livres, même s'ils sont largement les
plus nombreux en termes de vente, ne concurrencent pas directement la
poésie ; ils laissent intact son champ propre et, à la faveur d'une déclara
tion, d'une enquête d'une interview, nous découvrons que les amateurs de
poésie, mais qui ne le proclament pas, sont plus nombreux qu'on ne le
croit.
Passant à Apostrophes en 1982, Francis Ponge, qui n'a pas la répu
tation d'un poète facile, a remporté un énorme succès, aidé il est vrai par
sa personnalité.
Tout récemment, un film montrant d'une manière peut
être un peu démagogique l'impact que la poésie pouvait avoir sur des
adolescents pris dans un moule trop conformiste, Le Cercle des poètes
disparus, a constitué un véritable fait de société par l'enthousiasme qu'il a
suscité dans la jeunesse.
Que par ailleurs le langage, en tant que tel, la lecture en général soient menacés
dans notre monde moderne et que la poésie en soit plus directement victime,
c'est un autre débat, plus vaste et d'ailleurs sujet à controverse.
Deuxième partie : la poésie garde intacte sa force de
dévoilement et de libération
On ne voit donc pas pourquoi la poésie aurait perdu subitement sa puis
sance d'explication du monde, d'éveil à soi-même et aux autres.
On a dit et répété qu'elle se préoccupait de l'impalpable du langage, de
l'au-delà des mots, qu'elle s'ébattait dans la gratuité, qu'elle demandait la
lenteur pour être savourée et sans doute cela alimente-t-il un certain ma
lentendu, car les leitmotive de notre civilisation sont tout à l'opposé.
On
pourrait soutenir au contraire que nous avons plus que jamais besoin
d'elle pour combattre précisément tous les poisons du monde moderne !...
On l'accuse de lenteur? Un critique répond: «Un mérite de la poésie, dont
bien des gens ne se doutent pas, c'est qu'elle dit plus que la prose en
moins de mots.» On l'accuse de se désitétresser du concret, de l'action ?
Il n'est que de relire tous les poètes qui se sont passionnés pour de
grandes causes, y compris dans notre siècle, pour se persuader du con
traire : Aragon (La Diane Française, Le Crève-cœur), Eluard (Au rendez
vous allemand), Guillevic ou Boris Vian face au militarisme, à la guerre
d'Algérie, etc.
En vérité, la poésie reste irremplaçable....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓