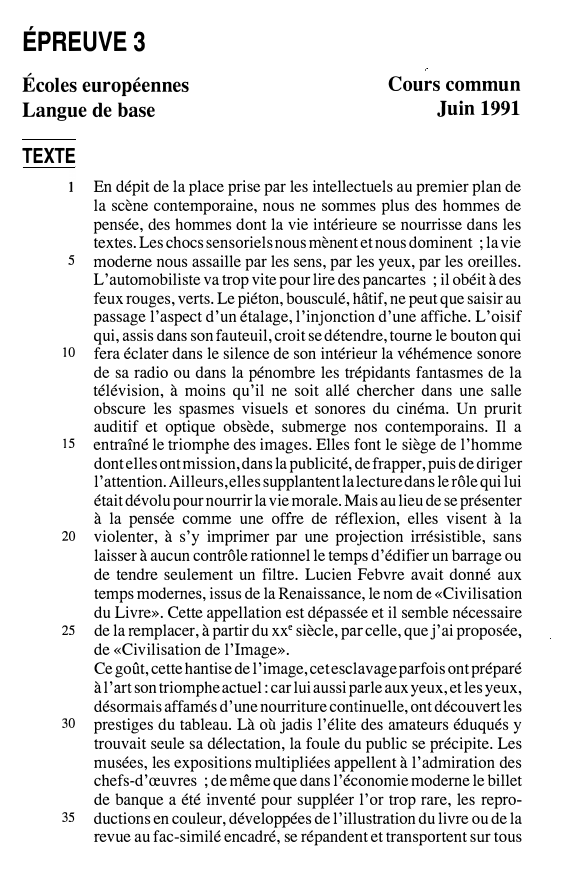ÉPREUVE 3 Écoles européennes Langue de base Cours commun Juin 1991 TEXTE 5 10 15 20 25 30 35 En...
Extrait du document
«
ÉPREUVE 3
Écoles européennes
Langue de base
Cours commun
Juin 1991
TEXTE
5
10
15
20
25
30
35
En dépit de la place prise par les intellectuels au premier plan de
la scène contemporaine, nous ne sommes plus des hommes de
pensée, des hommes dont la vie intérieure se nourrisse dans les
textes.
Les chocs sensoriels nous mènent et nous dominent ; la vie
moderne nous assaille par les sens, par les yeux, par les oreilles.
L'automobiliste va trop vite pour lire des pancartes ; il obéit à des
feux rouges, verts.
Le piéton, bousculé, hâtif, ne peut que saisir au
passage l'aspect d'un étalage, l'injonction d'une affiche.
L'oisif
qui, assis dans son fauteuil, croit se détendre, tourne le bouton qui
fera éclater dans le silence de son intérieur la véhémence sonore
de sa radio ou dans la pénombre les trépidants fantasmes de la
télévision, à moins qu'il ne soit allé chercher dans une salle
obscure les spasmes visuels et sonores du cinéma.
Un prurit
auditif et optique obsède, submerge nos contemporains.
Il a
entraîné le triomphe des images.
Elles font le siège de l'homme
dont elles ont mission, dans la publicité, de frapper, puis de diriger
l'attention.
Ailleurs, elles supplantent la lecture dans le rôle qui lui
était dévolu pour nourrir la vie morale.
Mais au lieu de se présenter
à la pensée comme une offre de réflexion, elles visent à la
violenter, à s'y imprimer par une projection irrésistible, sans
laisser à aucun contrôle rationnel le temps d'édifier un barrage ou
de tendre seulement un filtre.
Lucien Febvre avait donné aux
temps modernes, issus de la Renaissance, le nom de «Civilisation
du Livre».
Cette appellation est dépassée et il semble nécessaire
de la remplacer, à partir du xxe siècle, par celle, que j'ai proposée,
de «Civilisation de l'Image».
Ce goût, cette hantise de l'image, cet esclavage parfois ont préparé
à l'art son triomphe actuel: car lui aussi parle aux yeux, et les yeux,
désormais affamés d'une nourriture continuelle, ont découvert les
prestiges du tableau.
Là où jadis l'élite des amateurs éduqués y
trouvait seule sa délectation, la foule du public se précipite.
Les
musées, les expositions multipliées appellent à l'admiration des
chefs-d'œuvres ; de même que dans l'économie moderne le billet
de banque a été inventé pour suppléer l'or trop rare, les reproductions en couleur, développées de l'illustration du livre ou de la
revue au fac-similé encadré, se répandent et transportent sur tous
40
45
50
55
60
les murs, ceux de l'école ou de l'usine aussi bien que ceux de la
demeure, la présence irremplaçable du peintre.
[...]
Si le succès de la peinture auprès des masses comme des élites
reflète la vogue obsédante des images, s'il semble flatter ce
penchant et en être la conséquence, il en est en même temps la
compensation et le correctif.
Le professeur Daniel Borstin de
l'Université de Chicago a publié, il y a peu, un livre sur l'image
et pour qualifier sa hantise il a avancé le terme de« cancer social ».
Cette prolifération de l'image, envisagée comme un instrument
d'information, précipite la tendance de l'homme moderne à la
passivité : sans aller jusqu'à ces images que l'on a essayé de faire
passer sur l'écran cinématographique trop rapidement pour qu'elles
soient remarquées, mais assez toutefois pour qu'elles s'impriment
dans notre inconscient avec un pouvoir de suggestion que rien
n'entrave plus, on peut dire que cet assaut continuel du regard vise
à créer une inertie du spectateur.
Hors d'état de réfléchir et de
contrôler, il enregistre et subit une sorte d'hypnotisme larvé.
La
réflexion est éliminée et le réflexe, avec son automatisme, tend à
la supplanter ; il est simplement conditionné à un degré supérieur
à celui que réalisait l'expérience fondamentale de Pavlov.
On
pourrait dire que l'image, par l'emploi qui en est fait aujourd'hui,
vise à étendre au psychisme les règles célèbres que Taylor avait
édictées pour l'action, en la pliant aux lois de la machine.
Cette
triple règle s'énonçait:« Identité, répétition, rapidité ».
On pourra
vérifier que la publicité, la télévision ou le cinéma se plient à ces
principes et les appliquent à l'emploi qu'ils font de l'image, quand
ils entendent se servir d'elles pour imprimer aux esprits une
orientation déterminée.
René Huyghe, Les Puissances del' image.
Questions
1.
Résumé (40 points)
Vous résumerez ce texte en 180 mots (écart toléré: 10 %).
Vous indi
querez dans votre copie le nombre de mots employés.
2.
Vocabulaire (10 points)
Expliquez le sens, dans le texte, des expressions suivantes:
- « les trépidants fantasmes de la télévision » (l.
11-12) ;
- « hypnotisme larvé» (l.
53).
3.
Discussion (50 points)
Quels commentaires vous inspire le qualificatif de « cancer social»
qu'utilise Daniel Borstin pour décrire l'utilisation qui est faite
aujourd'hui de l'image ?
représentation imaginaire par laquelle notre «moi » profond cherche à échappe
à l'emprise de la réalité.
«Trépidant » veut dire animé d'un tremblement, et
s'applique souvent à un rythme de danse ou...de vie.
Par cette tournure
imagée, l'auteur évoque les images télévisuelles sous un double aspect :
elles sont animées d'un mouvement incessant et souvent désordonné ;
restant d'autre part hors du champ de notre volonté, elles ont rapport avec
notre psychisme et favorisent, à l'instar de nos fantasmes personnels,
l'évasion hors de notre réel quotidien.
2.
«hypnotisme larvé»
Le mot «larvé » vient du latin «larvatus :masqué » , en passant par le vocabu
laire médical.
Il veut dire «dissimulé», » non apparent » en parlant d'un
processus qui hésite à se déclarer, comme par exemple une révolte, une
contestation.
Ses sonorités, sa ressemblance avec le mot «larve » ont
renforcé sa connotation péjorative.
Quant à l'hypnotisme, dont la racine est le mot grec signifiant «sommeil » , il
s'applique à un sommeil artifiel provoqué par suggestion.
Par cette métaphore, l'auteur entend dénoncer l'état d'engourdissement
intellectuel dans lequel le téléspectateur est habituellement plongé ; pour lui,
la télévision exerce sur nous, sans qu'on ose le déclarer ouvertement, une
action comparable à l'hypnose.
3.
DISCUSSION (10 points)
Rappel du sujet: Quels commentaires vous inspire le qualificatif de «cancer
social» qu'utilise Daniel Bors tin pour décrire l'utilisation qui est faite aujourd'hui
de J'image?
Introduction
Périodiquement, les intellectuels partent en guerre contre l'image et ses
emplois les plus tyranniques, les plus obsédants.
Ils ne cessent de nous
mettre en garde contre la passivité qu'elle engendre, contre tout ce qu'elle a
de fruste, de brutal, de contraire à la reflexion, en un mot de radicalement
différent de ce qui a fait l'essence même de notre civilisation.
Cette dénonciation prend parfois des formes très violentes, comme par
exemple sous la plume du professeur D.
Borstin, cité dans un texte de René
Huyghe, qui n'hésite pas, à propos de cette invasion de l'image, à parler de
«cancer social » .
Cela nous conduit à nous demander si cette prolifération est aussi effective
et générale que le pense D.
Borstin, si l'image mérite globalement une telle
condamnation.
Première partie : l'image envahissante...
Il serait tentant, dans un premier temps, de donner entièrement raison à
l'universitaire californien.
Il faut avouer que cette invasion de l'espace par l'image, et par une image
presque exclusivement à visée marchande, est de plus en plus criante.
Elle
se place sous le signe de l'excès, de l'anarchie et sévit partout : dans les
pages de nos revues comme sur les murs de nos villes, jusque dans les
moindres recoins où le regard cherche à se reposer ; dans ces «clips»
stéréotypés qui s'introduisent par effraction dans toutes sortes d'émissions.
Que de fois avons-nous pu être agacés par ces clichés de la vie de famille,
de la femme, de la réalité, des intérieurs ; par ces affiches racoleuses qui
réveillent des sensations primaires! Ici, en plein quartier populaire en proie
aux chômage et aux lancinants problèmes quotidiens, une jeune femme en
dessous noirs lance un regard lourd de sous-entendus lascifs au dessus du
code télématique d'un téléphone rose.
Là nous est suggérée la tendresse
d'un curé pour une religieuse sous prétexte de nous intéresser à des produits
textiles ; les ligues de bonnes mœurs s'émeuvent, le public ricane...
; et
toujours et encore des produits de consommation à boire, à fumer, à croquer,
sucer, déguster et des voitures surtout, de toutes formes et de toutes
couleurs.
Soumis à ce bombardement multiforme, nous nous sentons parfois les
victimes d'une sorte de manipulation permanente.
C'est la partie animale,
c'est la partie reflexe en nous que l'on veut solliciter et il y a là quelque chose
d'humiliant qui nous conduit parfois à nous révolter.
Mais avouons-le, nous cédons bien souvent à la séduction des images, par
le biais notamment de la télévision ou de la bande dessinée et là se posent
d'autres problèmes : le temps consacré à la lecture recule, la reflexion peut
s'atrophier et des lacunes graves apparaissent dans le maniement de l'écrit,
dans la culture.
Dans le double sens qu'on peut donner à l'expression de D.
Borstin
prolifération anarchique et....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓