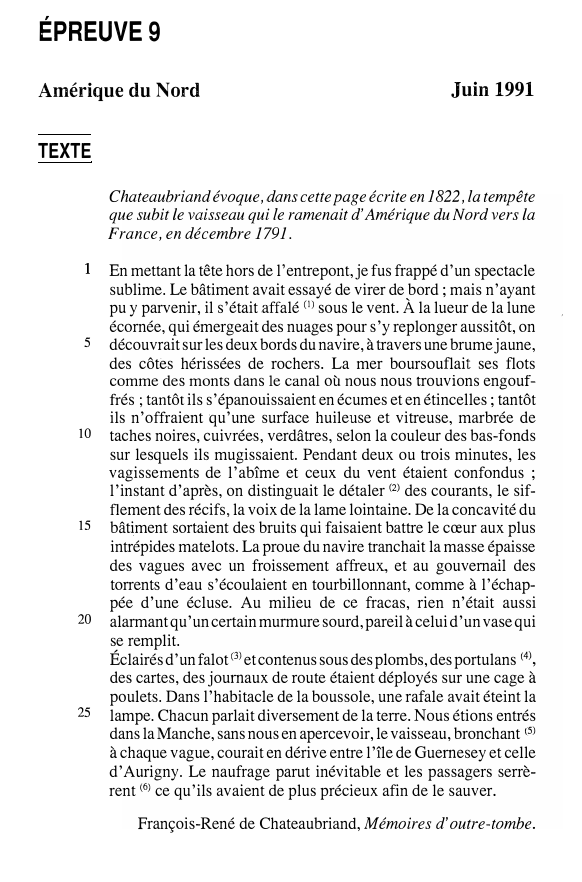ÉPREUVE 9 Amérique du Nord Juin 1991 TEXTE Chateaubriand évoque, dans cette page écrite en 1822, la tempête que subit...
Extrait du document
«
ÉPREUVE 9
Amérique du Nord
Juin 1991
TEXTE
Chateaubriand évoque, dans cette page écrite en 1822, la tempête
que subit le vaisseau qui le ramenait d'Amérique du Nord vers la
France, en décembre 1791.
En mettant la tête hors de l' entrepont,je fus frappé d'un spectacle
sublime.
Le bâtiment avait essayé de virer de bord; mais n'ayant
pu y parvenir, il s'était affalé Ol sous le vent.
À la lueur de la lune
écornée, qui émergeait des nuages pour s'y replonger aussitôt, on
5 découvrait sur les deux bords du navire,àtravers une brume jaune,
des côtes hérissées de rochers.
La mer boursouflait ses flots
comme des monts dans le canal où nous nous trouvions engouf
frés ; tantôt ils s'épanouissaient en écumes et en étincelles; tantôt
ils n'offraient qu'une surface huileuse et vitreuse, marbrée de
10 taches noires, cuivrées, verdâtres, selon la couleur des bas-fonds
sur lesquels ils mugissaient.
Pendant deux ou trois minutes, les
vagissements de l'abîme et ceux du vent étaient confondus ;
l'instant d'après, on distinguait le détaler c2J des courants, le sif
flement des récifs, la voix de la lame lointaine.
De la concavité du
15 bâtiment sortaient des bruits qui faisaient battre le cœur aux plus
intrépides matelots.
La proue du navire tranchait la masse épaisse
des vagues avec un froissement affreux, et au gouvernail des
torrents d'eau s'écoulaient en tourbillonnant, comme à l'échap
pée d'une écluse.
Au milieu de ce fracas, rien n'était aussi
20 alarmant qu'un certain murmure sourd,pareilàceluid'un vase qui
se remplit.
Éclairés d'un falot C3l et contenus sous des plombs,des portulans c4J,
des cartes, des journaux de route étaient déployés sur une cage à
poulets.
Dans l'habitacle de la boussole, une rafale avait éteint la
25 lampe.
Chacun parlait diversement de la terre.
Nous étions entrés
dans la Manche,sans nous en apercevoir,le vaisseau, bronchant 15l
à chaque vague, courait en dérive entre l'île de Guernesey et celle
d'Aurigny.
Le naufrage parut inévitable et les passagers serrè
rent (6l ce qu'ils avaient de plus précieux afin de le sauver.
François-René de Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe.
(1) s'affaler: en parlant d'un navire, être porté vers la côte.
(2) le détaler: du verbe détaler, ici employé comme un nom commun.
(3) falot: grande lanterne.
(4) portulan: carte marine ancienne.
(5) broncher: trébucha devant un obstacle (se dit en général d'un cheval).
(6) serrèrent: rassemblèrent.
Vous ferez de ce texte un commentaire composé.
Vous pourrez notam
ment étudier comment Chateaubriand donne de cette tempête une
représentation dramatique et grandiose.
DÉVELOPPEMENT RÉDIGÉ
Introduction
La plupart des récits autobiographiques fourmillent en péripéties que le
narrateur revit avec émotion ou frayeur rétrospective.
Les Mémoires d'outre
tombe n'échappent pas à la règle: à côté de confidences personnelles, de
moments véritablement historiques, ils évoquent, en raison de la vie aven
tureuse que mena l'auteur pendant longtemps, des moments intenses qu'il se
plaît à rappeler.
C'est ainsi qu'il revit, plus de trente ans après, la terrible
tempête qui assaillit en Manche le navire qui le ramenait d'Amérique du Nord
en décembre 1991.
Conduite avec un sens très sûr du récit palpitant, cette page nous tient en
haleine par son caractère dramatique ; mais Chateaubriand, en admirateur
impénitent des spectacles naturels, y atteint aussi une rare puissance
descriptive.
Ce sont les deux aspects principaux du texte qui structureront
notre commentaire.
Première partie
L'auteur a su nous faire vivre l'épisode avec intensité d'abord grâce à la
focalisation interne, beaucoup plus efficace qu'un récit distancié, et à la riche
trame narrative encadrée par les passés simples de la première et de.
la
dernière phrase.
Dès les premiers mots, c'est une situation gravement compromise que nous
découvrons en même temps que le narrateur: le navire a manqué de virer.
La personnification discrète dans la deuxième phrase est un moyen de nous
faire partager plus sûrement les affres des passagers et de l'équipage : «/e
bâtiment avait essayé, mais, n'ayant pu y parvenir, il s'était affalé sous le
vent».
Ce sont au demeurant des actions accomplies et comme irrémédia
bles : la catastrophe semble bien inévitable.
Le navire dérive donc dangereusement sur une mer en furie et dans un
« canal» bordé de récifs ; «nous nous y trouvions engouffrés», évoquant le sort
collectif, marque à la fois la violence des éléments et l'incapacité à tenir sa
route.
Il n'est rien de pire non plus à l'approche de la côte que de ne pas savoir où
l'on est.
Chateaubriand évoque cette situation angoissante en un bref tableau
ponctué de quelques notations brèves et réalistes : c'est le désordre qui règne
dans le centre névralgique du vaisseau, avec le détail incongru et pittoresque
de «la cage à poulets», c'est l'obscurité preque dotée d'une valeur symboli
que, qui est survenue dans «/'habitacle de la boussole», ce sont les opinions
divergentes sur la position du navire : «chacun parlait diversement de la
terre».
Quand la situation se dessine plus précisément, c'est pour de nouvelles
angoisses («courait en dérive entre deux îles»), et la crainte d'une issue
terrible.
Le passé simple réapparaît alors dans la dernière phrase: commencé
dans l'émotion, le texte se clôt sur un un terrifiant suspense.
D'autre part, dans le tissu narratif sont évoqués successivement avec une
grande force tous les dangers qui menacent ce navire sinon désemparé, du
moins qui ne maîtrise plus sa route.
Selon l'adage fameux, le danger pour le
marin, c'est la côte; ici, elle est des deux côtés, le navire y est enfermé comme
«dans un canal».
Cette côte est d'ailleurs particulièrement inhospitalière, elle
ne promet que la destruction ; le rythme ternaire et la légère allitération le
soulignent à merveille : «/hérissées/ de rochers».
Mais il y a plus grave : ce sont les bas-fonds qui apparaissent de manière
menaçante dans leurs couleurs variées sous la surface «huileuse et vitreuse
des vagues».
Le navire est donc bien exposé à tous les périls possibles, il
semble n'avoir le choix qu'entre être drossé à la côte pour s'y fracasser, ou
s'échouer.
Et pourtant, il est un autre danger d'autant plus terrifiant qu'il n'est que
suggéré par les bruits menaçants qui montent des membrures : «de la concavité
du bâtiment sortaient des bruits qui faisaient battre le cœur au plus intrépide
matelot...» La structure même de la phrase, l'inversion du sujet, l'hyperbole
finale, tout exprime l'angoisse d'une fin proche.
Si l'on se tourne vers la proue,
c'est avec ,un «froissement affreux» qu'elle «tranch[e] la masse épaisse des
vagues».
A un mot précis évoquant la menace du déchirement se joint un
adjectif impressif, avec une allitération en «fr» bien caractéristique du bruit et
de l'effroi qu'il cause.
Le mot «fracas» qui résume tous les bruits antérieurs n'est qu'un point
d'orgue, puisque la phrase qui suit porte l'angoisse à un point culminant: «rien
n'était aussi alarmant qu'un certain mumure sourd pareil à celui d'un vase qui
se remplit», imposant l'horreur d'un engloutissement imminent et subit.
Ainsi, tout au long du texte, l'auteur a su faire revivre les impressions très
fortes qui étaient celles des passagers, impressions causées tout à la fois par
la vue d'une côte accore et terriblement hostile, le déchaînement des
éléments, l'impression d'avoir perdu toute capacité de manœuvre, et, surtout,
tous ces bruits alarmants qui semblaient annoncer une fin prochaine, tout cela
dans une langue très expressive, renforcée par les allitérations d'une prose
rythmée,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓