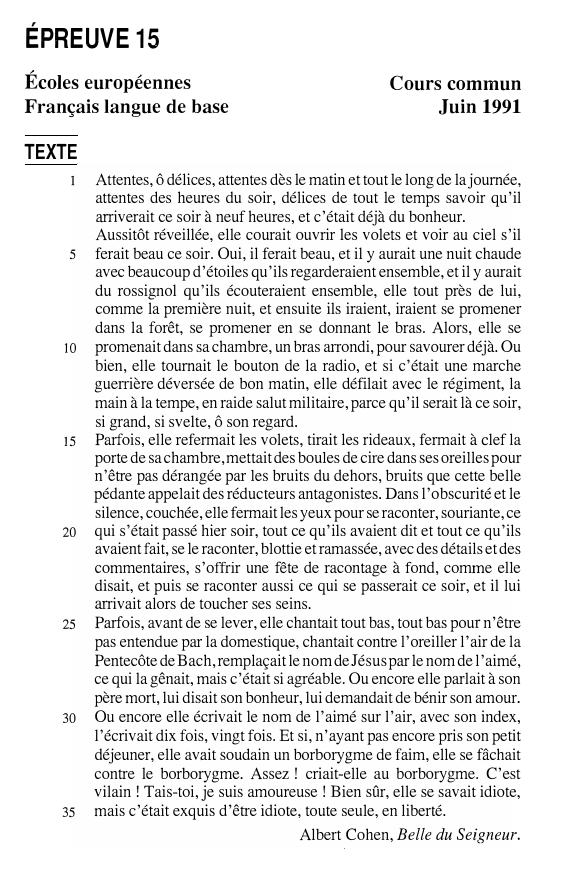ÉPREUVE15 Écoles européennes Français langue de base Cours commun Juin 1991 TEXTE 5 Io 15 20 25 30 35 Attentes,...
Extrait du document
«
ÉPREUVE15
Écoles européennes
Français langue de base
Cours commun
Juin 1991
TEXTE
5
Io
15
20
25
30
35
Attentes, ô délices, attentes dès le matin et tout le long de la journée,
attentes des heures du soir, délices de tout le temps savoir qu'il
arriverait ce soir à neuf heures, et c'était déjà du bonheur.
Aussitôt réveillée, elle courait ouvrir les volets et voir au ciel s'il
ferait beau ce soir.
Oui, il ferait beau, et il y aurait une nuit chaude
avec beaucoup d'étoiles qu'ils regarderaient ensemble, et il y aurait
du rossignol qu'ils écouteraient ensemble, elle tout près de lui,
comme la première nuit, et ensuite ils iraient, iraient se promener
dans la forêt, se promener en se donnant le bras.
Alors, elle se
promenait dans sa chambre, un bras arrondi, pour savourer déjà.
Ou
bien, elle tournait le bouton de la radio, et si c'était une marche
guerrière déversée de bon matin, elle défilait avec le régiment, la
main à la tempe, en raide salut militaire, parce qu'il serait là ce soir,
si grand, si svelte, ô son regard.
Parfois, elle refermait les volets, tirait les rideaux, fermait à clef la
porte de sa chambre, mettait des boules de cire dans ses oreilles pour
n'être pas dérangée par les bruits du dehors, bruits que cette belle
pédante appelait des réducteurs antagonistes.
Dans l'obscurité et le
silence, couchée, elle fermait les yeux pour se raconter, souriante, ce
qui s'était passé hier soir, tout ce qu'ils avaient dit et tout ce qu'ils
avaient fait, se le raconter, blottie et ramassée, avec des détails et des
commentaires, s'offrir une fête de racontage à fond, comme elle
disait, et puis se raconter aussi ce qui se passerait ce soir, et il lui
arrivait alors de toucher ses seins.
Parfois, avant de se lever, elle chantait tout bas, tout bas pour n'être
pas entendue par la domestique, chantait contre l'oreiller l'air de la
Pentecôte de Bach, remplaçait le nom de Jésus par le nom de l'aimé,
ce qui la gênait, mais c'était si agréable.
Ou encore elle parlait à son
père mort, lui disait son bonheur, lui demandait de bénir son amour.
Ou encore elle écrivait le nom de l'aimé sur l'air, avec son index,
l'écrivait dix fois, vingt fois.
Et si, n'ayant pas encore pris son petit
déjeuner, elle avait soudain un borborygme de faim, elle se fâchait
contre le borborygme.
Assez! criait-elle au borborygme.
C'est
vilain ! Tais-toi, je suis amoureuse ! Bien sûr, elle se savait idiote,
mais c'était exquis d'être idiote, toute seule, en liberté.
Albert Cohen, Belle du Seigneur.
Vous ferez de ce texte un commentaire composé.
Vous pourrez étudier
par exemple les choix d'écriture (notamment en matière de rythme et de
syntaxe) qui permettent au romancier de nous faire partager la passion
de son personnage.
1 ntroduction
01.
Tant qu'il y aura des hommes...
: peinture de l'amour, de ses joies, de ses
désordres; thème majeur de notre littérature depuis Tristan et Iseut jusqu'au
dernier des romans à succès.
02.
En 1968, le grand succès d'Albert Cohen avEic Belle du Seigneur, centrée
sur l'idylle romanesque Ariane-Sciai, unis par un amour fou ; ton nouveau,
grande richesse stylistique ; jeune être féminin qui ose vivre et assumer
pleinement sa passion ; le narrateur omniprésent, omniscient, nous montre
le personnage féminin attendant le retour de l'amant, en proie à la fièvre des
«attentes» .
03.
Deux centres d'intérêt vont guider notre étude : d'abord, l'amour comme
effervescence heureuse qui confine au délire et se traduit par toutes sortes
de gestes et un comportement particulier; ensuite, une certaine manière de
simultanément revivre le passé et savourer le futur.
1.
L'amour : un état d'effervescence heureuse, un délicieux
délire
1.1.
État de surexcitation particulière qui provoque des gestes fous: «elle se
promenait", «elle défilait» ; une façon intense de mimer certains souvenirs,
de les revivre comiquement.
D'autre part, elle parle toute seule: «assez, criait
elle au borgborygme", «c'est vilain, tais-toi,, ; elle va jusqu'à chanter toute
seule, à parler à son père mort; bref, c'est un délicieux délire.
1.2.
L'amour, c'est ausi la disparition de tous les tabous, c'est la saveur de la
liberté retrouvée : «elle se savait idiote, mais c'était exquis d'être idiote,, : folie
consciente, défoulement sans contrainte, renforcés par la jeunesse du
personnage, sa spontanéïté (cf., en harmonie, la spontanéïté du langage).
1.3.
Nécessité de la solitude, de l'isolement : «pas dérangée par les bruits du
dehors; elle mettait des boules de cire» ; la façon plaisante dont elle appelle
les bruits ; sa réaction amusante contre le détail familier du borborygme.
Besoin d'isolement, jouissance solitaire.
Un peu plus loin, elle avouera: «En
somme,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓