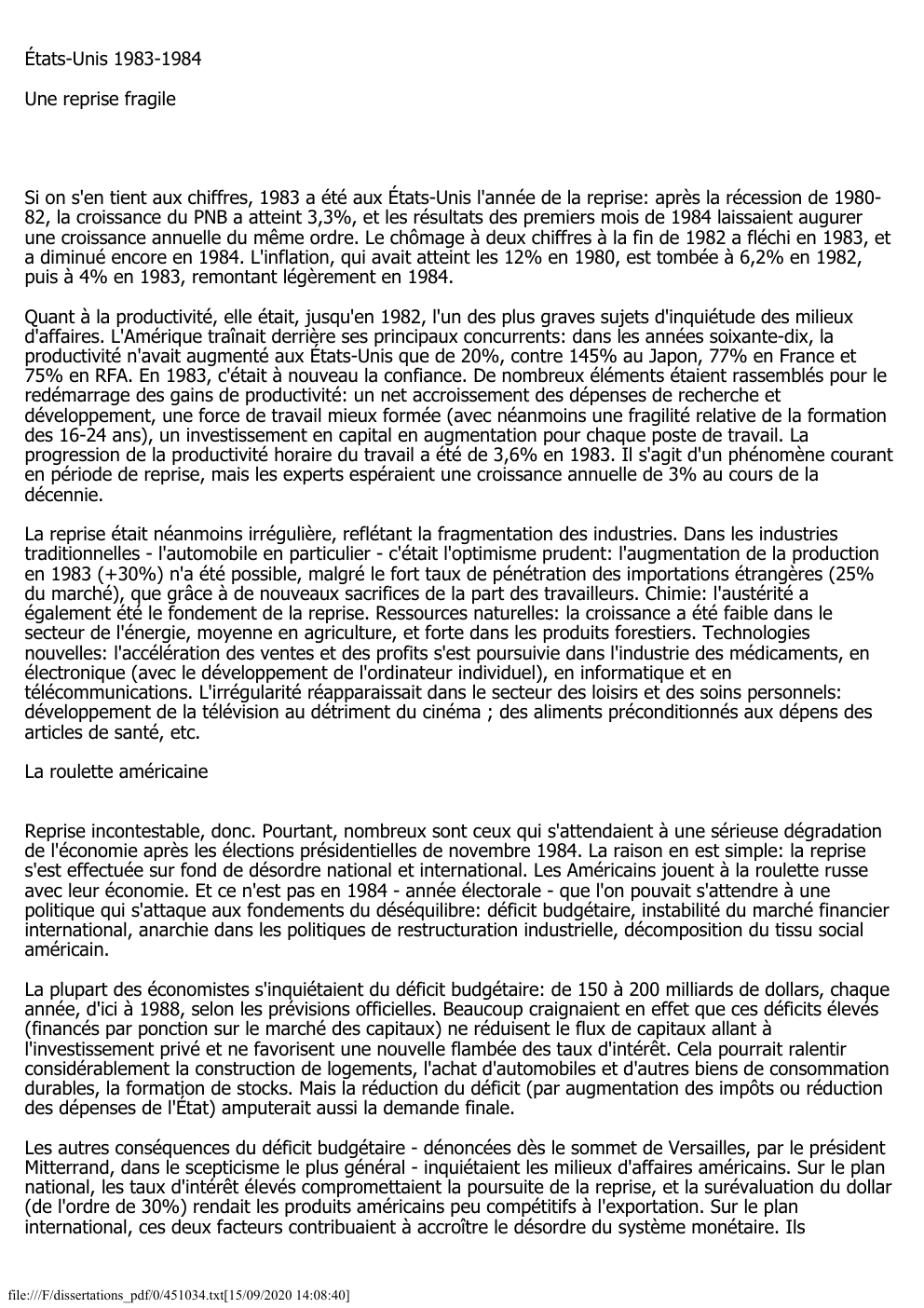États-Unis 1983-1984 Une reprise fragile Si on s'en tient aux chiffres, 1983 a été aux États-Unis l'année de la reprise:...
Extrait du document
«
États-Unis 1983-1984
Une reprise fragile
Si on s'en tient aux chiffres, 1983 a été aux États-Unis l'année de la reprise: après la récession de 198082, la croissance du PNB a atteint 3,3%, et les résultats des premiers mois de 1984 laissaient augurer
une croissance annuelle du même ordre.
Le chômage à deux chiffres à la fin de 1982 a fléchi en 1983, et
a diminué encore en 1984.
L'inflation, qui avait atteint les 12% en 1980, est tombée à 6,2% en 1982,
puis à 4% en 1983, remontant légèrement en 1984.
Quant à la productivité, elle était, jusqu'en 1982, l'un des plus graves sujets d'inquiétude des milieux
d'affaires.
L'Amérique traînait derrière ses principaux concurrents: dans les années soixante-dix, la
productivité n'avait augmenté aux États-Unis que de 20%, contre 145% au Japon, 77% en France et
75% en RFA.
En 1983, c'était à nouveau la confiance.
De nombreux éléments étaient rassemblés pour le
redémarrage des gains de productivité: un net accroissement des dépenses de recherche et
développement, une force de travail mieux formée (avec néanmoins une fragilité relative de la formation
des 16-24 ans), un investissement en capital en augmentation pour chaque poste de travail.
La
progression de la productivité horaire du travail a été de 3,6% en 1983.
Il s'agit d'un phénomène courant
en période de reprise, mais les experts espéraient une croissance annuelle de 3% au cours de la
décennie.
La reprise était néanmoins irrégulière, reflétant la fragmentation des industries.
Dans les industries
traditionnelles - l'automobile en particulier - c'était l'optimisme prudent: l'augmentation de la production
en 1983 (+30%) n'a été possible, malgré le fort taux de pénétration des importations étrangères (25%
du marché), que grâce à de nouveaux sacrifices de la part des travailleurs.
Chimie: l'austérité a
également été le fondement de la reprise.
Ressources naturelles: la croissance a été faible dans le
secteur de l'énergie, moyenne en agriculture, et forte dans les produits forestiers.
Technologies
nouvelles: l'accélération des ventes et des profits s'est poursuivie dans l'industrie des médicaments, en
électronique (avec le développement de l'ordinateur individuel), en informatique et en
télécommunications.
L'irrégularité réapparaissait dans le secteur des loisirs et des soins personnels:
développement de la télévision au détriment du cinéma ; des aliments préconditionnés aux dépens des
articles de santé, etc.
La roulette américaine
Reprise incontestable, donc.
Pourtant, nombreux sont ceux qui s'attendaient à une sérieuse dégradation
de l'économie après les élections présidentielles de novembre 1984.
La raison en est simple: la reprise
s'est effectuée sur fond de désordre national et international.
Les Américains jouent à la roulette russe
avec leur économie.
Et ce n'est pas en 1984 - année électorale - que l'on pouvait s'attendre à une
politique qui s'attaque aux fondements du déséquilibre: déficit budgétaire, instabilité du marché financier
international, anarchie dans les politiques de restructuration industrielle, décomposition du tissu social
américain.
La plupart des économistes s'inquiétaient du déficit budgétaire: de 150 à 200 milliards de dollars, chaque
année, d'ici à 1988, selon les prévisions officielles.
Beaucoup craignaient en effet que ces déficits élevés
(financés par ponction sur le marché des capitaux) ne réduisent le flux de capitaux allant à
l'investissement privé et ne favorisent une nouvelle flambée des taux d'intérêt.
Cela pourrait ralentir
considérablement la construction de logements, l'achat d'automobiles et d'autres biens de consommation
durables, la formation de stocks.
Mais la réduction du déficit (par augmentation des impôts ou réduction
des dépenses de l'État) amputerait aussi la demande finale.
Les autres conséquences du déficit budgétaire - dénoncées dès le sommet de Versailles, par le président
Mitterrand, dans le scepticisme le plus général - inquiétaient les milieux d'affaires américains.
Sur le plan
national, les taux d'intérêt élevés compromettaient la poursuite de la reprise, et la surévaluation du dollar
(de l'ordre de 30%) rendait les produits américains peu compétitifs à l'exportation.
Sur le plan
international, ces deux facteurs contribuaient à accroître le désordre du système monétaire.
Ils
file:///F/dissertations_pdf/0/451034.txt[15/09/2020 14:08:40]
renforçaient également, grâce à l'afflux des capitaux étrangers aux États-Unis, le processus de
désinvestissement, notamment en Europe.
Après avoir financé l'inflation américaine liée à la guerre du
Vietnam, l'ensemble du monde finançait le redéploiement industriel américain.
Mais au-delà, l'aggravation du déficit de la balance des paiements américaine posait le problème de la
dette fédérale: 280 milliards de dollars en 1960, 500 milliards en 1975, 4 200 milliards en 1984.
En 1984,
le pays le plus riche du monde devait consacrer 165 milliards de dollars - soit 4% de son PNB - au service
de la dette.
Si on accepte le scénario de la récession en 1985, sans changement de politique, le déficit
risque de s'accroître de 20 ou 30% - portant le service de la dette aux 2/3 ou aux 3/4 de l'ensemble des
capitaux levés aux États-Unis!
Un autre facteur d'inquiétude était la décomposition du tissu social accompagnant la reprise.
Un élément
de cette dégradation était la politique de "désindustrialisation" sauvage, menée depuis la fin des années
soixante-dix, qui a conduit la fermeture d'usines dans l'Est et le Nord des États-Unis, sans effort de
recyclage des personnels licenciés.
Il s'en est suivi un exode vers le Sud, le Sud-Ouest, et surtout l'Ouest,
rappelant les mouvements de population des campagnes vers les villes lors de la première révolution
industrielle et ceux du Sud vers le Nord à l'occasion de la seconde révolution industrielle.
Dans un premier
temps, la dégradation n'a été visible qu'à l'Est et au Nord.
Plus récemment, les effets pervers de la
troisième révolution technologique se sont fait sentir, également, dans les nouvelles régions
industrialisées de l'Ouest, y compris dans la "vallée du silicium" (Californie), où l'infrastructure urbaine
(école, habitat, transports en commun, etc.) n'a pas suivi le développement économique.
Les méfaits de la désindustrialisation s'ajoutent aux effets non contrôlés des mutations technologiques
dans les régions où se sont développées les industries nouvelles.
Et partout se retrouvent les mêmes
tendances: appauvrissement des services publics (au point que les routes et les ponts ne sont plus
réparés), dégradation de l'enseignement (dont témoignent les rapports publiés au cours des deux
dernières années), réduction de la surface des appartements, accroissement du nombre d'hommes et de
femmes vivant seuls.
L'illusoire "révolution conservatrice"
La reprise s'expliquerait-elle - même dans sa fragilité - par la fameuse "révolution conservatrice" qu'on
oppose au modèle socialiste et/ou social-démocrate français et/ou européen? Même pas! Que sont en
effet devenus, à l'épreuve du pouvoir, les fondements de la "sagesse" reaganienne ou thatcherienne? On
se souvient des quatre idées-forces du candidat Reagan: 1) austérité et équilibre budgétaire ; 2)
réduction des impôts ; 3) ralentissement de la masse monétaire ; 4) "déréglementation" et repli de l'État.
L'austérité n'a certes pas affecté les dépenses militaires (elles ont représenté un tiers de l'augmentation
des dépenses fédérales entre 1981 et 1983), mais, fait plus surprenant, elle n'a pas affecté autant que
prévu les dépenses sociales de l'État: celles-ci sont même passées de 248 milliards de dollars en 1980
(soit 9,43% du PNB) a 358 milliards en 1983 (10,82% du PNB).
C'est que, malgré les nombreuses coupes
opérées dans les budgets d'aide sociale aux chômeurs et aux défavorisés, l'effet de ces restrictions a été
plus que compensé par l'augmentation du nombre des bénéficiaires.
Dans ces conditions, il n'est pas
surprenant que la part des dépenses de l'État dans le PNB ait très nettement augmenté, passant de
20,3% en 1979 à 23,7% en 1983, au prix d'un déficit budgétaire accru.
Ce "dérapage" par rapport aux
objectifs initiaux explique que les prévisions budgétaires pour la période 1984-1988 fassent état d'une
baisse de 15% des dépenses sociales (contre une hausse de 13% pour les dépenses militaires!).
La réduction des impôts a en revanche eu lieu, mais ses effets ont été négatifs et en partie contraires aux
prévisions: transfert fiscal en faveur des riches dans un système de "désimposition" ne tenant pas compte
des différences de revenus ; et surtout décélération de l'épargne privée qui est tombée de 6,8% du PNB
(années cinquante), à 6,7% (années soixante), puis à 4,8% avec la "révolution conservatrice".
Même les
experts de Fortune considéraient que des impôts nouveaux étaient inévitables en 1985.
Troisième pilier du reaganisme, le "monétarisme" n'a pas été appliqué avec rigueur, au grand dam des
friedmaniens.
En 1981, la progression de la masse monétaire....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓