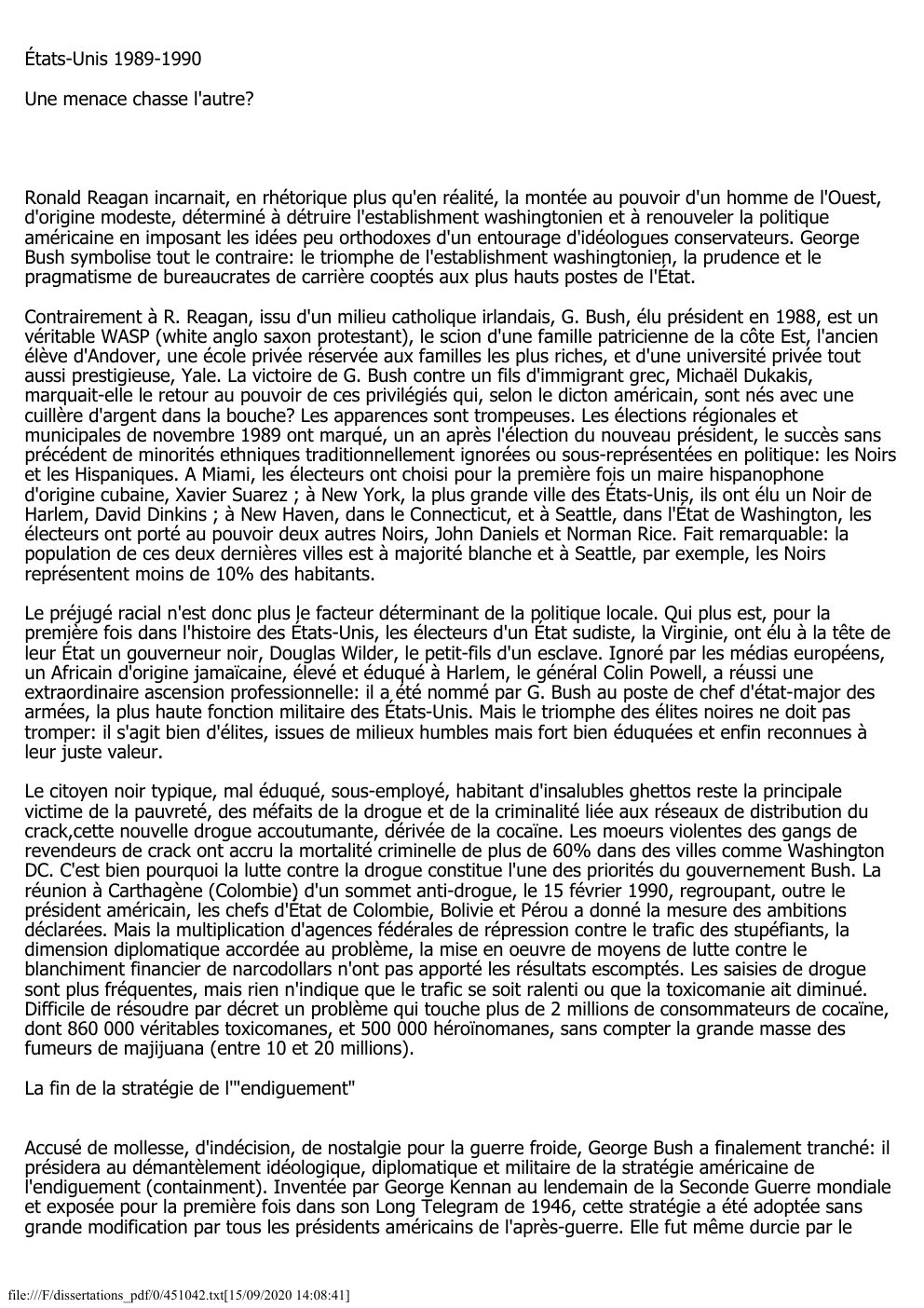États-Unis 1989-1990 Une menace chasse l'autre? Ronald Reagan incarnait, en rhétorique plus qu'en réalité, la montée au pouvoir d'un homme...
Extrait du document
«
États-Unis 1989-1990
Une menace chasse l'autre?
Ronald Reagan incarnait, en rhétorique plus qu'en réalité, la montée au pouvoir d'un homme de l'Ouest,
d'origine modeste, déterminé à détruire l'establishment washingtonien et à renouveler la politique
américaine en imposant les idées peu orthodoxes d'un entourage d'idéologues conservateurs.
George
Bush symbolise tout le contraire: le triomphe de l'establishment washingtonien, la prudence et le
pragmatisme de bureaucrates de carrière cooptés aux plus hauts postes de l'État.
Contrairement à R.
Reagan, issu d'un milieu catholique irlandais, G.
Bush, élu président en 1988, est un
véritable WASP (white anglo saxon protestant), le scion d'une famille patricienne de la côte Est, l'ancien
élève d'Andover, une école privée réservée aux familles les plus riches, et d'une université privée tout
aussi prestigieuse, Yale.
La victoire de G.
Bush contre un fils d'immigrant grec, Michaël Dukakis,
marquait-elle le retour au pouvoir de ces privilégiés qui, selon le dicton américain, sont nés avec une
cuillère d'argent dans la bouche? Les apparences sont trompeuses.
Les élections régionales et
municipales de novembre 1989 ont marqué, un an après l'élection du nouveau président, le succès sans
précédent de minorités ethniques traditionnellement ignorées ou sous-représentées en politique: les Noirs
et les Hispaniques.
A Miami, les électeurs ont choisi pour la première fois un maire hispanophone
d'origine cubaine, Xavier Suarez ; à New York, la plus grande ville des États-Unis, ils ont élu un Noir de
Harlem, David Dinkins ; à New Haven, dans le Connecticut, et à Seattle, dans l'État de Washington, les
électeurs ont porté au pouvoir deux autres Noirs, John Daniels et Norman Rice.
Fait remarquable: la
population de ces deux dernières villes est à majorité blanche et à Seattle, par exemple, les Noirs
représentent moins de 10% des habitants.
Le préjugé racial n'est donc plus le facteur déterminant de la politique locale.
Qui plus est, pour la
première fois dans l'histoire des États-Unis, les électeurs d'un État sudiste, la Virginie, ont élu à la tête de
leur État un gouverneur noir, Douglas Wilder, le petit-fils d'un esclave.
Ignoré par les médias européens,
un Africain d'origine jamaïcaine, élevé et éduqué à Harlem, le général Colin Powell, a réussi une
extraordinaire ascension professionnelle: il a été nommé par G.
Bush au poste de chef d'état-major des
armées, la plus haute fonction militaire des États-Unis.
Mais le triomphe des élites noires ne doit pas
tromper: il s'agit bien d'élites, issues de milieux humbles mais fort bien éduquées et enfin reconnues à
leur juste valeur.
Le citoyen noir typique, mal éduqué, sous-employé, habitant d'insalubles ghettos reste la principale
victime de la pauvreté, des méfaits de la drogue et de la criminalité liée aux réseaux de distribution du
crack,cette nouvelle drogue accoutumante, dérivée de la cocaïne.
Les moeurs violentes des gangs de
revendeurs de crack ont accru la mortalité criminelle de plus de 60% dans des villes comme Washington
DC.
C'est bien pourquoi la lutte contre la drogue constitue l'une des priorités du gouvernement Bush.
La
réunion à Carthagène (Colombie) d'un sommet anti-drogue, le 15 février 1990, regroupant, outre le
président américain, les chefs d'État de Colombie, Bolivie et Pérou a donné la mesure des ambitions
déclarées.
Mais la multiplication d'agences fédérales de répression contre le trafic des stupéfiants, la
dimension diplomatique accordée au problème, la mise en oeuvre de moyens de lutte contre le
blanchiment financier de narcodollars n'ont pas apporté les résultats escomptés.
Les saisies de drogue
sont plus fréquentes, mais rien n'indique que le trafic se soit ralenti ou que la toxicomanie ait diminué.
Difficile de résoudre par décret un problème qui touche plus de 2 millions de consommateurs de cocaïne,
dont 860 000 véritables toxicomanes, et 500 000 héroïnomanes, sans compter la grande masse des
fumeurs de majijuana (entre 10 et 20 millions).
La fin de la stratégie de l'"endiguement"
Accusé de mollesse, d'indécision, de nostalgie pour la guerre froide, George Bush a finalement tranché: il
présidera au démantèlement idéologique, diplomatique et militaire de la stratégie américaine de
l'endiguement (containment).
Inventée par George Kennan au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
et exposée pour la première fois dans son Long Telegram de 1946, cette stratégie a été adoptée sans
grande modification par tous les présidents américains de l'après-guerre.
Elle fut même durcie par le
file:///F/dissertations_pdf/0/451042.txt[15/09/2020 14:08:41]
président Reagan, lors de son premier mandat présidentiel (1980-1984).
L'endiguement constituait la
riposte américaine au stalinisme et au danger de l'impérialisme soviétique.
Cette doctrine stratégico-militaire postulait quelques solides vérités présentées comme incontournables:
aucun compromis, aucune accommodation n'est possible avec les dirigeants soviétiques.
Le seul objectif
affiché par les maîtres du Kremlin est la destruction totale du monde capitaliste.
Le fanatisme des
Soviétiques leur interdit tout raisonnement logique, toute appréciation objective des relations
internationales, et toute compréhension des politiques et des méthodes démocratiques.
Le seul argument
auquel ils sont sensibles est la "logique de la force".
Face à la "vision névrotique du monde" du Kremlin,
les Occidentaux n'ont qu'une seule option: dresser des barrières et "appliquer avec adresse et vigilance
des contre-forces au dispositif mouvant des points géographiques et politiques correspondant aux
tournants et aux manoeuvres de la politique soviétique".
En bref, l'endiguement exigeait plusieurs types d'intervention: une guerre de contre-propagande destinée
à révéler la vraie nature du marxisme-léninisme (les abus de cette contre-propagande conduisirent aux
excès du maccarthysme) ; une politique de préparation militaire (qui produisit le surarmement des
années 1960-1980) ; une contre-offensive militaire sur tous les points chauds de la planète pénétrés par
le communisme (en Corée, au Vietnam, à Cuba...) ; le refus de toute négociation sérieuse avec un
adversaire fanatisé qui ne cherche qu'à exacerber les faiblesses de l'Occident pour lui donner un "coup de
grâce final".
On retrouve là, à peu de chose près, les éléments de la "doctrine Reagan".
Lorsque ce
dernier dénonçait l'"Empire du mal", il ne faisait que renouer avec une tradition anticommuniste,
inaugurée par George Kennan et reprise à leur compte par tous les présidents américains, exception faite
de Jimmy Carter (1976-1980).
En pratique, la "doctrine Reagan", contrairement à celle de ses
prédécesseurs, privilégiait la guerre indirecte sur l'intervention militaire directe: l'aide aux rebelles contras
du Nicaragua, le soutien actif de la résistance musulmane afghane, l'aide aux guérilleros de l'UNITA
(Union nationale pour la libération totale de l'Angola), en bref la guerre par personne interposée.
L'intervention américaine à la Grenade (1983) ou le raid de l'aviation américaine sur la Libye (1986)
restaient des exceptions, des manifestations peu convaincantes (et peu coûteuses) de la puissance
militaire américaine...
De la notion d'ennemis à celle de partenaires
En affirmant publiquement son soutien à la perestroïka, en exprimant sa "compréhension" pour la
répression sanglante menée à Bakou, en refusant de faire un geste en faveur de la Lituanie engagée
dans un bras de fer avec Moscou, George Bush a rompu de façon spectaculaire avec ses prédécesseurs.
Quel autre président aurait pu affirmer sans hypocrisie, à la fin du sommet américano-soviétique de Malte
des 2 et 3 décembre 1989: "Je suis prêt à faire tout mon possible pour faciliter l'engagement de
l'économie soviétique dans les marchés internationaux", ou encore: "Il y a dans notre pays un soutien
massif pour ce que le président Gorbatchev est en train de faire" et un "respect énorme" pour ce qu'il
accomplit en Europe de l'Est? Mais il est vrai que l'opinion publique américaine, comme l'opinion publique
européenne, n'a plus grande appréhension à l'égard du "danger" soviétique.
D'abord incrédule, elle a
compris que l'effondrement du communisme en Europe de l'Est, sans réaction soviétique, signifiait
l'ouverture d'une nouvelle ère de paix et de prospérité.
Ce qu'elle avait pris pour un "loup" dans la
bergerie d'Europe centrale n'était, découvrait-elle, qu'un agneau parmi les agneaux.
Signe avant-coureur des temps nouveaux, M.
Gorbatchev déclarait le 20 juin 1989, au cours d'une visite
de courtoisie de l'ancien chef d'état-major inter-armées des États-Unis, l'amiral William Crowe: "Nous
sommes en....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓