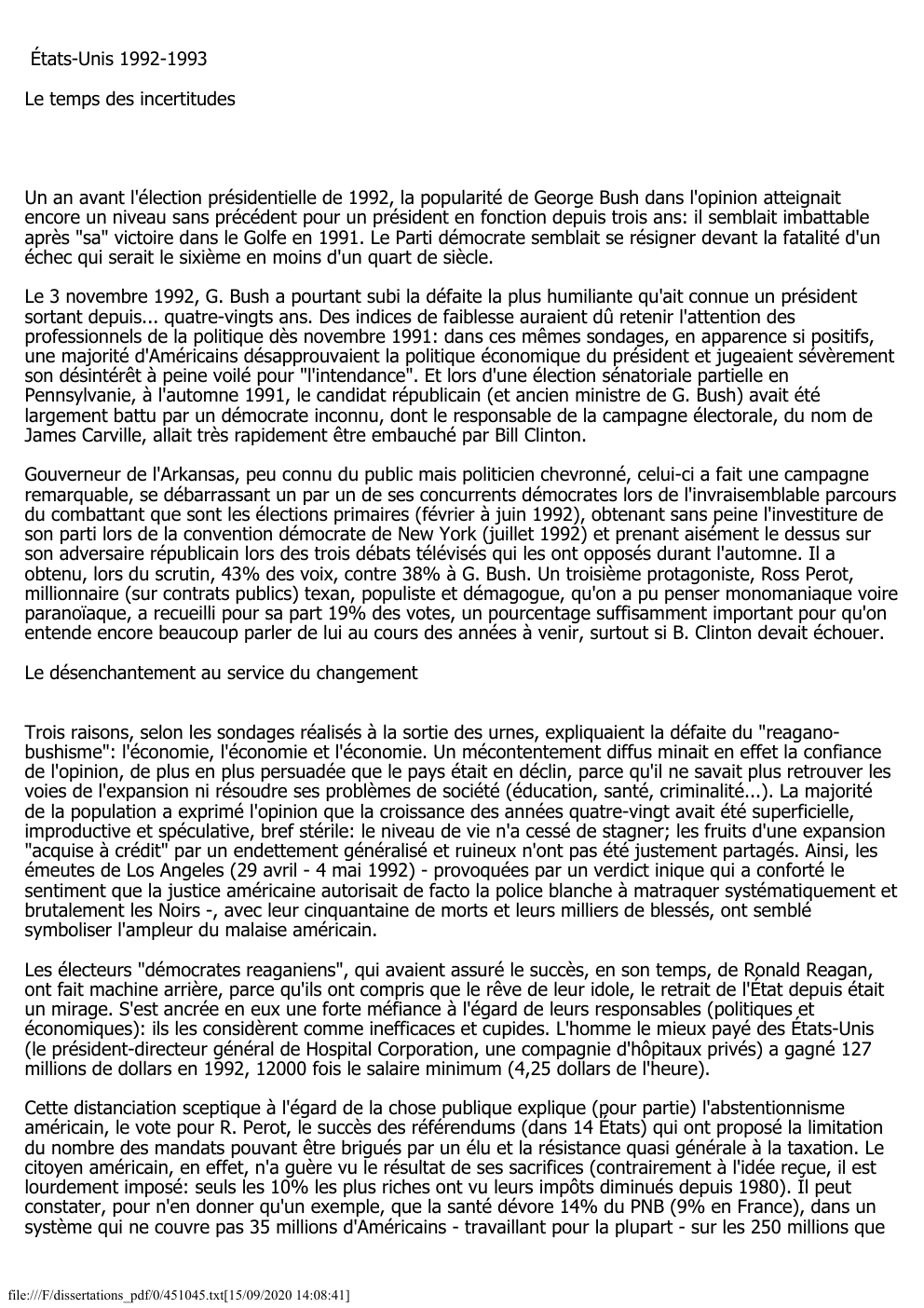États-Unis 1992-1993 Le temps des incertitudes Un an avant l'élection présidentielle de 1992, la popularité de George Bush dans l'opinion...
Extrait du document
«
États-Unis 1992-1993
Le temps des incertitudes
Un an avant l'élection présidentielle de 1992, la popularité de George Bush dans l'opinion atteignait
encore un niveau sans précédent pour un président en fonction depuis trois ans: il semblait imbattable
après "sa" victoire dans le Golfe en 1991.
Le Parti démocrate semblait se résigner devant la fatalité d'un
échec qui serait le sixième en moins d'un quart de siècle.
Le 3 novembre 1992, G.
Bush a pourtant subi la défaite la plus humiliante qu'ait connue un président
sortant depuis...
quatre-vingts ans.
Des indices de faiblesse auraient dû retenir l'attention des
professionnels de la politique dès novembre 1991: dans ces mêmes sondages, en apparence si positifs,
une majorité d'Américains désapprouvaient la politique économique du président et jugeaient sévèrement
son désintérêt à peine voilé pour "l'intendance".
Et lors d'une élection sénatoriale partielle en
Pennsylvanie, à l'automne 1991, le candidat républicain (et ancien ministre de G.
Bush) avait été
largement battu par un démocrate inconnu, dont le responsable de la campagne électorale, du nom de
James Carville, allait très rapidement être embauché par Bill Clinton.
Gouverneur de l'Arkansas, peu connu du public mais politicien chevronné, celui-ci a fait une campagne
remarquable, se débarrassant un par un de ses concurrents démocrates lors de l'invraisemblable parcours
du combattant que sont les élections primaires (février à juin 1992), obtenant sans peine l'investiture de
son parti lors de la convention démocrate de New York (juillet 1992) et prenant aisément le dessus sur
son adversaire républicain lors des trois débats télévisés qui les ont opposés durant l'automne.
Il a
obtenu, lors du scrutin, 43% des voix, contre 38% à G.
Bush.
Un troisième protagoniste, Ross Perot,
millionnaire (sur contrats publics) texan, populiste et démagogue, qu'on a pu penser monomaniaque voire
paranoïaque, a recueilli pour sa part 19% des votes, un pourcentage suffisamment important pour qu'on
entende encore beaucoup parler de lui au cours des années à venir, surtout si B.
Clinton devait échouer.
Le désenchantement au service du changement
Trois raisons, selon les sondages réalisés à la sortie des urnes, expliquaient la défaite du "reaganobushisme": l'économie, l'économie et l'économie.
Un mécontentement diffus minait en effet la confiance
de l'opinion, de plus en plus persuadée que le pays était en déclin, parce qu'il ne savait plus retrouver les
voies de l'expansion ni résoudre ses problèmes de société (éducation, santé, criminalité...).
La majorité
de la population a exprimé l'opinion que la croissance des années quatre-vingt avait été superficielle,
improductive et spéculative, bref stérile: le niveau de vie n'a cessé de stagner; les fruits d'une expansion
"acquise à crédit" par un endettement généralisé et ruineux n'ont pas été justement partagés.
Ainsi, les
émeutes de Los Angeles (29 avril - 4 mai 1992) - provoquées par un verdict inique qui a conforté le
sentiment que la justice américaine autorisait de facto la police blanche à matraquer systématiquement et
brutalement les Noirs -, avec leur cinquantaine de morts et leurs milliers de blessés, ont semblé
symboliser l'ampleur du malaise américain.
Les électeurs "démocrates reaganiens", qui avaient assuré le succès, en son temps, de Ronald Reagan,
ont fait machine arrière, parce qu'ils ont compris que le rêve de leur idole, le retrait de l'État depuis était
un mirage.
S'est ancrée en eux une forte méfiance à l'égard de leurs responsables (politiques et
économiques): ils les considèrent comme inefficaces et cupides.
L'homme le mieux payé des États-Unis
(le président-directeur général de Hospital Corporation, une compagnie d'hôpitaux privés) a gagné 127
millions de dollars en 1992, 12000 fois le salaire minimum (4,25 dollars de l'heure).
Cette distanciation sceptique à l'égard de la chose publique explique (pour partie) l'abstentionnisme
américain, le vote pour R.
Perot, le succès des référendums (dans 14 États) qui ont proposé la limitation
du nombre des mandats pouvant être brigués par un élu et la résistance quasi générale à la taxation.
Le
citoyen américain, en effet, n'a guère vu le résultat de ses sacrifices (contrairement à l'idée reçue, il est
lourdement imposé: seuls les 10% les plus riches ont vu leurs impôts diminués depuis 1980).
Il peut
constater, pour n'en donner qu'un exemple, que la santé dévore 14% du PNB (9% en France), dans un
système qui ne couvre pas 35 millions d'Américains - travaillant pour la plupart - sur les 250 millions que
file:///F/dissertations_pdf/0/451045.txt[15/09/2020 14:08:41]
compte le pays, lanterne rouge du monde développé en matière de taux de mortalité.
Pour avoir quelque rancoeur à l'égard d'une telle gabegie, les Américains sont pourtant demeurés
étonnamment attachés au développement de leurs services publics et au rôle de l'État: ils ont voté en
faveur de celui qui leur promettait, certes le changement mais aussi un "nouveau" Parti démocrate prêt à
se battre pour "la responsabilité et l'investissement" et à dépouiller le "vieil homme" affublé de l'étiquette
infamante "ne sait qu'imposer et dépenser".
Même G.
Bush a dès lors préconisé, durant la campagne, des
politiques publiques plus actives en matière de santé ou d'éducation.
Par leur vote, les électeurs américains ont essentiellement déclaré qu'ils souhaitaient que l'État favorise le
développement économique et le progrès social - se partageant selon une véritable fracture sociale, plus
ancienne et mieux établie qu'on ne le dit généralement.
Élu le 3 novembre 1992, B.
Clinton n'est entré en fonction, comme le veut la loi, que le 20 janvier 1993: il
a ainsi eu près de trois mois pour se préparer à l'épreuve.
Comme le susurrait le président sortant dans
ces semaines: "L'interrègne est trop long et laborieux." En effet, malgré les 3,5 millions de dollars alloués
par le Congrès et les centaines de "conseillers", B.
Clinton n'est pas arrivé mieux préparé à la présidence;
son équipe, au sens large du terme, était encore loin d'être au complet cent jours après sa prestation de
serment.
Le 29 avril 1993, il n'avait proposé de noms que pour un quart des 625 postes administratifs de
haut niveau qui requièrent l'assentiment du Sénat - lequel n'en avait confirmé que 51, signe de réticences
croissantes (malgré une majorité démocrate) à l'égard du nouveau président.
Il en allait de même pour
les ambassadeurs et les juges fédéraux, personnalités nommées par les républicains se trouvant assurer
le fonctionnement de l'État.
Pire, B.
Clinton a été obligé à plusieurs reprises de retirer les noms soumis au
Sénat (deux propositions successives pour le poste de ministre de la Justice) ou de se débarrasser de
membres de son entourage le plus proche, dont le génie et la jeunesse avaient par toute la planète été
vantés (remplacement de George Stephanopoulos par un homme d'expérience, David Gergen, au poste
de directeur de la communication).
Les choses ne sont pas allées mieux en matière de décision politique: la présidence a semblé flotter, B.
Clinton est apparu incertain voire contradictoire et son cabinet, que lui-même a choisi, inefficace et/ou
inepte.
A la veille de l'été 1993, aucun projet d'ampleur n'avait encore été adopté par le Congrès.
Les
crédits que prévoyait le président pour favoriser la reprise ont été, à toutes fins utiles, refusés par la
minorité républicaine au Sénat, laquelle a pu imposer sa volonté à la majorité grâce à la détestable
pratique de la "flibuste" (débat-logorrhée que seule une majorité qualifiée de 60 voix - sur 100 sénateurs
- peut faire cesser pour que l'on passe enfin au vote) et son budget est apparu en....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓