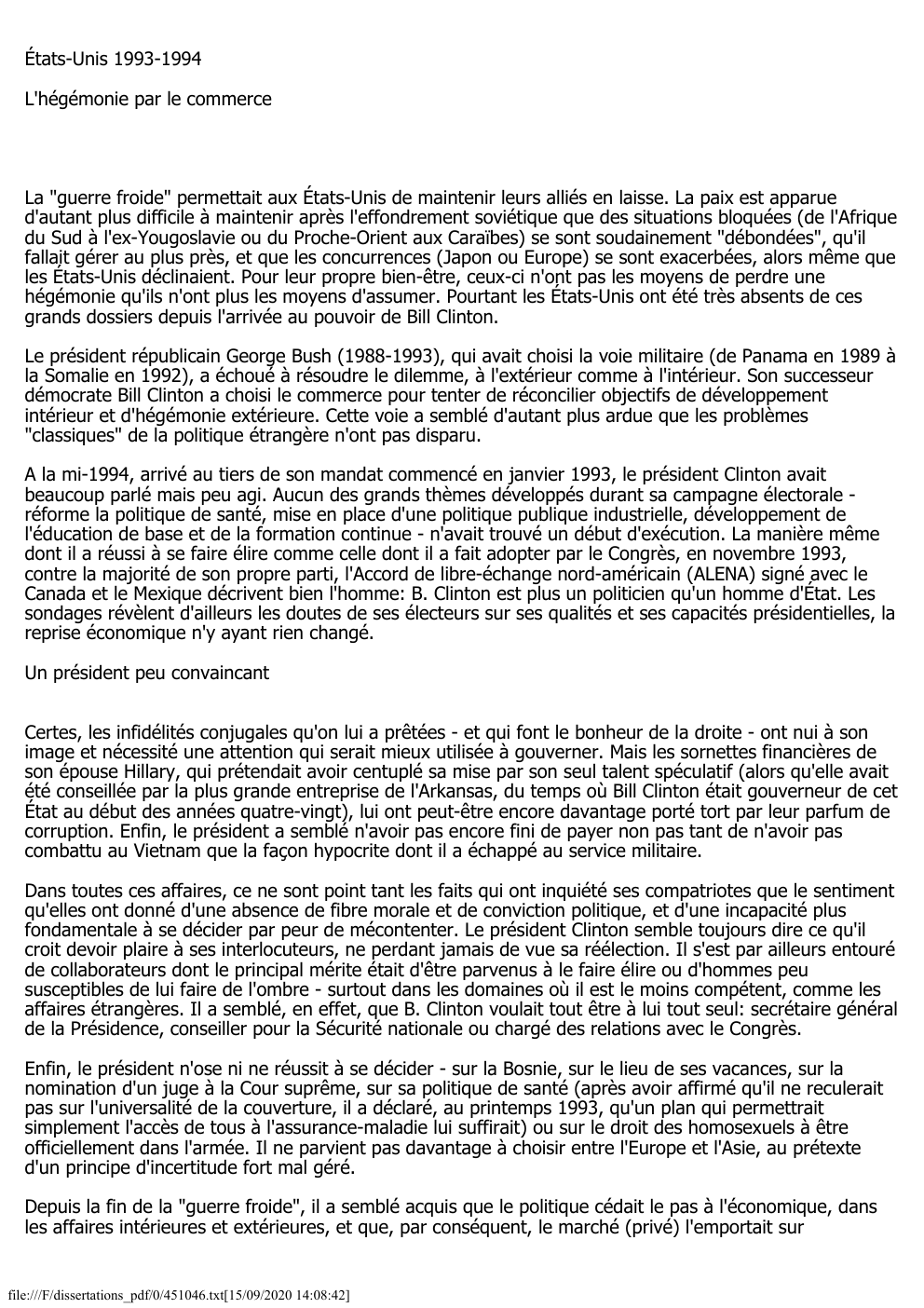États-Unis 1993-1994 L'hégémonie par le commerce La "guerre froide" permettait aux États-Unis de maintenir leurs alliés en laisse. La paix...
Extrait du document
«
États-Unis 1993-1994
L'hégémonie par le commerce
La "guerre froide" permettait aux États-Unis de maintenir leurs alliés en laisse.
La paix est apparue
d'autant plus difficile à maintenir après l'effondrement soviétique que des situations bloquées (de l'Afrique
du Sud à l'ex-Yougoslavie ou du Proche-Orient aux Caraïbes) se sont soudainement "débondées", qu'il
fallait gérer au plus près, et que les concurrences (Japon ou Europe) se sont exacerbées, alors même que
les États-Unis déclinaient.
Pour leur propre bien-être, ceux-ci n'ont pas les moyens de perdre une
hégémonie qu'ils n'ont plus les moyens d'assumer.
Pourtant les États-Unis ont été très absents de ces
grands dossiers depuis l'arrivée au pouvoir de Bill Clinton.
Le président républicain George Bush (1988-1993), qui avait choisi la voie militaire (de Panama en 1989 à
la Somalie en 1992), a échoué à résoudre le dilemme, à l'extérieur comme à l'intérieur.
Son successeur
démocrate Bill Clinton a choisi le commerce pour tenter de réconcilier objectifs de développement
intérieur et d'hégémonie extérieure.
Cette voie a semblé d'autant plus ardue que les problèmes
"classiques" de la politique étrangère n'ont pas disparu.
A la mi-1994, arrivé au tiers de son mandat commencé en janvier 1993, le président Clinton avait
beaucoup parlé mais peu agi.
Aucun des grands thèmes développés durant sa campagne électorale réforme la politique de santé, mise en place d'une politique publique industrielle, développement de
l'éducation de base et de la formation continue - n'avait trouvé un début d'exécution.
La manière même
dont il a réussi à se faire élire comme celle dont il a fait adopter par le Congrès, en novembre 1993,
contre la majorité de son propre parti, l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) signé avec le
Canada et le Mexique décrivent bien l'homme: B.
Clinton est plus un politicien qu'un homme d'État.
Les
sondages révèlent d'ailleurs les doutes de ses électeurs sur ses qualités et ses capacités présidentielles, la
reprise économique n'y ayant rien changé.
Un président peu convaincant
Certes, les infidélités conjugales qu'on lui a prêtées - et qui font le bonheur de la droite - ont nui à son
image et nécessité une attention qui serait mieux utilisée à gouverner.
Mais les sornettes financières de
son épouse Hillary, qui prétendait avoir centuplé sa mise par son seul talent spéculatif (alors qu'elle avait
été conseillée par la plus grande entreprise de l'Arkansas, du temps où Bill Clinton était gouverneur de cet
État au début des années quatre-vingt), lui ont peut-être encore davantage porté tort par leur parfum de
corruption.
Enfin, le président a semblé n'avoir pas encore fini de payer non pas tant de n'avoir pas
combattu au Vietnam que la façon hypocrite dont il a échappé au service militaire.
Dans toutes ces affaires, ce ne sont point tant les faits qui ont inquiété ses compatriotes que le sentiment
qu'elles ont donné d'une absence de fibre morale et de conviction politique, et d'une incapacité plus
fondamentale à se décider par peur de mécontenter.
Le président Clinton semble toujours dire ce qu'il
croit devoir plaire à ses interlocuteurs, ne perdant jamais de vue sa réélection.
Il s'est par ailleurs entouré
de collaborateurs dont le principal mérite était d'être parvenus à le faire élire ou d'hommes peu
susceptibles de lui faire de l'ombre - surtout dans les domaines où il est le moins compétent, comme les
affaires étrangères.
Il a semblé, en effet, que B.
Clinton voulait tout être à lui tout seul: secrétaire général
de la Présidence, conseiller pour la Sécurité nationale ou chargé des relations avec le Congrès.
Enfin, le président n'ose ni ne réussit à se décider - sur la Bosnie, sur le lieu de ses vacances, sur la
nomination d'un juge à la Cour suprême, sur sa politique de santé (après avoir affirmé qu'il ne reculerait
pas sur l'universalité de la couverture, il a déclaré, au printemps 1993, qu'un plan qui permettrait
simplement l'accès de tous à l'assurance-maladie lui suffirait) ou sur le droit des homosexuels à être
officiellement dans l'armée.
Il ne parvient pas davantage à choisir entre l'Europe et l'Asie, au prétexte
d'un principe d'incertitude fort mal géré.
Depuis la fin de la "guerre froide", il a semblé acquis que le politique cédait le pas à l'économique, dans
les affaires intérieures et extérieures, et que, par conséquent, le marché (privé) l'emportait sur
file:///F/dissertations_pdf/0/451046.txt[15/09/2020 14:08:42]
l'intervention (publique).
Certes, les préoccupations économiques, bien que du domaine du non-dit,
constituaient déjà un ressort essentiel, sinon le seul de l'interventionnisme.
Et l'obsession économique
affichée par B.
Clinton n'explique ni ne justifie en quoi que ce soit les palinodies du président sur la
Bosnie ou Haïti.
B.
Clinton s'est fait élire en accusant son prédécesseur d'avoir trop négligé le bien-être des Américains.
A
l'été 1994, il paraissait avoir gagné son pari, tout semblant aller pour le mieux dans le meilleur des
mondes économiques.
Pas moins de 3,7 millions d'emplois avaient été créés en un an (mai 1993 à mai
1994), autant que pendant les cinq années précédentes; la croissance du PNB a atteint 7% en rythme
annuel au dernier trimestre 1993, puis 3,4% au premier trimestre 1994; le taux de chômage est tombé à
6% en mai 1993 contre 6,9% un an auparavant, tout cela sans que les Américains s'en trouvent
particulièrement éblouis.
Ainsi, 31% d'entre eux seulement pensaient en juin 1994 que la récession était
terminée dans leur région alors que la reprise économique avait commencé plus de deux ans auparavant
(sondage Time-CNN).
Le scepticisme est bien ancré dans la mentalité collective américaine.
Redressement en trompe-l'oeil
Il existe deux types d'expansion.
L'une, "à la Truman", est vertueuse: le pays s'enrichit et se développe,
la dette publique diminue, la protection sociale (pour tous) s'élargit et le niveau de vie (de tous)
augmente.
L'autre, "à la Reagan", est perverse: le pays s'appauvrit, l'endettement s'accroît, les pauvres
deviennent encore plus pauvres et les riches toujours plus riches.
La reprise "à la Clinton" pourrait bien être du second type.
Certes, le président démocrate a hérité d'une
situation catastrophique.
Le reagano-bushisme a été triplement ruineux car, dans la décennie quatrevingt, l'expansion a été improductive, obtenue à crédit et socialement régressive.
Que l'on considère les
infrastructures, les usines ou les centres des villes, l'endettement public ou privé, la santé, l'éducation ou
la recherche, la criminalité, le racisme ou la pauvreté, les dégâts causés par des lustres d'excès et
d'irresponsabilité sont considérables, autant que l'effort à déployer pour corriger la situation.
B.
Clinton, plutôt que de réformer en profondeur, a préféré croire et laisser croire que les problèmes
avaient été réglés.
Ainsi a-t-il affirmé, au "sommet" du G-7 de janvier 1994, que, sous sa gouverne, le
pays avait résolu ses problèmes de déficit budgétaire et qu'il revenait dorénavant aux autres pays
industrialisés de prendre le relais pour relancer l'économie mondiale et soulager les États-Unis.
Le déficit
fédéral n'a guère diminué: il y a surtout eu ralentissement de la progression.
L'ensemble des indicateurs "fondamentaux", en revanche, est demeuré préoccupant.
Le PNB a certes crû,
mais dans des secteurs plus "consommateurs" (santé ou restauration) que "producteurs de richesses"
(industrie).
On a créé des emplois par millions, mais la plupart à temps partiel, précaires, sans couverture
sociale et mal payés, et 3 millions de "bons postes de travail" (correctement payés et avec protection
sociale) ont disparu en quinze ans.
En 1994, un travailleur américain à temps plein sur cinq dispose d'un
revenu annuel inférieur au seuil de pauvreté officiel.
Car c'est la misère qui est facteur d'exclusion, celle des pauvres au travail aux États-Unis davantage
encore que celle des chômeurs en Europe.
Alors que, jusqu'au milieu des années soixante-dix, les besoins d'emprunt de l'État fédéral
"consommaient" moins de 15% de l'épargne disponible des ménages, elle en a requis les deux tiers à
partir du milieu des années quatre-vingt.
En trente ans, l'investissement net (public et privé) n'a pas
dépassé en moyenne annuelle 7,5% du PIB (contre 13% en France....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓