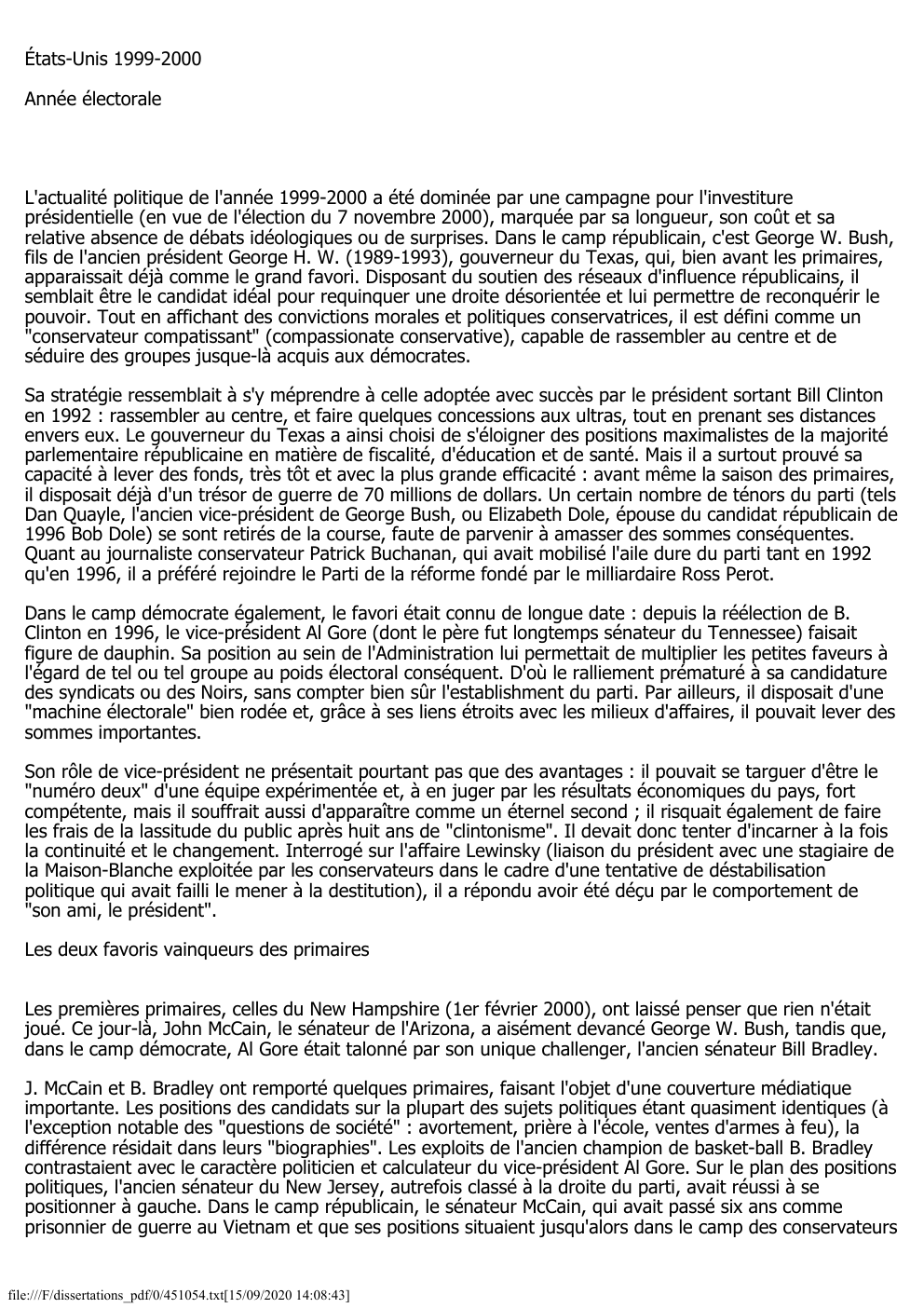États-Unis 1999-2000 Année électorale L'actualité politique de l'année 1999-2000 a été dominée par une campagne pour l'investiture présidentielle (en vue...
Extrait du document
«
États-Unis 1999-2000
Année électorale
L'actualité politique de l'année 1999-2000 a été dominée par une campagne pour l'investiture
présidentielle (en vue de l'élection du 7 novembre 2000), marquée par sa longueur, son coût et sa
relative absence de débats idéologiques ou de surprises.
Dans le camp républicain, c'est George W.
Bush,
fils de l'ancien président George H.
W.
(1989-1993), gouverneur du Texas, qui, bien avant les primaires,
apparaissait déjà comme le grand favori.
Disposant du soutien des réseaux d'influence républicains, il
semblait être le candidat idéal pour requinquer une droite désorientée et lui permettre de reconquérir le
pouvoir.
Tout en affichant des convictions morales et politiques conservatrices, il est défini comme un
"conservateur compatissant" (compassionate conservative), capable de rassembler au centre et de
séduire des groupes jusque-là acquis aux démocrates.
Sa stratégie ressemblait à s'y méprendre à celle adoptée avec succès par le président sortant Bill Clinton
en 1992 : rassembler au centre, et faire quelques concessions aux ultras, tout en prenant ses distances
envers eux.
Le gouverneur du Texas a ainsi choisi de s'éloigner des positions maximalistes de la majorité
parlementaire républicaine en matière de fiscalité, d'éducation et de santé.
Mais il a surtout prouvé sa
capacité à lever des fonds, très tôt et avec la plus grande efficacité : avant même la saison des primaires,
il disposait déjà d'un trésor de guerre de 70 millions de dollars.
Un certain nombre de ténors du parti (tels
Dan Quayle, l'ancien vice-président de George Bush, ou Elizabeth Dole, épouse du candidat républicain de
1996 Bob Dole) se sont retirés de la course, faute de parvenir à amasser des sommes conséquentes.
Quant au journaliste conservateur Patrick Buchanan, qui avait mobilisé l'aile dure du parti tant en 1992
qu'en 1996, il a préféré rejoindre le Parti de la réforme fondé par le milliardaire Ross Perot.
Dans le camp démocrate également, le favori était connu de longue date : depuis la réélection de B.
Clinton en 1996, le vice-président Al Gore (dont le père fut longtemps sénateur du Tennessee) faisait
figure de dauphin.
Sa position au sein de l'Administration lui permettait de multiplier les petites faveurs à
l'égard de tel ou tel groupe au poids électoral conséquent.
D'où le ralliement prématuré à sa candidature
des syndicats ou des Noirs, sans compter bien sûr l'establishment du parti.
Par ailleurs, il disposait d'une
"machine électorale" bien rodée et, grâce à ses liens étroits avec les milieux d'affaires, il pouvait lever des
sommes importantes.
Son rôle de vice-président ne présentait pourtant pas que des avantages : il pouvait se targuer d'être le
"numéro deux" d'une équipe expérimentée et, à en juger par les résultats économiques du pays, fort
compétente, mais il souffrait aussi d'apparaître comme un éternel second ; il risquait également de faire
les frais de la lassitude du public après huit ans de "clintonisme".
Il devait donc tenter d'incarner à la fois
la continuité et le changement.
Interrogé sur l'affaire Lewinsky (liaison du président avec une stagiaire de
la Maison-Blanche exploitée par les conservateurs dans le cadre d'une tentative de déstabilisation
politique qui avait failli le mener à la destitution), il a répondu avoir été déçu par le comportement de
"son ami, le président".
Les deux favoris vainqueurs des primaires
Les premières primaires, celles du New Hampshire (1er février 2000), ont laissé penser que rien n'était
joué.
Ce jour-là, John McCain, le sénateur de l'Arizona, a aisément devancé George W.
Bush, tandis que,
dans le camp démocrate, Al Gore était talonné par son unique challenger, l'ancien sénateur Bill Bradley.
J.
McCain et B.
Bradley ont remporté quelques primaires, faisant l'objet d'une couverture médiatique
importante.
Les positions des candidats sur la plupart des sujets politiques étant quasiment identiques (à
l'exception notable des "questions de société" : avortement, prière à l'école, ventes d'armes à feu), la
différence résidait dans leurs "biographies".
Les exploits de l'ancien champion de basket-ball B.
Bradley
contrastaient avec le caractère politicien et calculateur du vice-président Al Gore.
Sur le plan des positions
politiques, l'ancien sénateur du New Jersey, autrefois classé à la droite du parti, avait réussi à se
positionner à gauche.
Dans le camp républicain, le sénateur McCain, qui avait passé six ans comme
prisonnier de guerre au Vietnam et que ses positions situaient jusqu'alors dans le camp des conservateurs
file:///F/dissertations_pdf/0/451054.txt[15/09/2020 14:08:43]
purs et durs, s'était transformé en "populiste", préoccupé avant tout de la saisie du champ politique par
les forces de l'argent.
Les deux favoris ont triomphé, toutefois, aux primaires du "super mardi" (7 mars 2000), leurs victoires
dans les États les plus peuplés (tels la Californie et New York) leur garantissant la nomination dans leurs
partis respectifs.
Les challengers se sont alors retirés de la course.
Mais ces affrontements ont laissé des
séquelles, en particulier dans le camp républicain : G.
W.
Bush, qui bénéficiait jusque-là d'une image
favorable auprès d'une majorité d'Américains, a connu une forte baisse de popularité.
Par ailleurs, une
campagne télévisée destinée à contrer les accusations de son challenger a réduit considérablement son
trésor de guerre.
Ainsi, aussitôt que leurs nominations sont apparues inéluctables, les favoris des deux
camps se sont retrouvés au coude à coude.
L'entrée en lice de Ralph Nader comme candidat des Verts
(Green Party) - et dont la popularité comme défenseur des consommateurs pouvait attirer des voix de
gauche - a redonné l'avantage à G.
W.
Bush.
Plus que l'échéance présidentielle, c'était désormais l'élection sénatoriale de New York qui passionnait le
public.
La décision de Hillary Clinton de briguer le siège marquait en effet une situation inédite.
Pour la
première fois, une épouse de chef d'État se lançait en politique alors que son mari était encore au
pouvoir.
Pour la circonstance, elle a abandonné la Maison-Blanche pour s'installer dans une banlieue de
New York.
Son mari, n'étant pas éligible pour un troisième mandat, faisait figure de "canard boiteux", mais entendait
néanmoins marquer sa dernière année au pouvoir par de nombreuses initiatives, tout en appelant ses
concitoyens à choisir la continuité en votant pour son vice-président.
Lorsqu'il a prononcé son dernier
discours sur l'état de l'Union (le 27 janvier 2000), B.
Clinton a déclaré : " L'état de notre Union est plus
solide qu'il ne l'a jamais été.
Jamais nous n'avons été aussi riches, jamais nous n'avons connu aussi peu
de problèmes économiques et sociaux.
" Il a mentionné les 20 millions d'emplois créés, le premier
excédent budgétaire en quarante-deux ans, la réduction de 50 % du nombre d'assistés sociaux, ainsi que
la baisse de la criminalité.
Il a rappelé à plusieurs reprises la contribution active d'Al Gore à ce bilan,
suggérant le rôle que celui-ci était appelé à jouer pour....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓